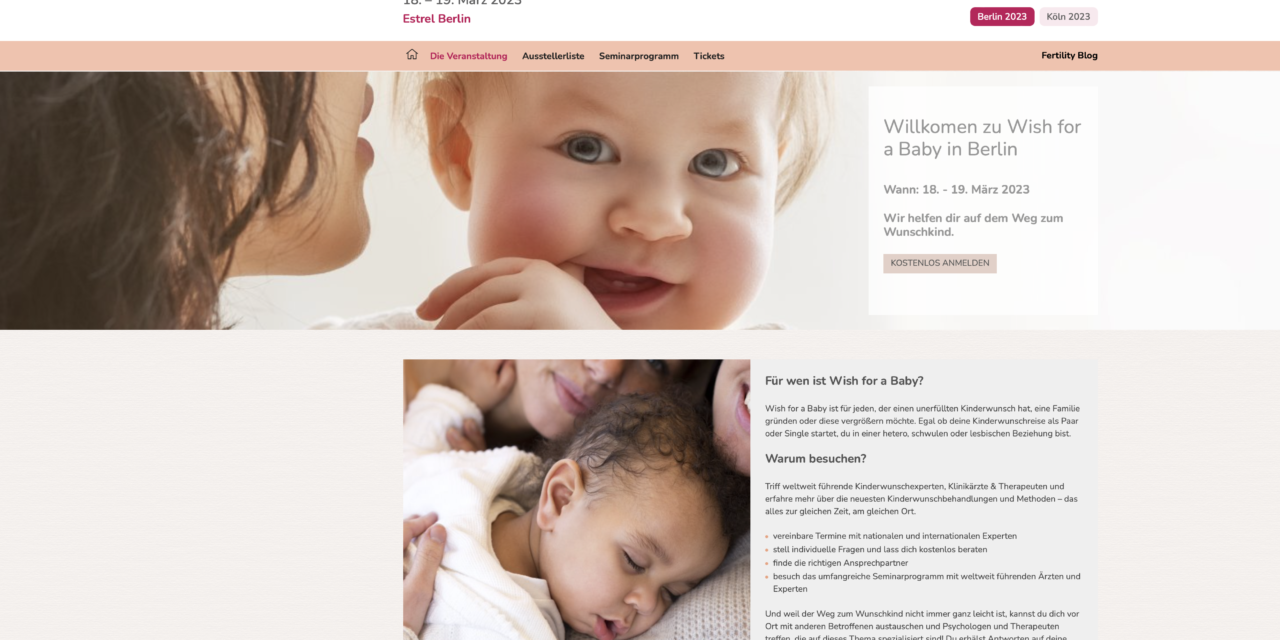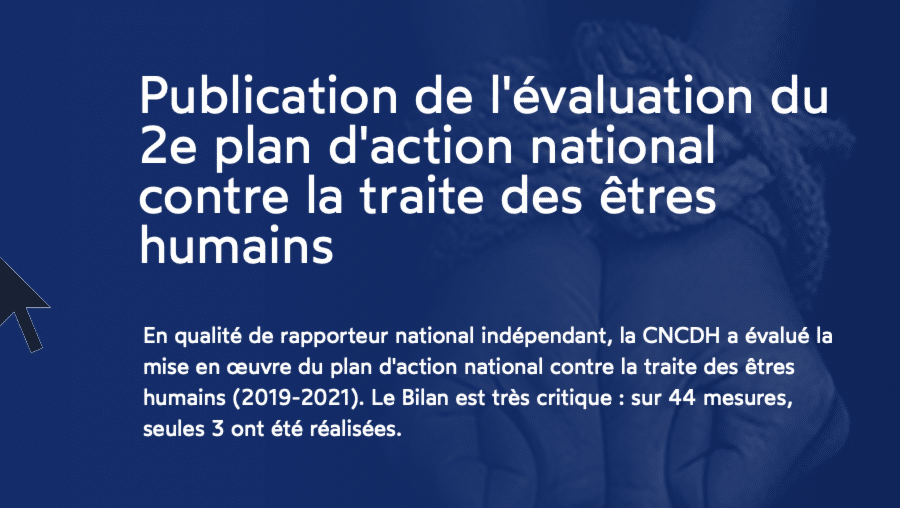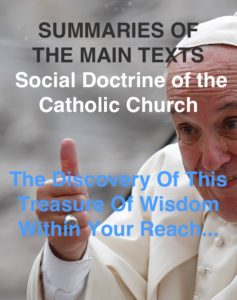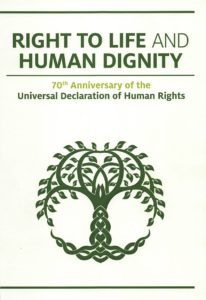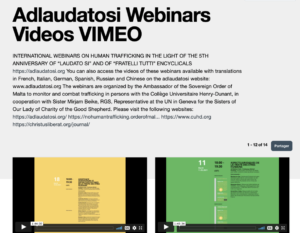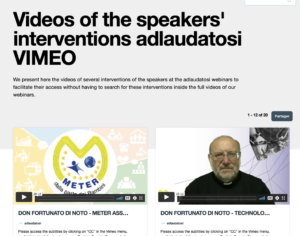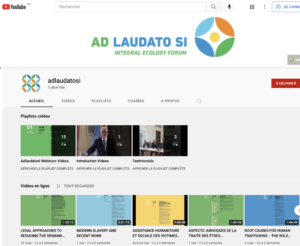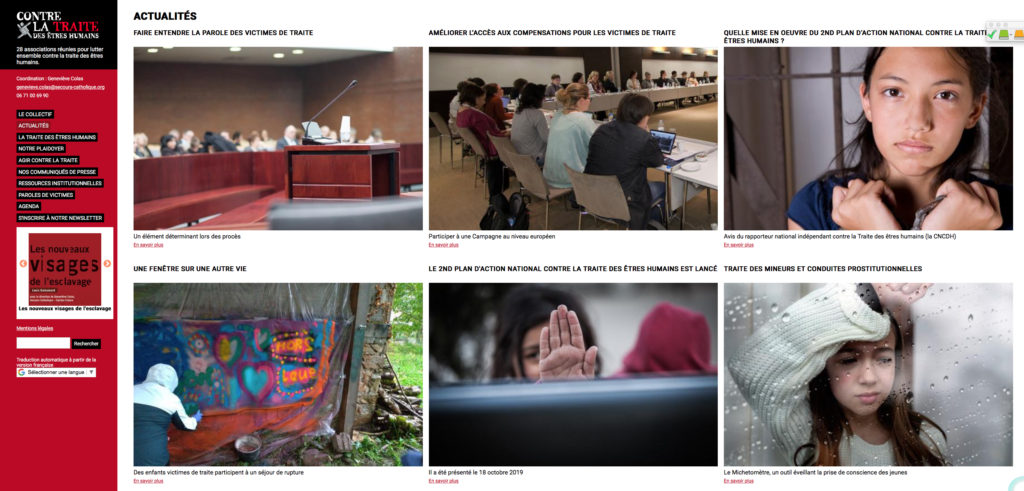SEE: https://www.wishforababy.de/berlin/2023/die-messe/ueber-die-messe/
https://www.nzz.ch/impressum/barbara-klingbacher-bak-ld.1605930
 Loading…
Loading…
 Loading…
Loading…
ENGLISH TRANSLATION:
Whether infertile, gay or single, having a baby today is just a question of money. A visit to the fertility fair in Berlin
Fertility yoga, egg donations and surrogate mothers in every price range — the business with the desire for one’s own family is flourishing and is controversial.
Barbara Klingbacher (text), Joana Kelén (illustration)
04/28/2023, 05:30 PM.
An American, a Canadian, a Northern Cypriot and a Colombian sit on a podium and compare. 150 000 to 200 000 dollars, says the American. 85 000 to 115 000 dollars, says the Canadian. 65 000 euros, says the Northern Cypriot. From 55 000 dollars, says the Colombian. These are the prices for a baby.
It’s a Sunday morning in March, and the Kinderwunsch Fair in Berlin is all about children who haven’t been born yet. In the
Rainbow Seminar Room, a roundtable discussion is taking place on the topic of “surrogacy worldwide.” The four participants not only announce the prices, but also explain the legal situation in their countries, explain which services their offer includes and from which point in time the child belongs to the “intended parents”. At the same time, a Spanish woman gives a talk on sperm banks in another room, while fertility-promoting fertility yoga is demonstrated in the Stork Whisper Lounge; “we make happiness,” promises the slogan.
The two-day fair at the Estrel convention center is aimed at people who are having trouble conceiving. The 50 booths and 60 lectures all promise the same thing: that no wish for a child need remain unfulfilled. “Wish for a baby” is a fair of hope and a market for life’s dreams. And as with every market, this one ultimately revolves around money — lots of money.
As you walk around, one rule of thumb crystallizes: the higher the hurdles, the more expensive the solution. If a woman doesn’t get pregnant for unclear reasons, she can get “in touch with her female creative power” at booth 10 (39 euros for a two-hour online seminar). Or she can book the coaching “Fertility heroines” at booth 30, where micronutrients are recommended (239 euros, without micronutrients).
If pregnancy fails to materialize because the man’s sperm are not good enough or there is no man at all, the friendly staff of the Danish “Born Donor Bank” will help, with “the best donors, the best sperm quality and the best service on the market” (from 575 euros for half a thimble, plus shipping). If the problem lies with the female eggs, the Spanish team of the fertility institute “Vida” is ready with an “egg donation guarantee program”. If the woman still does not give birth to a child after three fertilized eggs have been implanted, the institute reimburses the costs (17,950 euros for women up to fifty).
Only against the disappointment there is no insurance.
Pens from sperm banks
Steffi* and Jan* know all about disappointment. The couple stands in the quiet corner between the two halls and takes a breath for a moment. “Wish for a baby” is as busy and exhausting as any trade fair. But this fair is also emotionally tiring. All the posters with pregnancy bellies, cute babies, beaming families: visitors are reminded anew at every stand what they are missing for their happiness.
Steffi and Jan have been trying to have a child for years. In the process, they have pushed the limits of what they were willing to take on for it. Steffi is 43 and has had several artificial inseminations. The last one got her pregnant. But a few weeks ago she lost the child. She has tears in her eyes when she talks about it.
What do they hope for from this fair? That it will help them make a decision, says Steffi: Should they go one step further and try egg donation, or should they say goodbye to their desire to have a child? However, this occasion seems surreal to them. All the giveaways, for instance: Who walks around with a burlap bag with the name of a fertility clinic printed on it? Who uses the pen of a sperm bank or drinks from a water bottle advertising surrogacy? “Still,” says Steffi. “Here you can see the possibilities that you would otherwise hardly learn about.”
Many of them are banned in Germany — as they are in Switzerland — egg donation, for example, or surrogacy. German doctors are also not allowed to recommend clinics abroad to their patients. Assisting in egg donation” is a criminal offense in Germany, as is arranging surrogate motherhood.
surrogacy. Steffi and Jan’s doctor only vaguely mentioned that they could google “fertility fair.” An event like “Wish for a baby” is only allowed to take place because the organizers take the position that the exhibitors would only inform, but not make sales pitches.
So Steffi and Jan went to several booths to get information and took brochures. If they decide to donate eggs, it would be in Spain or Denmark, where an attempt costs around 6,000 euros. It would be their very last, says Steffi. “After that, we would have to ask ourselves: how do we shape our lives if our greatest wish doesn’t come true?” They rule out the next stage. Surrogacy is out of the question for them for ethical, but also financial reasons.
Two radiant fathers with baby
Surrogacy, often called surrogacy here as in English, is at the top of the price pyramid. India long had a reputation as the cheapest destination; a baby there could be had for under $20,000. But since 2019, only infertile Indian couples have been allowed to take advantage of the offer. Today, Georgia and Ukraine are considered cheap, with prices starting at
$35,000. Before the war, Ukraine was the country with the second highest number of surrogates, just behind the United States.
Of course, price is not the only criterion. In the rainbow seminar room, something else is now being compared: Who gets to parent in the U.S., Canada, Colombia and Northern Cyprus — a republic of Turkey? The audience consists of 51 men and one woman.
This seems surprising at first, but it is not. Three quarters of the people who stroll through “Wish for a baby” are men. After all, where could the hurdles to baby happiness be higher than among gay couples? They not only need a surrogate mother, but usually also a donated egg. While surrogate mothers were often the biological mothers of the babies in the past, a different model is popular today: the surrogate mother is implanted with an embryo created from another woman’s egg. This is more expensive, say the providers. But the emotional and legal risk of the woman wanting to keep the child is smaller.
More than half of the exhibitors offer surrogacy services. The business is lucrative and competitive. Global Market Insight, a market research firm, estimates the surrogacy industry will generate $14 billion in global sales in 2022. By 2032, the sum will increase almost tenfold, the firm predicts. This is because, on the one hand, the number of people with fertility problems is increasing. On the other hand, demand among homosexual couples — and singles — is rising sharply.
The audience in the rainbow seminar room can breathe a sigh of relief: in the countries being countries that are being compared, same-sex couples or singles are also allowed to become parents. It’s not by chance that the room is called that. Here, where colorful balloons form an arch over the speakers, only providers who are “inclusive” or “LGBT-friendly” get a chance to speak. How important this target group has become can be seen in the brochures, which often show two fathers with a baby.
Fair trade in the surrogate mother business.
There’s another rule of thumb at Wish for a baby: if there’s a man standing behind a booth, it’s usually a gay father who has made a career out of his good fortune. Take Brett, the head of international customer service at “Circle Surrogacy.” This is one of the many agencies that “accompany intended parents step by step on their journey”: with the choice of egg donor and surrogate mother, during pregnancy and with all legal issues. Brett scrolls through the photos on his phone. “Here,” he says, glowing with pride, “are my three children.”
Brett was a banker before becoming a father with his husband. An English surrogate carried the first son 13 years ago; the biological father is Brett’s partner. The couple adopted their daughter when she was 8 months old; she is now 10. With the third child, the couple disagreed: Brett’s partner pleaded for another adoption, Brett wanted another surrogacy, this time with his sperm. Which he says was never about biological kinship.
Brett is disarmingly honest when talking about his various paths to fatherhood. He would give his life for any of his children today, he says. But the “journey” has been quite different, he says. With the first son, he says, he and his partner went through the pregnancy full of anticipation. Adopting their daughter, on the other hand, he says, was a process full of intrusive questions. Because the adoption agency wanted to prepare prospective parents for the worst possible outcome, there was no anticipation.
the worst possible outcome, there was no anticipation, but rather concern. Emotions afterward were also different, he said: With his son, Brett fell in love immediately after birth; with his daughter, he says, it took months before he felt she was “his child.”
Brett pushed through, and he has no regrets. The time leading up to the birth of their third baby, born in the U.S. thanks to a surrogate, was again an “all-around joyful experience,” he said. This time, the couple had also chosen the sex of the child. Because there are cases of breast and uterine cancer in Brett’s family, they wanted a boy.
Brett scrolls further until he finds another family photo: The two fathers, two sons and daughter at a Dallas restaurant, with a laughing woman sitting in the middle. “Our youngest’s surrogate mother,” Brett says; the photo was taken during a recent visit. “And,” he asks rhetorically, “is this what an exploited woman looks like?” Brett left his job as a banker because he sees meaning in helping other people have babies. But he knows how controversial the business is. “Everyone should be able to fulfill their desire to have children. But they should make sure it’s a fair trade.”
“It’s like livestock.”
There are some big questions in this business: is there a right to have a child? And, is the happiness of some based in the unhappiness of others? At the intersection in front of the convention center, a group of women are shouting against the traffic noise: “Women are not your slaves, children are not your commodity,” they shout, holding banners that read, “There is no fair trade in surrogacy.”
The protest was called by the organization “Terre des femmes,” which campaigns against human rights violations against women. When a few of the
When a few of the demonstrators wanted to look at the fair, security guards put them in front of the door. What people outside think of the business model inside is already evident from the choice of words: “buying parents”, “renting mothers”. It is a form of prostitution and human trafficking: women from precarious backgrounds make their bodies available for a fee, but others earn the big money. “It’s like livestock,” says one demonstrator.
In fact, the business with surrogate mothers is often dubious, for example in the much-publicized “guarantee programs.” The intended parents pay a higher fixed price and get a child for sure. Embryos are simply used as often as necessary until a baby is born, if necessary also with a second or third surrogate mother. The problem is that such guaranteed programs are particularly lucrative for the providers if it works out on the first try. To increase the chances of this, some clinics do not implant one embryo in the surrogate mothers, but four or five. If several then survive, the surplus ones are aborted; after all, the parents wanted one baby, not five.
Ukrainian women report on other dubious business practices in the radio report “Babies for the World” by Deutschlandfunk, which was produced shortly before the war. It features a surrogate mother who gave birth to a premature baby. Because his Chinese intended parents feared that the boy might be handicapped, they refused to pick him up. The mother got much less money, the child probably ended up in a home, and the parents ordered a new baby. Another surrogate was forced into a late-term abortion because she was pregnant with a boy — the client had wanted a daughter.
As a single man, he should not have been admitted to a surrogacy program in Ukraine at all; intended parents here must be married and heterosexual. But the agencies have found ways to get around the law. They ship surrogate mothers to clinics abroad, such as in the Czech Republic, for embryo implantation and later for birth. The founder of Ukraine’s “Feskov Human Reproduction Group” was charged with human trafficking in 2021 on the basis of such a “remote program”; his company allegedly sold more than 30 babies through Prague, earning 1.2 million euros.
Feskov also has a stand at the fair in Berlin; 18,000 children had been helped into the world, a poster proclaims. At the beginning of the war, the media had reported babies who could not be picked up. The problem has been solved, says the Feskov representative, promoting the “remote program,” in which births can take place in other countries. “So the intended parents never have to enter Ukraine at all.”
A fast and cheap way to have a child
One thing is undisputed: the surrogate mother business is based on inequality. Wealthy people pay less wealthy women to carry their child. To be sure, there are surrogate mothers whose main motivation is to help other people. But with them, the demand could never be met.
In the rainbow seminar room, the waiting times in the different countries are now compared; they depend directly on the remuneration. In Canada, only altruistic surrogacy is allowed, and the women receive only an expense allowance of $15,000 to $25,000. In the U.S., however, a commercial “surrogate” can earn $50,000 to $100,000 per child. As a result, intended parents in Canada have to wait two to three years to find a surrogate, whereas in the U.S. it takes only a few weeks.
When it comes to the question of where a child’s wish can be fulfilled as quickly as possible and at the same time at a reasonable price, Colombia and northern Cyprus are in the lead. In Colombia, a surrogate mother gets only $5,000. The clinic in Northern Cyprus has found another model to reduce costs: they recruit women in poor countries like Kazakhstan or Kyrgyzstan, who are flown in for treatment and stay on site until the birth.
But Northern Cyprus has another argument on its side. Some surrogacy programs stipulate that singles must be no more than 54 years old at the start; for couples, the sum of their years of life should not exceed 110. The Northern Cyprus clinic explicitly advertises that there is no age limit for intended parents.
As open as the providers are to customers, they become suspicious when confronted by a journalist. When asked about the living conditions of the Kazakh and Kyrgyz surrogate mothers, the representative of the clinic in northern Cyprus replies that she doesn’t know anything about it and is only here to distribute brochures. The Canadian, who founded an agency called “Babies come true,” first wants to know whether it will be a text for or against surrogacy. He claims that he is not allowed to give information for negative articles, as this is forbidden by the Canadian government.
A Greek doctor also suddenly becomes monosyllabic. In his presentation, he had advertised that in his clinic all children were born by Caesarean section, so that the birth date could be better planned for the parents. Now he says he was misunderstood; a cesarean section is, of course, always a purely medical decision.
“Celebration of femininity”
Ralf has been thinking for years about whether commercial surrogacy is ethical. But what, the IT professional asks, would be the alternative in the case of a desire for a child as insurmountable as his? “The alternative would be to cheat on a woman and pretend to be romantically involved with her in order to become a father. Or not having a child and committing suicide out of despair over it.”
Ralf has been with his partner for 13 years. A few months ago, he made his decision: he wants to be a father by 45 at the latest; now he is 43.
Since then, he has approached his desire to have a child like a project, the most important one of his life. Before the trade show, he phoned all the providers who came into question. Now he has met the representatives at the booths. “That was good, more human somehow. It felt less like a sales pitch.”
Ralf knows he can’t resolve the moral dilemma, but he tries hard. He used to have the naive notion that surrogacy was an exploitation of the female body, he says. In the meantime, he thinks that self-determination also includes the right to sell one’s own body. And anyway: the feminists outside the congress center should better fight against much more dangerous developments. Against men suddenly being allowed to be women and appearing in locker rooms or in women’s sports: “That’s the real erasure of women, isn’t it?”
Ralf has decided to see surrogacy as a “celebration of femininity.” Now he is on the lookout for an agency that treats and pays its women well. Whereby: The really well paid ones, those in the USA, he cannot afford. Instead, he says, the food in Colombia or Eastern Europe is more natural, “that’s also important to me for our child”. Ralf has a dream: He would prefer the surrogate mother to move in with him and his partner during the pregnancy; then they would cook for her, spoil her and invite her to the theater. That’s not possible, of course. But he definitely wants to build a very close relationship with the surrogate, one that will last a lifetime after the birth. “She will be the most important woman in the lives of me and my partner — except maybe our mothers.”
The final question in the surrogacy roundtable revolves around the same question: how much contact do expectant parents have with the surrogate mother? The Canadian brings up the issue, believing it to be an argument in his favor. In Canada, he says triumphantly, intended parents and “surrogate mothers” are in constant exchange; the women who become surrogate mothers for altruistic reasons, wanted it that way. “With us, it’s not compulsory,” interjects the Northern Cypriot, equally confident of victory. Parents can order a baby there without ever coming into contact with the woman who gives birth to it. After all, they are customers, and their desire to have a child is an order.
* Names changed
This article is taken from the NZZ Folio on the subject of “Desired Children” (to be published on May 2, 2023).
TRADUCTION FRANÇAISE
Que l’on soit stérile, gay ou célibataire, avoir un bébé n’est aujourd’hui qu’une question d’argent. Une visite au salon du désir d’enfant à Berlin
Yoga de la fertilité, dons d’ovules et mères porteuses à tous les prix — le business du désir d’avoir sa propre famille est florissant et controversé.
Barbara Klingbacher (texte), Joana Kelén (illustration)
28.04.2023, 05.30 heures
Un Américain, un Canadien, une Chypriote du Nord et un Colombien sont assis sur une estrade et comparent. 150 000 à 200 000 dollars, dit l’Américain. 85 000 à 115 000 dollars, dit le Canadien. 65 000 euros, dit la Chypriote du Nord. A partir de 55 000 dollars, dit le Colombien. Ce sont les prix d’un bébé.
C’est un dimanche matin de mars, et au salon du désir d’enfant à Berlin, tout tourne autour des enfants qui ne sont pas encore nés. Dans le
Salle de séminaire arc-en-ciel se déroule actuellement une table ronde sur le thème “La maternité de substitution dans le monde”. Les quatre participants ne se contentent pas d’annoncer les prix, mais expliquent également la situation juridique dans leurs pays respectifs, les prestations incluses dans leur offre et à partir de quel moment l’enfant appartient aux “parents d’intention”. Au même moment, dans une autre salle, une Espagnole fait un exposé sur les banques de sperme, tandis que dans le salon des chuchotements des cigognes, on fait du yoga du désir d’enfant qui favorise la fertilité ; “nous faisons le bonheur”, promet le slogan.
Le salon de deux jours au centre de congrès Estrel s’adresse aux personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Les 50 stands et les 60 conférences promettent tous la même chose : qu’aucun désir d’enfant ne doit rester inassouvi. “Wish for a baby” est un salon de l’espoir et un marché des rêves de vie. Et comme tout marché, celui-ci tourne en fin de compte autour de l’argent — beaucoup d’argent.
En faisant le tour, une règle générale se dégage : plus les obstacles sont élevés, plus la solution est chère. Si une femme ne tombe pas enceinte pour des raisons peu claires, elle peut se rendre au stand 10 pour “entrer en contact avec son pouvoir créateur féminin” (39 euros pour un séminaire en ligne de deux heures). Ou elle peut réserver au stand 30 le coaching “Héroïnes de la fertilité”, au cours duquel des micronutriments lui seront recommandés (239 euros, sans micronutriments).
Si la grossesse n’arrive pas parce que les spermatozoïdes de l’homme ne sont pas assez bons ou qu’il n’y a pas d’homme du tout, le personnel aimable de la “Born Donor Bank” danoise apporte son aide, avec “les meilleurs donneurs, la meilleure qualité de sperme et le meilleur service sur le marché” (à partir de 575 euros pour un demi dé à coudre, sans compter les frais de port). Si le problème vient des ovules féminins, l’équipe espagnole de l’institut de fertilité “Vida” est prête à intervenir avec un “programme de garantie de don d’ovules”. Si, après avoir reçu trois ovules fécondés, la femme ne donne toujours pas naissance à un enfant, l’institut rembourse les frais (17 950 euros pour les femmes de moins de 50 ans).
Mais il n’y a pas d’assurance contre la déception.
Stylos des banques de sperme
Steffi* et Jan* s’y connaissent en déceptions. Le couple se tient dans le coin repos entre les deux halls et respire un moment. “Wish for a baby” est aussi affairé et fatigant que n’importe quel salon. Mais ce salon fatigue aussi émotionnellement. Toutes ces affiches montrant des ventres de femmes enceintes, des bébés adorables, des familles rayonnantes : à chaque stand, les visiteurs se voient rappeler à nouveau ce qui leur manque pour être heureux.
Steffi et Jan essaient d’avoir un enfant depuis des années. Ce faisant, ils n’ont cessé de repousser les limites de ce qu’ils étaient prêts à assumer pour cela. Steffi a 43 ans et a subi plusieurs inséminations artificielles. Lors de la dernière, elle est tombée enceinte. Mais il y a quelques semaines, elle a perdu l’enfant. Elle a les larmes aux yeux lorsqu’elle en parle.
Qu’espèrent-ils de cette foire ? Qu’elle les aide à prendre une décision, dit Steffi : doivent-ils faire un pas de plus et essayer de faire un don d’ovules ou doivent-ils dire adieu à leur désir d’enfant ? Cette occasion leur semble toutefois surréaliste. Tous ces cadeaux publicitaires, par exemple : Qui se promène avec un sac en toile de jute sur lequel est imprimé le nom d’une clinique de fertilité ? Qui utilise le stylo d’une banque de sperme ou boit dans une bouteille d’eau qui fait la promotion de la maternité de substitution ? “Quand même”, dit Steffi. “Ici, on voit les possibilités dont on n’entend guère parler ailleurs”.
Beaucoup d’entre elles sont interdites en Allemagne — comme en Suisse -, comme le don d’ovules ou la maternité de substitution. Les médecins allemands n’ont pas non plus le droit de recommander à leurs patientes des cliniques à l’étranger. L’ ”aide au don d’ovules” est punissable en Allemagne, tout comme l’entremise de la gestation pour autrui.
les maternités de substitution. Le médecin de Steffi et Jan a vaguement mentionné qu’ils pouvaient taper “salon de la fertilité” sur Google. Un événement tel que “Wish for a baby” ne peut avoir lieu que parce que les organisateurs ont adopté le point de vue selon lequel les exposants se contentent d’informer et ne mènent aucun entretien de vente.
Steffi et Jan se sont donc informés à plusieurs stands et ont pris des prospectus. S’ils décident de faire un don d’ovules, ce sera en Espagne ou au Danemark, où une tentative coûte environ 6000 euros. Ce serait leur toute dernière, dit Steffi. “Ensuite, nous devrions nous demander : comment organiser notre vie si notre vœu le plus cher ne se réalise pas ?” Ils excluent l’étape suivante. Une maternité de substitution n’entre pas en ligne de compte pour eux, pour des raisons éthiques mais aussi financières.
Deux pères rayonnants avec leur bébé
Les maternités de substitution, souvent appelées ici comme en anglais “surrogacy”, se trouvent au sommet de la pyramide des prix. L’Inde a longtemps eu la réputation d’être la destination la moins chère ; un bébé pouvait y être obtenu pour moins de 20 000 dollars. Mais depuis 2019, seuls les couples indiens stériles peuvent y avoir recours. Aujourd’hui, la Géorgie et l’Ukraine sont considérées comme bon marché, avec des prix à partir de 35 000 dollars. Avant la guerre, l’Ukraine était le deuxième pays où l’on recourait le plus aux mères porteuses, juste derrière les États-Unis.
Bien sûr, le prix n’est pas le seul critère. Dans la salle de séminaire arc-en-ciel, la comparaison porte désormais sur autre chose : Qui est autorisé à devenir parent aux États-Unis, au Canada, en Colombie et à Chypre du Nord — une république de Turquie ? Le public est composé de 51 hommes et d’une femme.
Cela semble surprenant au premier abord, mais ne l’est pas. Les trois quarts des personnes qui déambulent dans “Wish for a baby” sont des hommes. En effet, où les obstacles au bonheur d’avoir un bébé pourraient-ils être plus élevés que chez les couples gays ? Ils n’ont pas seulement besoin d’une mère porteuse, mais aussi, la plupart du temps, d’un ovule donné. Car si autrefois les mères porteuses étaient souvent les mères biologiques des bébés, un autre modèle est aujourd’hui très apprécié : la mère porteuse se fait implanter un embryon issu de l’ovule d’une autre femme. C’est certes plus cher, disent les prestataires. En revanche, le risque émotionnel et juridique que la femme veuille garder l’enfant est moindre.
Plus de la moitié des exposants proposent des services autour de la substitution. Le marché est lucratif et très disputé. Le cabinet d’études de marché Global Market Insight estime le chiffre d’affaires mondial de l’industrie de la substitution à 14 milliards de dollars en 2022. D’ici 2032, ce montant sera presque multiplié par dix, prévoit la société. Car d’une part, le nombre de personnes souffrant de troubles de la fertilité augmente. D’autre part, la demande des couples homosexuels — et des célibataires — augmenterait fortement.
Le public présent dans la salle de séminaire arc-en-ciel peut respirer : dans les pays qui sont sont comparés, les couples de même sexe ou les personnes seules peuvent également devenir parents. Ce n’est pas par hasard que la salle s’appelle ainsi. Ici, où des ballons multicolores forment un arc au-dessus des intervenants, seuls les prestataires “inclusifs” ou “LGBT-friendly” ont la parole. L’importance qu’a prise ce groupe cible se reflète dans les prospectus, qui montrent souvent deux pères avec un bébé.
Le commerce équitable dans les affaires avec les mères porteuses
Il y a une autre règle générale à “Wish for a baby” : si un homme se tient derrière un stand, il s’agit généralement d’un père homosexuel qui a fait de son bonheur un métier. Par exemple Brett, le chef du service clientèle international de “Circle Surrogacy”. Il s’agit d’une des nombreuses agences qui “accompagnent pas à pas les parents d’intention dans leur voyage” : dans le choix de la donneuse d’ovules et de la mère porteuse, pendant la grossesse et pour toutes les questions juridiques. Brett fait défiler les photos sur son téléphone portable. “Voilà”, dit-il, brûlant de fierté, “ce sont mes trois enfants”.
Brett était banquier avant de devenir père avec son mari. Le premier fils a été porté par une mère porteuse anglaise il y a 13 ans ; le père biologique est le partenaire de Brett. Ils ont adopté leur fille à l’âge de huit mois, elle a maintenant dix ans. Pour le troisième enfant, le couple n’était pas d’accord : le partenaire de Brett plaidait pour une autre adoption, Brett souhaitait une autre maternité de substitution, cette fois avec son sperme. Il n’a jamais été question de parenté biologique, dit-il.
Brett est d’une honnêteté désarmante lorsqu’il parle de ses différentes voies vers la paternité. Aujourd’hui, il donnerait sa vie pour chacun de ses enfants, dit-il. Mais le “voyage” est très différent. Pour le premier fils, lui et son partenaire auraient accompagné la grossesse avec impatience. L’adoption de leur fille, en revanche, a été un processus rempli de questions intrusives. Comme l’agence d’adoption préparait les futurs parents au pire scénario possible, il n’y a pas eu de préparation.
L’anticipation n’est donc pas de mise, mais plutôt de l’inquiétude. Les émotions qui suivent sont également différentes : Brett est tombé amoureux de son fils dès sa naissance, pour sa fille, il a fallu des mois avant qu’il ait le sentiment qu’elle était “son enfant”.
Brett s’est imposé, et il ne l’a pas regretté. Le temps qui s’est écoulé jusqu’à la naissance du troisième bébé, né aux États-Unis grâce à une mère porteuse, a de nouveau été une “expérience joyeuse à tous les niveaux”. Cette fois, le couple avait également choisi le sexe de l’enfant. Comme il y a des cas de cancer du sein et de l’utérus dans la famille de Brett, ils voulaient un garçon.
Brett continue à faire défiler la page jusqu’à ce qu’il trouve une autre photo de famille : Les deux pères, les deux fils et la fille dans un restaurant de Dallas, une femme souriante assise au milieu. “La mère porteuse de notre plus jeune”, dit Brett ; la photo a été prise récemment lors d’une visite. “Et”, demande-t-il de manière rhétorique, “est-ce à cela que ressemble une femme exploitée ?” Brett a quitté son métier de banquier parce qu’il trouve un sens à aider d’autres personnes à avoir des bébés. Mais il sait à quel point ce business est controversé. “Tout le monde devrait pouvoir réaliser son désir d’enfant. Mais ils devraient veiller à ce que ce soit un commerce équitable”.
“Comme pour le bétail d’élevage”
Dans ce business, il y a quelques grandes questions : y a‑t-il un droit à l’enfant ? Et : le bonheur des uns se fonde-t-il sur le malheur des autres ? Au carrefour devant le centre de congrès, un groupe de femmes hurle contre le bruit de la circulation : “Les femmes ne sont pas vos esclaves, les enfants ne sont pas votre marchandise”, crient-elles en tenant des banderoles sur lesquelles on peut lire : “There is no fair trade in Surrogacy”.
C’est l’organisation “Terre des femmes”, qui lutte contre les violations des droits de l’homme à l’encontre des femmes, qui a appelé à manifester. Lorsque quelques-unes des manifestantes voulaient visiter le salon, des agents de sécurité les ont placées devant la porte. Ce que l’on pense ici, à l’extérieur, du modèle commercial à l’intérieur se voit déjà dans le choix des mots : “parents acheteurs”, “mères locataires”. Il s’agit d’une forme de prostitution et de trafic d’êtres humains : les femmes issues de milieux précaires mettent leur corps à disposition contre rémunération, mais ce sont d’autres qui gagnent le gros lot. “Comme le bétail”, dit une manifestante.
En fait, le commerce avec les mères porteuses est souvent douteux, par exemple dans le cas des “programmes de garantie” dont on fait grand cas. Les parents d’intention paient un prix fixe plus élevé et obtiennent en échange un enfant à coup sûr. Des embryons sont tout simplement implantés autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’un bébé naisse, si nécessaire avec une deuxième ou une troisième mère porteuse. Le problème : de tels programmes de garantie sont particulièrement lucratifs pour les fournisseurs si le premier essai est concluant. Afin d’augmenter les chances, certaines cliniques n’implantent pas un embryon mais quatre ou cinq aux mères porteuses. Si plusieurs survivent, ceux qui sont en surnombre sont avortés ; après tout, les parents souhaitaient un seul bébé, pas cinq.
Des Ukrainiennes témoignent d’autres pratiques commerciales douteuses dans l’émission de radio “Babys für die Welt” de la Deutschlandfunk, réalisée peu avant la guerre. On y entend la voix d’une mère porteuse qui a mis au monde un bébé prématuré. Comme ses parents d’intention chinois craignaient que le garçon soit handicapé, ils ont refusé d’aller le chercher. La mère a reçu beaucoup moins d’argent, l’enfant a probablement fini dans un foyer, les parents ont commandé un nouveau bébé. Une autre mère porteuse a été contrainte à un avortement tardif parce qu’elle était enceinte d’un garçon — le client souhaitait une fille.
En tant qu’homme célibataire, il n’aurait même pas pu être admis à un programme de mère porteuse en Ukraine ; les parents d’intention doivent ici être mariés et hétérosexuels. Mais les agences ont trouvé des moyens trouvé des moyens de contourner la loi. Elles envoient les mères porteuses dans des cliniques à l’étranger, en République tchèque par exemple, pour l’implantation de l’embryon puis pour l’accouchement. Le fondateur de l’entreprise ukrainienne “Feskov Human Reproduction Group” a été inculpé en 2021 pour trafic d’êtres humains en raison d’un tel “programme à distance” ; son entreprise aurait vendu plus de 30 bébés via Prague et gagné ainsi 1,2 million d’euros.
Feskov a également un stand à la foire de Berlin, 18 000 enfants auraient été aidés à venir au monde, annonce une affiche. Au début de la guerre, les médias avaient fait état de bébés qui n’avaient pas pu être récupérés. Le problème est résolu, affirme la représentante de Feskov, qui fait la promotion du “programme à distance”, dans le cadre duquel la naissance peut avoir lieu dans d’autres pays. “Les parents d’intention n’ont donc jamais besoin de se rendre en Ukraine”.
Un enfant rapide et bon marché
Il est indéniable que le commerce des mères porteuses repose sur l’inégalité. Les personnes aisées paient des femmes moins fortunées pour porter leur enfant. Certes, il existe aussi des mères porteuses dont la motivation principale est d’aider d’autres personnes. Mais avec elles, la demande ne pourrait jamais être satisfaite.
Dans la salle de séminaire arc-en-ciel, on compare maintenant les temps d’attente dans les différents pays, ils dépendent directement de la rémunération. Au Canada, seule la maternité de substitution altruiste est autorisée et les femmes ne reçoivent qu’une indemnité de 15 000 à 25 000 dollars. Aux États-Unis, en revanche, une “substitut” commerciale peut gagner de 50 000 à 100 000 dollars par enfant. Par conséquent, les parents d’intention doivent patienter deux à trois ans au Canada avant de trouver une mère porteuse, alors que cela ne prend que quelques semaines aux États-Unis.
Lorsqu’il s’agit de savoir où il est possible de satisfaire un désir d’enfant le plus rapidement possible et à moindre coût, la Colombie et le nord de Chypre arrivent en tête. En Colombie, une mère porteuse ne reçoit que 5 000 dollars. La clinique du nord de Chypre a trouvé un autre modèle pour réduire les coûts : on recrute des femmes dans des pays pauvres comme le Kazakhstan ou le Kirghizstan, qui sont amenées par avion pour le traitement et restent sur place jusqu’à la naissance.
Mais Chypre du Nord a un autre argument de son côté. Certains programmes de maternité de substitution stipulent que les célibataires ne doivent pas dépasser 54 ans au départ.
54 ans ; pour les couples, la somme de leurs années de vie ne doit pas dépasser 110 ans. La clinique chypriote du nord annonce explicitement qu’elle n’impose aucune limite d’âge aux parents d’intention.
Autant les prestataires sont ouverts aux clients, autant ils deviennent méfiants lorsqu’une journaliste se trouve en face d’eux. Interrogée sur les conditions de vie des mères porteuses kazakhes et kirghizes, la représentante de la clinique chypriote du nord répond qu’elle ne s’y connaît pas, qu’elle n’est là que pour distribuer des prospectus. Le Canadien, qui a fondé une agence appelée “Babies come true”, veut d’abord savoir s’il s’agira d’un texte pour ou contre la maternité de substitution. Il affirme qu’il n’a pas le droit de donner des informations pour des articles négatifs, le gouvernement canadien l’ayant interdit.
Un médecin grec devient lui aussi soudainement monosyllabique. Dans son exposé, il avait affirmé que dans sa clinique, tous les enfants naissaient par césarienne afin que les parents puissent mieux planifier la date de naissance. Maintenant, il dit qu’on l’a mal compris, qu’une césarienne est bien sûr toujours une décision purement médicale.
“Célébration de la féminité”
Ralf réfléchit depuis des années à la question de savoir si la maternité de substitution commerciale est éthiquement défendable. Mais quelle serait l’alternative, demande l’informaticien, face à un désir d’enfant aussi insurmontable que le sien ? “L’alternative serait de tromper une femme et de lui faire croire à une relation romantique pour devenir père. Ou de ne pas avoir d’enfant et de se suicider par désespoir à ce sujet”.
Ralf est en couple avec son partenaire depuis 13 ans. Il y a quelques mois, il a pris sa décision : à 45 ans au plus tard, il veut être père ; il a maintenant 43 ans.
Depuis, il aborde son désir d’enfant comme un projet, le plus important de sa vie. Avant le salon, il a téléphoné à tous les prestataires entrant en ligne de compte. Maintenant, il a rencontré les représentants sur les stands. “C’était bien, plus humain en quelque sorte. Ça ressemblait moins à un pitch de vente”.
Ralf sait qu’il ne peut pas résoudre le dilemme moral, mais il essaie de toutes ses forces. Autrefois, il avait l’idée naïve que la maternité de substitution était une exploitation du corps de la femme, dit-il. Aujourd’hui, il pense que l’autodétermination implique aussi le droit de vendre son propre corps. Et de toute façon, les féministes qui se trouvent devant le centre de congrès feraient mieux de lutter contre des évolutions bien plus dangereuses. Contre le fait que les hommes puissent soudain être des femmes et apparaître dans les vestiaires ou dans le sport féminin : “C’est quand même la véritable extinction de la femme”.
Ralf a décidé de considérer la maternité de substitution comme une “célébration de la féminité”. Il est maintenant à la recherche d’une agence qui traite et rémunère bien ses femmes. Il ne peut pas se permettre de payer celles qui sont vraiment bien payées, celles des Etats-Unis. En revanche, l’alimentation en Colombie ou en Europe de l’Est est plus naturelle, “c’est aussi important pour moi, pour notre enfant”. Ralf a un rêve : il aimerait que la mère porteuse s’installe chez lui et son partenaire pendant la grossesse ; ils pourraient alors lui faire la cuisine, la gâter et l’inviter au théâtre. Bien sûr, ce n’est pas possible. Mais il veut en tout cas établir une relation très étroite avec la mère porteuse, une relation qui durera toute la vie après la naissance. “Elle sera la femme la plus importante de ma vie et de celle de mon partenaire — à part peut-être nos mères”.
La dernière question de la table ronde sur la maternité de substitution tourne autour de la même question : quel contact les futurs parents ont-ils avec la mère porteuse ? Le Canadien soulève la question, pensant que c’est un argument en sa faveur. Au Canada, dit-il triomphalement, les parents d’intention et les “mères de substitution” sont en échange permanent ; les femmes qui, pour des raisons deviennent mères porteuses pour des raisons altruistes, le souhaitent. “Chez nous, ce n’est pas une obligation”, lance la Chypriote du Nord, tout aussi sûre de sa victoire. Les parents peuvent y commander un bébé sans jamais entrer en contact avec la femme qui le met au monde. Après tout, ils sont des clients et leur désir d’enfant est un ordre.
* Noms modifiés
Cet article est tiré du NZZ-Folio sur le thème des “enfants désirés” (à paraître le 2 mai 2023).