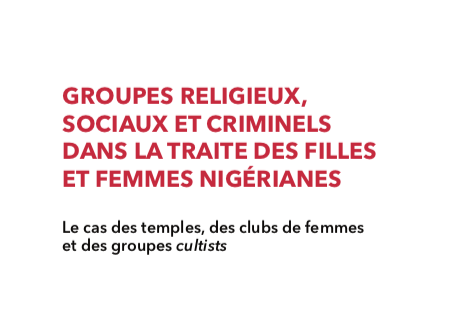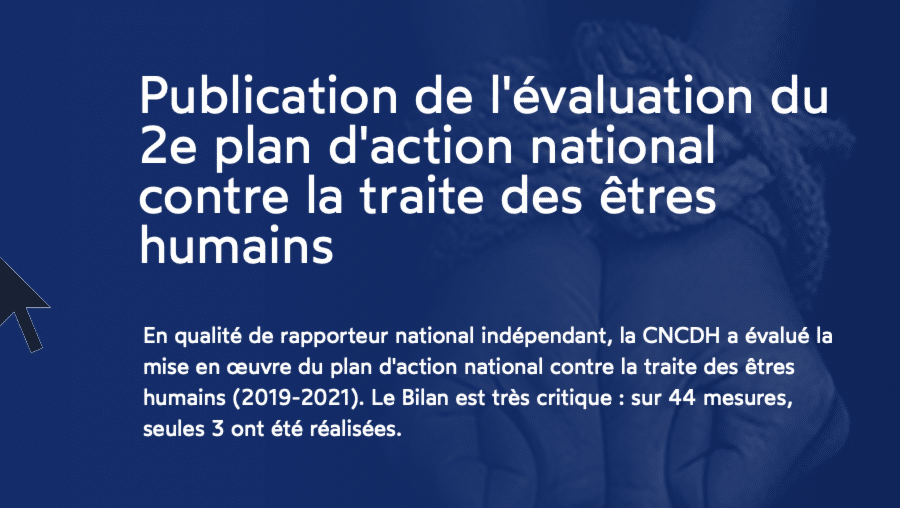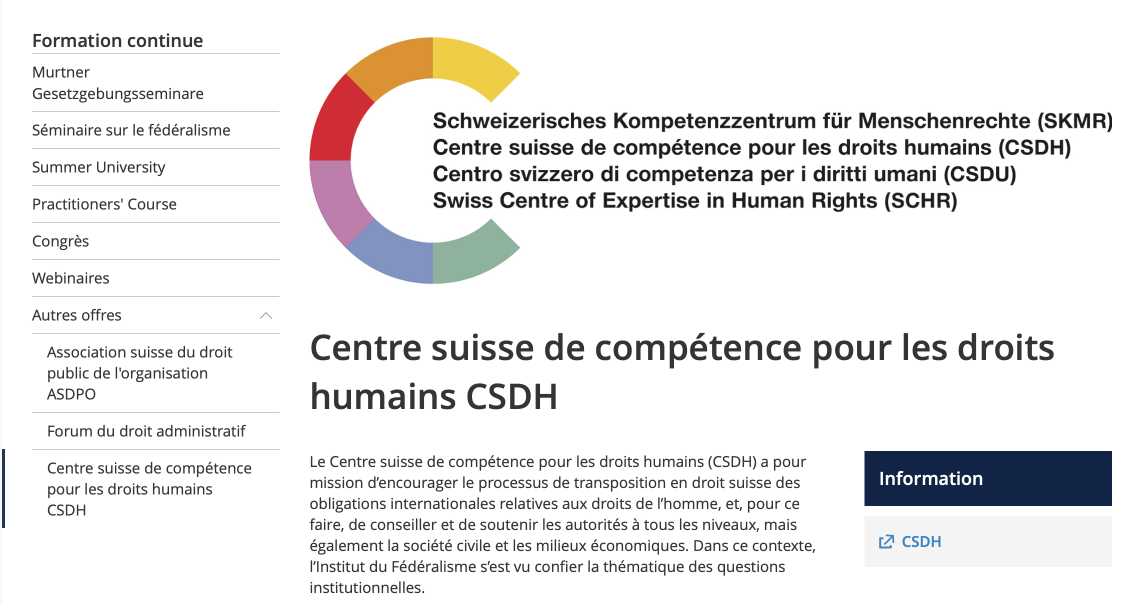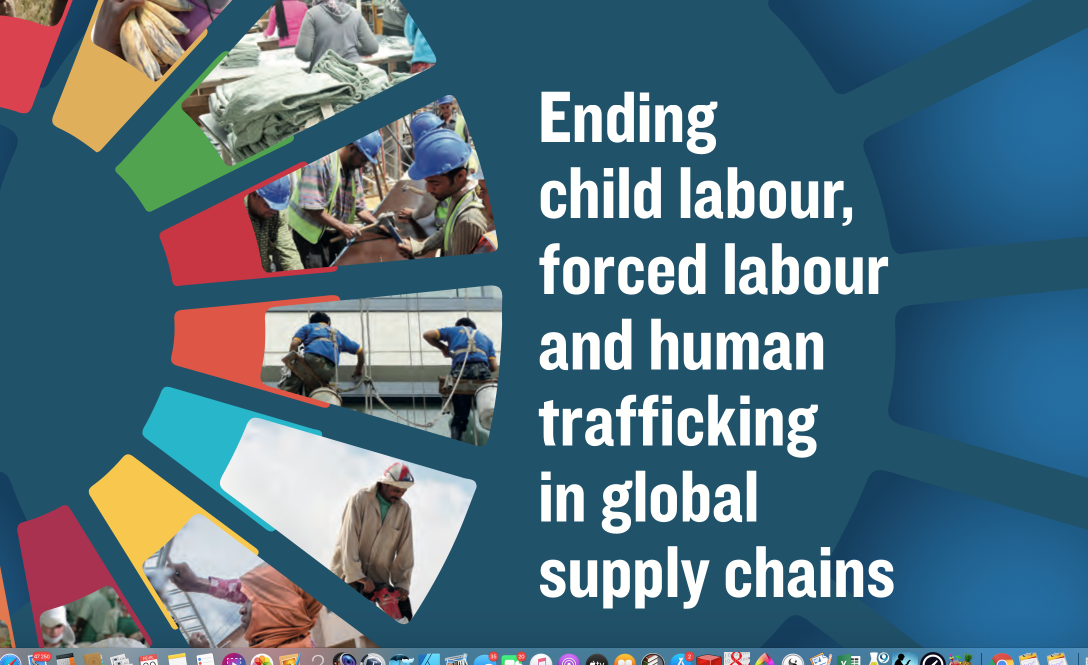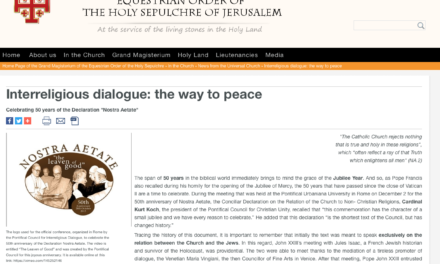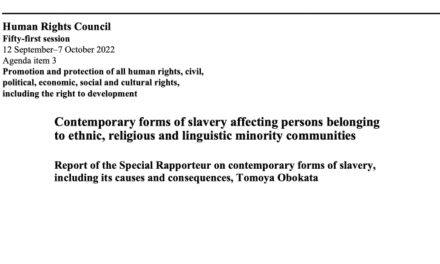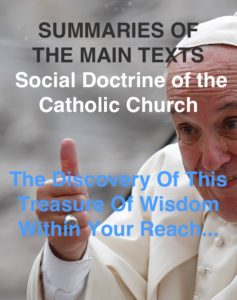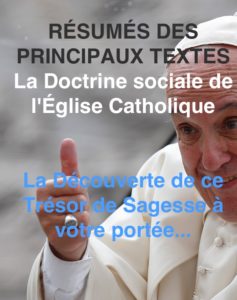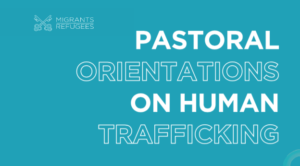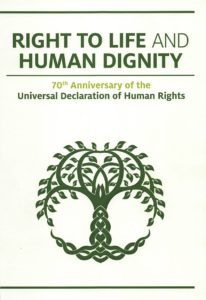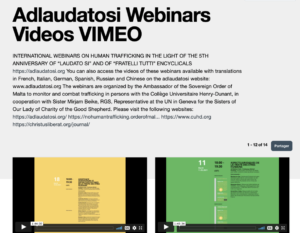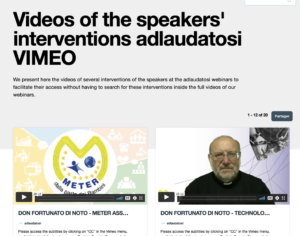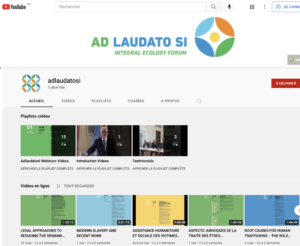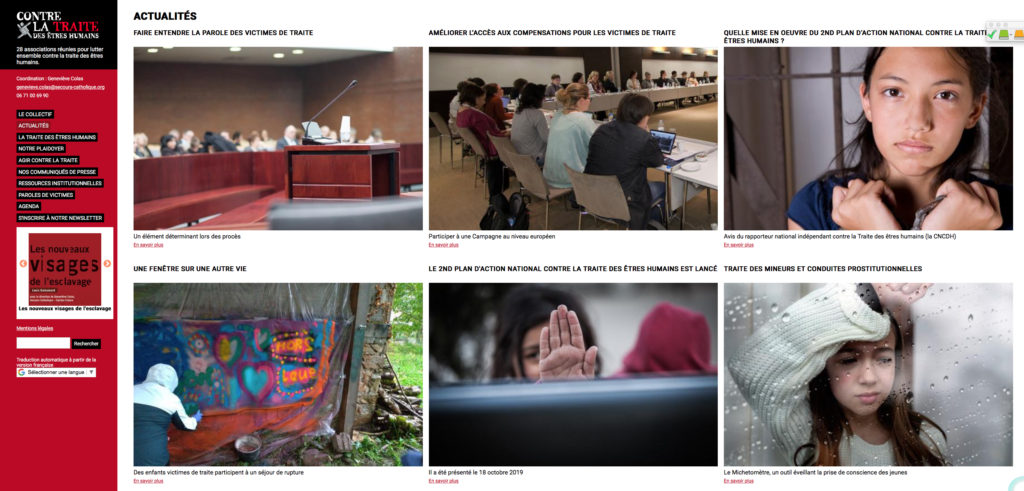La quasi irrévocabilité de la promesse
Organisés autour de la pratique de l’esusu et structurés par les règles de fonctionnement d’un groupe fermé, certains membres deLadies’ clubs à Benin City et en France sont en effet investis dans l’ex- ploitation sexuelle des jeunes et femmes nigérianes sur le territoire d’accueil. En termes de position sociale, le club permet également en France de marquer celles qui en font partie, celles qui peuvent ou veulent y prétendre et les autres. De ce point de vue-là, l’appar- tenance à un club contribue à asseoir la hiérarchie du sponsor sur la victime. Ainsi, on peut considérer qu’il est important et rationnel d’adhérer à cet entre-soi ou du moins de chercher à y parvenir, et ce d’autant plus, que le membre peut profiter également des bénéfices du club en termes de soutien (A) et de ressources (B) financiers.
La quasi irrévocabilité de la promesse
La définition du trauma peut être associée à l’image d’une effrac- tion psychique comme si la violence et l’intensité de la peur avaient porté atteinte à l’intégrité de l’enveloppe du sujet. Au sein du rituel, certaines pratiques vont porter physiquement atteinte à l’enveloppe corporelle et contribuer à empêcher toute révocation de la promesse. Par ailleurs, l’incertitude qui entoure ce que nous serions tentés de qualifier de régime juridique du serment, à savoir les conditions de validité, de nullité, ou de révocation, favorise un climat d’incertitude qui accroît encore la vulnérabilité de la personne.
Éléments qui rendent la promesse difficilement révocable
Au sein du processus du serment, les pratiques d’ingestion et de scarifications évoquées précédemment, vont avoir des effets consi- dérables. Pour reprendre les propos de Tobie Nathan, on rappellera que: «Posséder un espace clos, corps ou maison, c’est avant tout avoir des limites propres, nettes […]. En revanche, des limites floues, humides, incertaines constituent la marque sensible de l’effraction ». En attaquant l’enveloppe qui délimite et protège la personne, on altère sa représentation du dedans et du dehors, du soi et du non-soi, et ainsi son sentiment d’intégrité individuelle est détruit. La notion d’identité devient caduque. Tobie Nathan explique qu’une personne non possédée se sentira «entière et pleine, avec des limites qui marquent sa différence à l’autre, tandis qu’à travers l’effraction, le sorcier signifie à la victime que son enveloppe est percée et qu’elle ne peut plus garder la différenciation entre soi et autrui»108. Ces propos confirment les enjeux anthropologiques associés à ces diffé- rentes pratiques en termes d’identité, d’appartenance et de création de liens. Au-delà, on ne peut ignorer leur dimension psychologique et l’on constate, même si l’on ne saurait prétendre à une analyse exhaustive, que les deux champs se rejoignent autour de l’idée de faire accéder celui qui jure à une appartenance nouvelle qui l’oblige de manière absolue, puisque la trahison l’expose à la mort. Le lien créé, que ce soit avec celle à laquelle est prêtée l’allégeance ou, plus indirectement avec les autres membres du groupe, se fait au mépris de l’individualité et de l’appartenance antérieure de la personne. De ce fait, toutes les ressources qu’elle pourrait trouver dans son histoire ou dans son environnement pour qualifier les pratiques subies et éventuellement les déclarer intolérables, vont être altérées si ce n’est anéanties. L’atteinte à l’identité emporte une atteinte à la capacité d’exprimer une volonté propre et de se révolter. Ces éléments sont encore confortés par l’utilisation des items au cours du serment.
La contrainte exercée via la menace d’agir sur les items se révèle extrêmement puissante. Tant qu’elle ne les a pas récupérés, la victime ne peut échapper au pouvoir de ceux qui lui demandent de rem- bourser sa dette sur ces objets mais aussi sur sa vie : « Quand la mère de ma madam a appelé, (…) a dit qu’elle pouvait placer une malédic- tion sur moi et que cela aurait un effet car elle avait mes « affaires » avec elle. À ce moment-là, j’étais terrifiée et j’ai décidé de lui envoyer 20 000 nairas » (NT3).
Beaucoup de femmes font ainsi de la récupération des items une condition à leur affranchissement du groupe, que ce soit alors qu’elles sont encore en Europe ou une fois rentrées au Nigéria. Le fait que les menaces soient exercées sur la famille renforce davan- tage encore leur enfermement et leur isolement. Sous l’effet de la peur, bon nombre de familles répugnent à encourager la victime à s’affranchir du groupe. Le recours au juju est ici un élément de contrainte et de soumission extrêmement puissant face auquel il est difficile d’élaborer des contre-poids en termes juridiques. La dimen- sion irrationnelle de la menace mais aussi son caractère imprévisible entravent la capacité de résistance des victimes et rendent complexe toute action des tiers en vue de la neutraliser.
 Loading…
Loading…