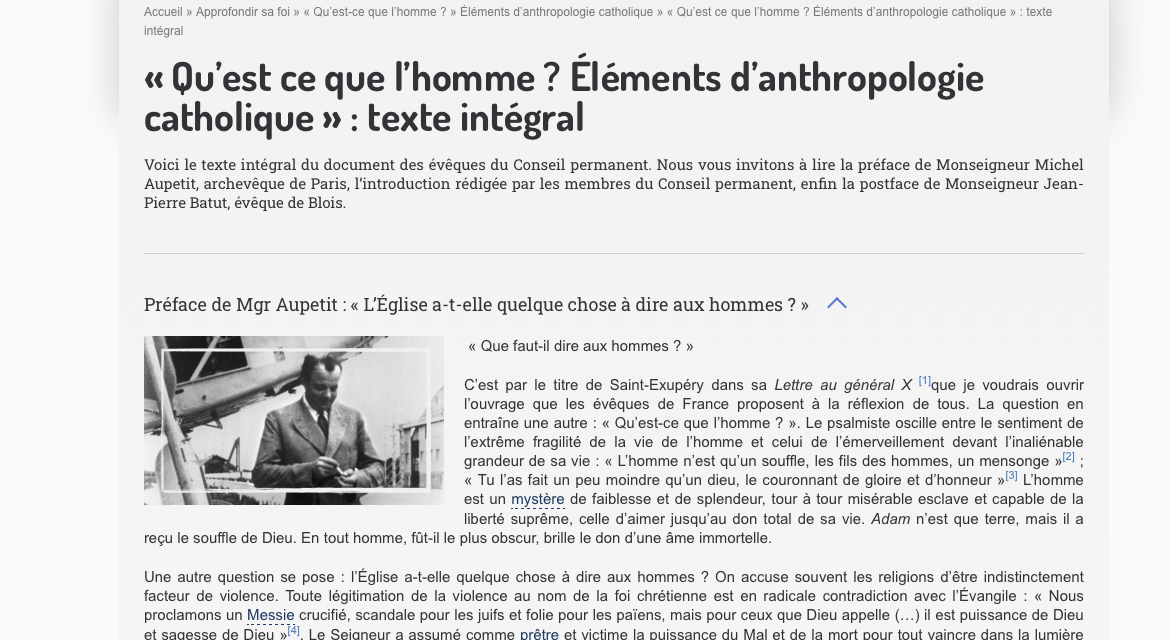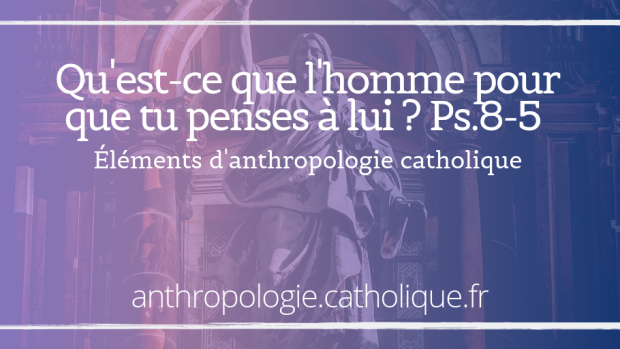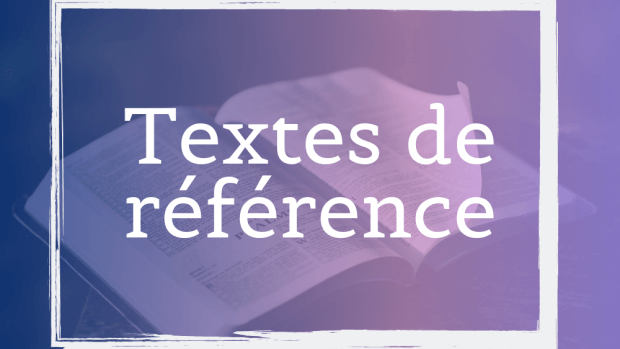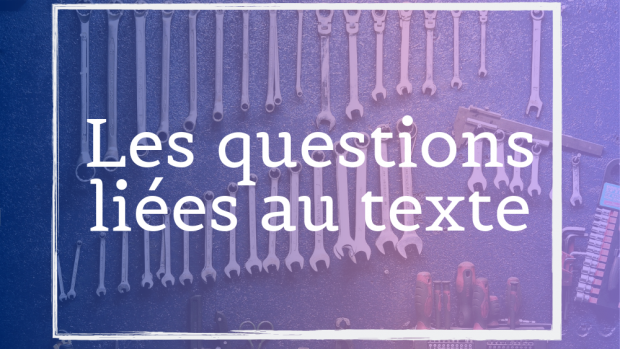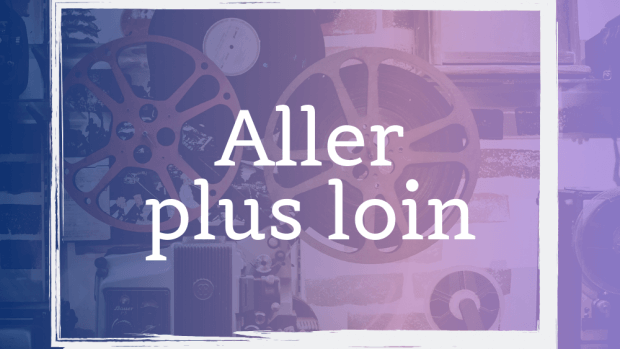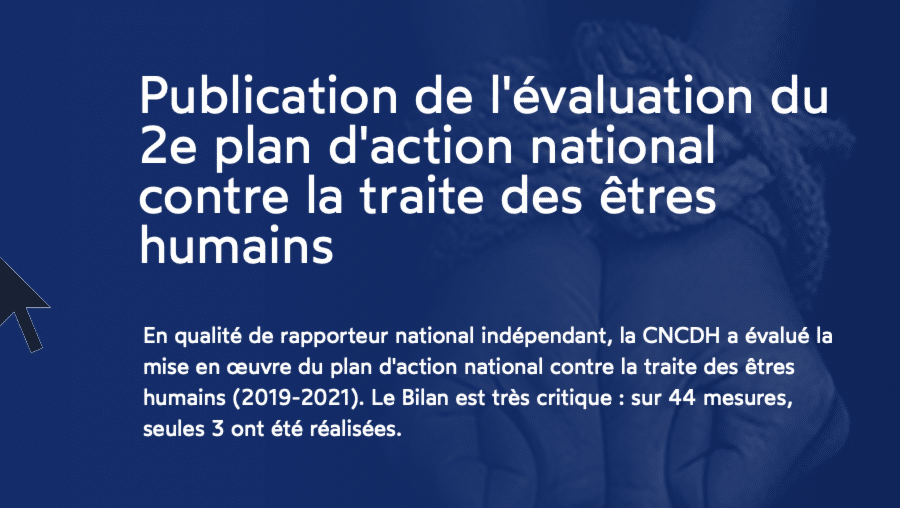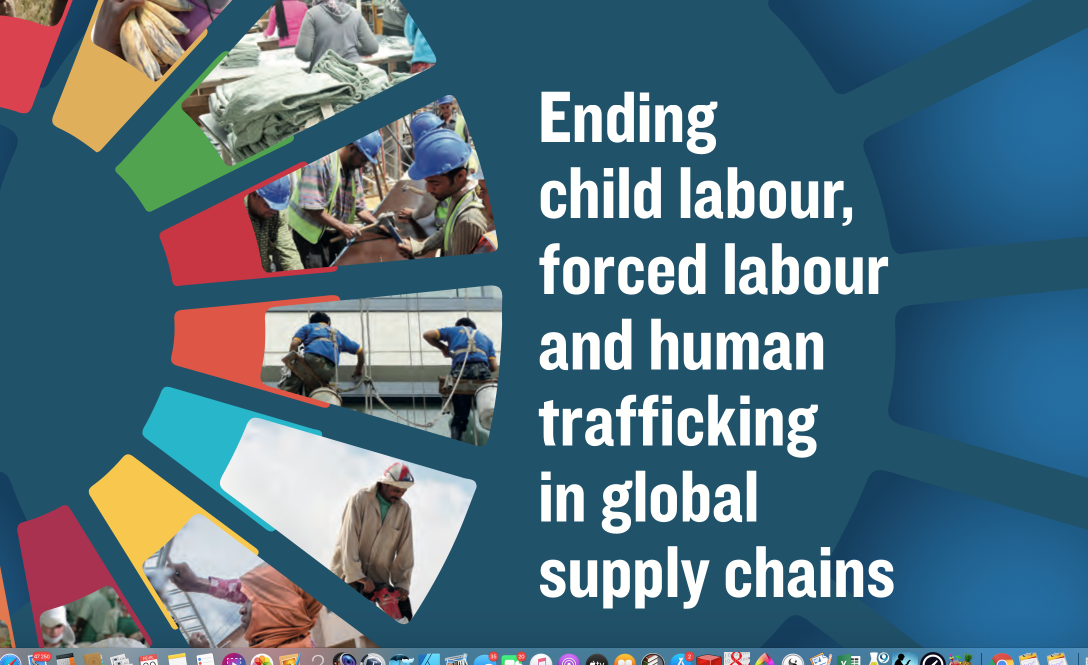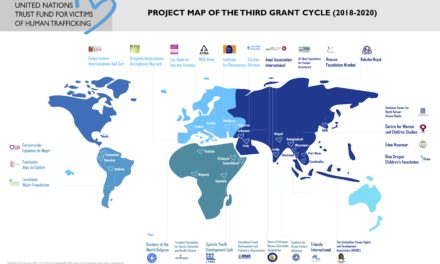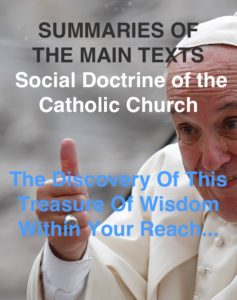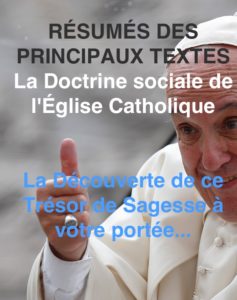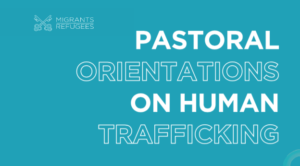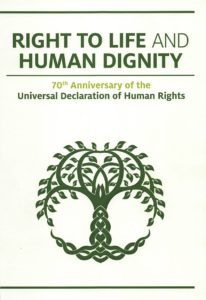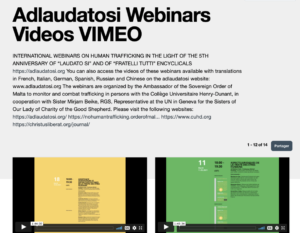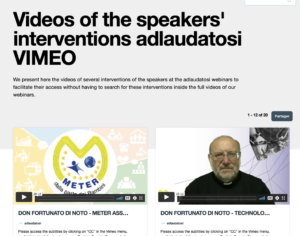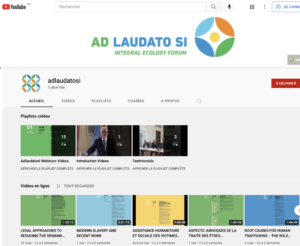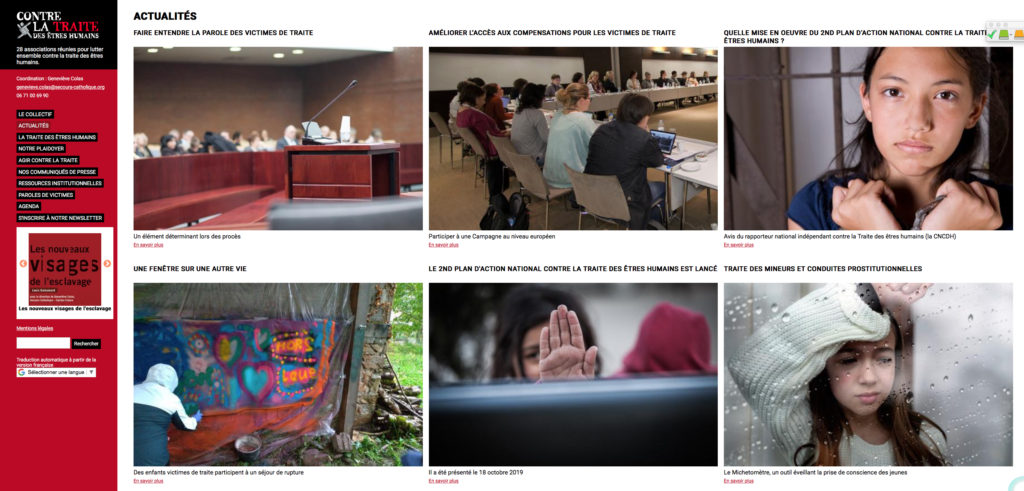« Qu’est ce que l’homme ? Éléments d’anthropologie catholique » : texte intégral
Voici le texte intégral du document des évêques du Conseil permanent. Nous vous invitons à lire la préface de Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, l’introduction rédigée par les membres du Conseil permanent, enfin la postface de Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois.
Préface de Mgr Aupetit : « L’Église a‑t-elle quelque chose à dire aux hommes ? »
 « Que faut-il dire aux hommes ? »
« Que faut-il dire aux hommes ? »
C’est par le titre de Saint-Exupéry dans sa Lettre au général X [1]que je voudrais ouvrir l’ouvrage que les évêques de France proposent à la réflexion de tous. La question en entraîne une autre : « Qu’est-ce que l’homme ? ». Le psalmiste oscille entre le sentiment de l’extrême fragilité de la vie de l’homme et celui de l’émerveillement devant l’inaliénable grandeur de sa vie : « L’homme n’est qu’un souffle, les fils des hommes, un mensonge »[2] ; « Tu l’as fait un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur »[3] L’homme est un mystère de faiblesse et de splendeur, tour à tour misérable esclave et capable de la liberté suprême, celle d’aimer jusqu’au don total de sa vie. Adam n’est que terre, mais il a reçu le souffle de Dieu. En tout homme, fût-il le plus obscur, brille le don d’une âme immortelle.
Une autre question se pose : l’Église a‑t-elle quelque chose à dire aux hommes ? On accuse souvent les religions d’être indistinctement facteur de violence. Toute légitimation de la violence au nom de la foi chrétienne est en radicale contradiction avec l’Évangile : « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais pour ceux que Dieu appelle (…) il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu »[4]. Le Seigneur a assumé comme prêtre et victime la puissance du Mal et de la mort pour tout vaincre dans la lumière de sa résurrection. Notre foi en Jésus ressuscité est solide, attestée par les apôtres qui ont « vu, entendu et touché » le Verbe de Vie[5]. Elle est proclamée par le peuple immense des témoins qui ont engagé leur vie par fidélité au Christ, souvent jusqu’à la mort.
Pour qui en reste à un regard extérieur, l’Église apparaît en Occident comme une institution vieillie et secouée de scandales, qui entrave le mythe d’un progrès que l’on invoque sans trop savoir où il mène. Mais l’Église est belle pourtant dans le visage de ses saints, dans l’immense manteau de tendresse qu’elle étend sur le monde, particulièrement sur les plus délaissés des hommes. Elle est « experte en humanité »[6] car sa foi repose sur l’Alliance de Dieu avec son peuple, accomplie dans l’Incarnation du Christ et le Salut par la Croix, ouvert à la multitude des hommes « de toute race, langue, peuple et nation ».[7]
L’oubli de Dieu, l’estompement de la conscience de l’éternité dans le cœur de l’homme entraîne l’effacement de la dignité humaine. Le drame de l’humanisme athée qui a ravagé le XXe siècle a vu, dans des proportions jusqu’alors inégalées dans l’histoire, la mort de l’innocent. La tentation prométhéenne demeure. Elle ne pourra exaucer les hommes dans leur désir d’une vie éternelle. Elle sacrifie les plus fragiles sur l’autel d’une prétendue modernité. Nous proclamons, à temps et à contretemps, la dignité inaliénable de toute vie humaine en ce monde. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, est l’amour divin déployé dans la vulnérabilité de la chair. Une société est vraiment humaine quand elle se fait gardienne du plus petit des êtres.
« Il faut imaginer Sisyphe heureux »[8]. La parole de Camus sur l’homme condamné à rouler éternellement son rocher est celle de l’acceptation de l’absurde. Avec saint Ignace d’Antioche, nous voulons dire une autre parole : « Il y a en moi une eau vive et qui murmure : viens vers le Père »[9]. Laissez-moi simplement vous poser la question : quelle est votre espérance ? Puisse cet ouvrage vous donner de devenir davantage ce que vous êtes en vous ouvrant à « Celui qui est », le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, dont la gloire resplendit sur la Face du Christ.
[1] A de SAINT-EXUPERY, Que faut-il dire aux hommes, Lettre inédite au général X, Imprimerie générale du sud-ouest, Bergerac, 1949.
[2] Ps 39.
[3] Ps 8.
[4] I Co 23–24.
[5] Cf. I Jn 1, 1.
[6] Bx PAUL VI, Lettre encyclique Populorum progressio, 1967, I, 13.
[7] Ap 5, 9.
[8] Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe, NRF, Gallimard, 1965, p. 198.
[9] S. IGNACE D’ANTIOCHE, Lettre aux Romains, 7.
Introduction au document : « qu’il est exaltant d’être humain face aux défis ! »
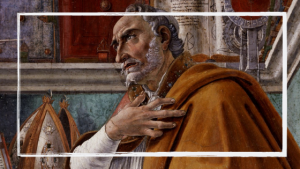 L’Église catholique tient à proclamer un « grand oui à la vie humaine » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, instruction Dignitas Personae, 1). Elle défend le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. L’Église voudrait redire combien il est exaltant d’être humain face à ces défis. L’Ecriture le chante :
L’Église catholique tient à proclamer un « grand oui à la vie humaine » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, instruction Dignitas Personae, 1). Elle défend le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. L’Église voudrait redire combien il est exaltant d’être humain face à ces défis. L’Ecriture le chante :
« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur, tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds » (Ps 8, 5–7).
Aujourd’hui l’homme fait face à de grands défis et à de grandes tentations. Le progrès donne à l’homme des potentialités exaltantes mais crée aussi des menaces inquiétantes. D’une part, il est menacé par la catastrophe écologique, d’autre part certains parlent de le remplacer par un homme augmenté ou même un « post-humain ». Nous nous interrogeons sur sa dignité, sa vocation, son destin dans l’univers. Nous nous effrayons de ses crimes. Beaucoup réclament sans cesse de nouveaux droits qui posent des problèmes redoutables.
C’est pourquoi il a été jugé utile de proposer quelques pistes de réflexion sans doute partielles[1] sur ces interrogations concernant la personne humaine, sa beauté, sa dignité, son droit de s’accomplir pleinement.
« Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Toi » (Saint Augustin, Confessions I, i, 1). Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance pour l’unir à lui dans l’Amour qui est la vie éternelle. L’homme n’est pas fait pour se contenter de cette vie-ci, il est appelé à plus grand, en vivant dès maintenant l’amour. Plus radicalement encore, l’homme ne trouve pas sa fin en lui-même, il est appelé à se donner aux autres et à Dieu pour s’accomplir. En l’appelant à l’existence par amour, il l’a appelé en même temps à l’amour (Jean-Paul II, Familiaris consortio, 11). Par cet appel, l’homme est une personne, à la fois intériorité et relation, il se reçoit toujours d’un autre, à commencer par l’Autre par excellence qu’est le Créateur.
[1] Par souci de méthode, les questions économiques et sociales seront très peu abordées ici.
Partie I : L’Être humain est une personne
I.1 Créé et appelé par Dieu
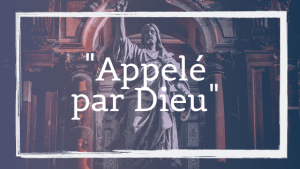 Créé et appelé par Dieu, chacun de nous est une personne. Cette affirmation comporte une part de mystère. La personne ne peut pas être définie comme un crayon ou une table parce qu’elle est créée à l’image et ressemblance de Dieu et porte quelque chose de son mystère. Mais il est possible de montrer ce que la personne possède en propre qui la rend supérieure à toute autre chose.
Créé et appelé par Dieu, chacun de nous est une personne. Cette affirmation comporte une part de mystère. La personne ne peut pas être définie comme un crayon ou une table parce qu’elle est créée à l’image et ressemblance de Dieu et porte quelque chose de son mystère. Mais il est possible de montrer ce que la personne possède en propre qui la rend supérieure à toute autre chose.
La personne est appelée par Dieu à se donner librement à lui. Sa liberté se détermine par sa raison. L’exercice libre de la raison rend la personne responsable, apte à écouter sa conscience pour y écouter Dieu, ce qui l’ouvre à la transcendance. La personne est appelée tout entière, corps, âme et esprit.
I.2 Appelé à la liberté
Souverainement libre et aimant, Dieu ne peut appeler à s’unir à lui que dans la liberté. Il a donc crée l’homme libre. Cette liberté s’accomplit par l’amour qui tient dans le don de soi. Cette liberté comporte une insatisfaction qui pousse l’homme à chercher plus grand que ce monde-ci. La personne est libre. Ses actes ne peuvent s’expliquer complètement par des causes extérieures telles que la génétique, son histoire, le milieu ou la configuration du cerveau. Chacun de nous sent bien que ses décisions lui appartiennent en propre. Chacun est vraiment maître de sa vie. Cette liberté permet en particulier à l’homme de choisir le Bien pour le Bien et non par instinct ou calcul stratégique. Cette liberté innée, nommée libre arbitre, pousse l’homme à chercher la liberté sociale et politique. Il se révolte contre toute forme d’oppression contraire à sa dignité. Mais le libre arbitre n’est pas capacité indifférente de faire n’importe quoi. Il n’est pas non plus autorisation de faire tout ce qu’on veut comme si nos actes ne concernaient que nous. Le libre arbitre de´ sire le Bien total. Il est appelé par Dieu à s’unir à Lui dans l’amour. Il se réalise donc pleinement par cet amour. La science a souvent tendance à nier ce libre arbitre en appliquant à l’homme des modèles qui sont valables pour l’univers inanimé. C’est ainsi qu’à notre époque, les neurosciences se font fortes de percer les mystères de l’esprit humain et de démontrer que l’homme est déterminé par la structure de son cerveau. Sans rien nier des formidables découvertes apportées par ces sciences, nous ne pouvons souscrire à cette affirmation. Mon cerveau ne me détermine pas. Quelle que soit leur importance, les biens limités de ce monde ne peuvent apaiser notre soif. Tous, nous cherchons un Bien suprême qui nous procure le bonheur. Notre liberté porte en elle une insatisfaction qui la pousse à chercher autre chose que ce monde-ci et ses biens relatifs. La liberté de la personne ne s’accomplit jamais seule. Elle a besoin de s’allier à la liberté des autres pour atteindre sa fin véritable qui est le bonheur. Ce libre arbitre est également besoin de se donner. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). La personne n’est pas faite pour poursuivre son intérêt de manière égoïste. Elle est destinée à s’ouvrir aux autres. C’est ainsi que les régimes d’oppression ont vu se lever des hommes et des femmes prêts au sacrifice suprême pour rétablir la justice. La liberté comporte donc le devoir de respecter la liberté d’autrui. La liberté de l’homme ne flotte pas en l’air, elle est située. Elle apparaît dans un lieu et une e´poque, une culture, des conditions de vie. Elle est par là même limitée. Limitée parce qu’elle est finie, limitée par les éléments qui l’environnent, limitée par la liberté d’autrui. En rêvant orgueilleusement de s’affranchir de ses limites, l’homme se détruit et blesse la fraternité. En les accueillant humblement comme un chemin de vérité , il s’accomplit. « Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 11). La liberté ainsi comprise appartient à la beauté de l’homme capable de surmonter les obstacles et d’ouvrir de nouvelles routes de progrès humain. Si bien du travail reste à faire, la fin du XXe siècle a vu s’effondrer plus d’un régime oppressif qui se croyait définitif. Osons croire en cette liberté. L’homme sent bien qu’il est divisé intérieurement. S’il se regarde avec honnêteté, chacun de nous avouera des complicités avec le mal en lui-même. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Rm 7, 19) dit saint Paul. La liberté de l’homme a été blessée par le péché. Le péché vient dresser la volonté contre elle-même. Cette situation se révèle spécialement dans les différentes addictions comme la toxicomanie ou la pornographie. Mais avec l’aide de Jésus-Christ, l’homme peut surmonter cette division et trouver la paix. « Je peux tout en celui qui me rend fort » (Ph 4, 13) dit le meˆme saint Paul.
I.3 Appelé à la vérité
La liberté n’est pas aveugle, elle se détermine par la raison que Dieu a déposée en l’homme. Par sa raison, la personne est faite pour la vérité. Elle est capable de trouver la vérité parce qu’elle est intériorité. Nous avons tous besoin de la vérité. L’homme ne se satisfait pas des apparences, il veut connaître la nature profonde des choses. Il désire posséder la vérité pour elle-même. Il y a quelque chose d’exaltant dans la découverte de la vérité, dans le progrès des connaissances humaines, porté si loin ces derniers siècles. La vérité est universelle. Elle est faite pour l’humanité entière. Le besoin de vérité est la source de tout dialogue. L’amour de la vérité permet le dialogue et en même temps le dialogue suppose l’amour de l’autre. Dans l’amour commun de la vérité et de l’homme, le dialogue permet à chacun d’avancer librement. De même, tout homme a droit à la vérité. Les programmes d’aide sociale envers les plus défavorisés doivent comporter l’éducation pour respecter ce droit à la vérité de tous. La recherche de la vérité suppose aussi l’humilité. Celui qui s’enferre dans ses certitudes, son idéologie, se voue à l’illusion. La vérité se trouve en acceptant de grandir et pour cela d’avoir besoin des autres. La parole des plus petits est précieuse, en particulier quand elle crie leurs détresses et leurs espérances, car elle aussi porte la vérité. C’est pourquoi le mensonge est contraire à la dignité de l’homme. Après des siècles très rationalistes, notre époque est traversée de doutes sur les capacités de la raison humaine. Les échecs du progrès, les menaces nouvelles, le choc des cultures, tendent à provoquer un relativisme ou un scepticisme. Cet excès est aussi mortifère que le précédent. Nous en arrivons à une ère de la « post-vérité » où de soi-disant « faits alternatifs » viendraient remplacer le besoin de vérité, ère à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner. Maintenue dans ses justes limites, éclairée par l’amour, la raison humaine est vraiment capable de connaître l’univers et de proposer de nouvelles solutions. Elle n’a pas fini de nous émerveiller. Si la raison peut être éclairée par la Révélation, la vérité ultime que cherche l’homme, sur Dieu, sur lui-même, est inaccessible à la raison, aussi puissante que puisse être celle-ci. Elle a été révélée par le Christ, qui est à la fois « le chemin, la vérité, la vie » (Jn 14, 6).
I.4 Appelé à la responsabilité
L’homme est appelé à répondre selon sa liberté éclairée par sa raison à l’appel de Dieu. Il est donc responsable. S’assumer comme personne libre suppose d’exercer cette responsabilité. L’éducation doit veiller à faire naître chez les jeunes ce sens de la responsabilité. L’homme est responsable de lui-même, des autres et de l’univers. La catastrophe écologique qui nous menace
démontre ce point : l’homme a un devoir de bonne gérance sur la création qui lui a été confiée par Dieu. S’il n’assume pas ce devoir, il crée des drames dont il est la première victime. Cet exemple de la responsabilité écologique démontre aussi que s’assumer libre ne peut pas signifier suivre ses désirs sans
frein, faire comme si l’on é tait seul au monde.
Les actes de chacun ont des répercussions sur tous. Les actes ont aussi valeur d’exemples.
Par exemple, le groupe des évêques chargé de la bioéthique a signalé que le suicide assisté ne peut pas être présenté comme un choix individuel sans conséquence pour les autres.
En choisissant le suicide assisté en raison de leur âge ou de leur maladie, les personnes font peser sur les autres malades et personnes âgées le soupçon d’être en trop, encombrantes ou trop coûteuses. Nous sommes responsables les uns des autres. En particulier, nous sommes responsables de ceux qui parmi nous souffrent le plus ou sont blessés dans leur humanité.
Nous ne pouvons pas regarder ailleurs et faire comme si cela ne nous concernait pas.
Mais l’aide indispensable que nous leur devons doit aussi respecter leur liberté et les aider à exercer leur propre responsabilité.
Notre époque a des problèmes avec la responsabilité. Elle oscille entre la tentation de déresponsabiliser l’homme, de le laisser à sa liberté abaissée au rang de caprice, et celle de désigner des boucs émissaires. D’un côté,
l’idée d’une liberté laissée seule à elle-même sans loi induit la fin de toute responsabilité devant les autres et Dieu. De l’autre, les drames qui font la une des journaux imposent qu’il y ait un responsable et comme l’époque ne sait plus exercer cette responsabilité, elle revient sous des formes folles en
lynchant un individu pris presque au hasard pendant que les autres se lavent les mains de problèmes qui souvent relèvent de l’ensemble de la communauté. En réalité, la responsabilité est l’exercice plénier de la liberté.
Dieu a laissé l’homme à son propre conseil, non pour qu’il suive aveuglément
ses instincts qui ne suffisent pas à éclairer entièrement ses choix, mais pour qu’il puisse se donner aux autres et à Lui-même en toute
liberté. C’est pourquoi chacun de nous répondra de ses actes devant Dieu. L’Évangile manifeste que ce jugement dernier portera sur la conduite envers les plus petits :
« Ce que vous faites au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25, 40).
Nous ne serons pas jugés sur des performances extraordinaires mais sur
notre solidarité avec les plus petits.
I.5 Conscience et Loi naturelle
La responsabilité de l’homme est sa réponse à l’appel de Dieu. C’est pourquoi l’homme est doté d’une conscience morale, un sanctuaireintérieur où Dieu lui parle, où il juge ses propres actes, se louant quand il fait le bien, se condamnant quand il fait le mal. Dans cette conscience, Dieu y a déposé la loi morale. Cette loi morale, qui est appelée loi naturelle, n’est pas la loi de la nature au sens des animaux. Du point de vue de l’homme, il est sans intérêt de savoir si la monogamie ou l’homosexualité existent chez les animaux (d’ailleurs, les animaux ne connaissent pas l’interdit de l’inceste). La loi naturelle est la loi de la nature humaine, qui dit ce qu’il est bon que l’homme fasse pour trouver le bonheur. Cette nature humaine ne s’oppose pas à la culture, car il est de la nature de l’homme de générer des cultures. L’homme a le devoir de toujours suivre sa conscience. Il ne doit pas en être empêché par les autres tant que cela ne nuit pas à l’ordre public juste. Très spécialement, l’homme doit être laissé libre de suivre sa conscience en matière religieuse, car se donner par contrainte à Dieu est indigne et de l’homme et de Dieu. Mais la conscience est marquée par le péché. Elle peut être obscurcie par des habitudes malsaines du groupe ou par l’accumulation des péchés personnels. Un enfant qui grandit dans un milieu où le vol est habituel trouvera normal de voler. Un individu qui s’est habitué à mentir n’y verra plus de difficultés. Il faut éclairer la conscience par la voix de la sagesse et l’écoute de la Parole de Dieu. C’est particulièrement la responsabilité des éducateurs, à commencer par les parents. Mais la voix de la conscience ne s’éteint jamais complètement, car elle est la voix même de Dieu. Ne desesperons jamais de personne ! Toute personne humaine est capable d’à nouveau écouter sa conscience pour revenir au Bien.
I.6 Ouverture à la transcendance
Parce qu’elle est dotée d’une conscience où Dieu lui parle, la personne est ouverte à la question religieuse. Depuis les origines, les civilisations humaines réfléchissent à la signification de l’univers, à la destinée finale de l’homme, et à l’existence de Dieu. Ces recherches ont été marquées de bien des manières par le péché mais elles prouvent que l’homme est tourné vers le transcendant. Cette ouverture à la transcendance n’est pas l’apanage d’une élite. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a manifesté combien les petits, les pauvres sont également habités du désir de rencontrer Dieu et que justice leur soit rendue. L’ouverture à la transcendance appartient à tout homme.
Voir les éclairages du Père Emmanuel Coquet
I.7 Corps, âme et esprit
L’homme est appelé à répondre selon sa liberté éclairée par sa raison à l’appel de Dieu. Il est donc responsable. S’assumer comme personne libre suppose d’exercer cette responsabilité. L’éducation doit veiller à faire naître chez les jeunes ce sens de la responsabilité. L’homme est responsable de lui-même, des autres et de l’univers. La catastrophe écologique qui nous menace
démontre ce point : l’homme a un devoir de bonne gérance sur la création qui lui a été confiée par Dieu. S’il n’assume pas ce devoir, il crée des drames dont il est la première victime. Cet exemple de la responsabilitéécologique démontre aussi que s’assumer libre ne peut pas signifier suivre ses désirs sans
frein, faire comme si l’on é tait seul au monde.
Les actes de chacun ont des répercussions sur tous. Les actes ont aussi valeur d’exemples.
Par exemple, le groupe des évêques chargé de la bioéthique a signalé que le suicide assisté ne peut pas être présenté comme un choix individuel sans conséquence pour les autres.
En choisissant le suicide assisté en raison de leur âge ou de leur maladie, les personnes font peser sur les autres malades et personnes âgées le soupçon d’être en trop, encombrantes ou trop coûteuses. Nous sommes responsables les uns des autres. En particulier, nous sommes responsables de ceux qui parmi nous souffrent le plus ou sont blessés dans leur humanité.
Nous ne pouvons pas regarder ailleurs et faire comme si cela ne nous concernait pas.
Mais l’aide indispensable que nous leur devons doit aussi respecter leur liberté et les aider à exercer leur propre responsabilité.
Notre époque a des problèmes avec la responsabilité. Elle oscille entre la tentation de déresponsabiliser l’homme, de le laisser à sa liberté abaissée au rang de caprice, et celle de désigner des boucs émissaires. D’un côté,
l’idée d’une liberté laissée seule à elle-même sans loi induit la fin de toute responsabilité devant les autres et Dieu. De l’autre, les drames qui font la une des journaux imposent qu’il y ait un responsable et commel’époque ne sait plus exercer cette responsabilité, elle revient sous des formes folles en
lynchant un individu pris presque au hasard pendant que les autres se lavent les mains de problèmes qui souvent relèvent de l’ensemble de la communauté. En réalité, la responsabilité est l’exercice plénier de la liberté.
Dieu a laissé l’homme à son propre conseil, non pour qu’il suive aveuglément
ses instincts qui ne suffisent pas à éclairer entièrement ses choix, mais pour qu’il puisse se donner aux autres et à Lui-même en toute
liberté. C’est pourquoi chacun de nous répondra de ses actes devant Dieu. L’Évangile manifeste que ce jugement dernier portera sur la conduite envers les plus petits :
« Ce que vous faites au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25, 40).
Nous ne serons pas jugés sur des performances extraordinaires mais sur notre solidarité avec les plus petits.
I.8 Scandale du mal
Le scandale du mal ne frappe pas seulement la volonte´ humaine. Plus mystérieusement, il frappe l’homme tout entier. Certains accumulent les épreuves douloureuses et déstabilisantes, ou sont frappés subitement par la maladie physique ou mentale. D’autres, dès la conception, ou par des accidents de la vie, sont marqués par le handicap. C’est pour eux et leur entourage un fardeau lourd à porter. Il est légitime de se tourner vers Dieuet de lui crier « pourquoi ? » Comme Jésus lui-même l’a fait. Hors de la Résurrection, il n’y a pas de réponse définitive au scandale du mal.
Mais par sa vie et surtout sa Passion, Jésus nous a rejoints dans ce mystère et nous aide à l’affronter dans l’espérance. Il l’a vaincu par sa résurrection et il nous promet de le vaincre totalement un jour. Il est possible aussi de
manifester sa compassion envers ceux qui sont particulièrement frappés par ce scandale.
Il arrive des situations ou‘ il n’y a plus rien de techniquement efficace a‘ faire contre le scandale du mal. Ce sont des moments spécialement difficiles pour notre époque habituée aux prouesses de la technique. Dans ces situations,
une parole, un geste, une simple présence peuvent manifester une profonde
compassion et soulager la personne. Jésus a souvent exercé ce ministère de compassion et nous a demandé de faire de même.
Les personnes frappées par l’épreuve du mal conservent toute leur dignité. Les gens qui se vouent au service des personnes handicapées témoignent particulièrement des trésors d’humanité qu’ils découvrent par là. Le coeur,
la capacité d’aimer de la personne demeure toujours intact sous les handicaps. C’est pourquoi il est important de travailler a‘ un meilleur accueil des personnes handicapées.
I.9 La Mort
La mort est l’e´nigme par excellence.
Depuis la plus haute Antiquite´ , l’humanite´
me´ dite sur ce myste‘ re, sa signification, les
moyens de le surmonter. Les diverses religions
proposent toutes leur re´ponse a‘ ce
myste‘ re. L’homme porte en lui le de´ sir de
vivre, et la mort scandalise, en particulier
quand elle frappe trop toˆt ou de manie‘ re
aveugle. Il est naturel d’en avoir peur et la
foi ne nous invite pas a‘ une inhumaine indiffe
´rence. Encore une fois, il est le´gitime de
porter ce cri devant Dieu, comme Job. Je´sus
lui-meˆme a eu peur face a‘ sa propre mort,
nous rejoignant par-la‘ dans toute notre
faibless. La mort est aussi la limite fondamentale
de l’homme. Elle se dessine derrie‘re
toutes les autres limites de l’homme. L’homme
ne peut pas tout se permettre parce qu’il mettrait
sa vie en danger. Elle lui rappelle qu’il
est un eˆ tre fini, qu’il ne s’est pas donne´ la
vie et que sa vie lui est confie´e sans eˆ tre sa
proprie´ te´ .Mais l’homme sait aussi de´passer le scandale
de la mort par le sacrifice, la mort
affronte´e librement pour de´fendre la justice
et la ve´ rite´ . Toutes les civilisations, toutes les
religions, ont connu ces cas de sacrifice, dont
la mort de Socrate est sans doute l’exemple
occidental le plus parlant. La France est
reste´e marque´e par le sacrifice du colonel Beltrame
contre la folie terroriste. Par ces sacrifices,
l’homme de´montre qu’il se sent appele´ a‘
un au-dela‘ de la mort, vers un Bien parfait.
Notre e´poque est contradictoire vis‑a‘ ‑vis
de la mort. D’un coˆ te´ , elle est e´vacue´e du
de´ bat, on n’ose plus en parler ; de l’autre,
nos fictions et jeux vide´o sont plus morbides
que jamais. Nous avons besoin de re´ apprendre
a‘ regarder la mort en face, sans complaisance
mais lucidement.
Par la re´surrection du Christ, la mort est
devenue un passage vers la vie en Dieu si
l’homme se laisse rejoindre par lui. Elle n’est
pas la fin de tout. Il est urgent de rappeler
l’espe´ rance. L’homme n’est pas fait seulement
pour cette vie-ci, il aspire au Bien supreˆme, Dieu. Il aspire a‘ la victoire de la
charite´ divine jusque dans les corps. Je´sus
reviendra a‘ la fin des temps, et ressuscitera
les morts pour que tous ceux qui se seront
laisse´s rejoindre par lui vivent de sa Gloire.
Ceux qui nous promettent « la mort de la
mort » ne nous promettent pas le bonheur
mais nous vouent a‘ une mise‘re sans fin.
I.10 Accepter sa finitude
Dieu n’appelle pas des surhommes aux performances invincibles. Il aime les hommes et les femmes que nous sommes, avec nos limites. Dans l’Évangile, c’est devant Jésus outragé et flagellé qu’est prononcée la parole «Voici l’homme» (Jn 19, 5). La dignité inamissible de l’homme n’est pas affirmée au sujet d’un héros performant au sommet de son succès, mais devant un homme affaibli. Jésus nous rejoint ainsi au cœur de toutes nos limites pour les porter avec nous dans la foi et la charité. C’est en acceptant notre finitude à la suite de Jésus Christ que nous nous accomplirons pleinement. En particulier, en manifestant notre solidarité envers ceux qui ont été blessés par la vie. Notre époque voit proliférer un culte de la performance, de la jeunesse éternelle, qui nous écrase. C’est à la fois inutile et blessant. Les faiblesses de l’homme ne s’opposent pas à sa dignité. Nier nos limites, c’est nous blesser en nous imposant un destin qui n’est pas le nôtre. C’est aussi rendre impossible la fraternité, ou la réserver à une élite de chanceux. Portons nos limites avec confiance pour nous ouvrir à une vraie réalisation de soi qui fera des merveilles.
I.11 Tout être humain est une personne
Tout en l’homme est humain. Nous ne sommes pas des animaux auxquels aurait été ajoutée une couche de spiritualité comme on ajoute un logiciel à un ordinateur. Les caractères les plus basiques de l’homme sont déjà humains. Le corps de l’homme manifeste déjà sa dignité, par sa station debout, ses mains préhensiles, la taille de son crâne et la taille de son bassin. L’homme ne manifeste pas seulement sa supériorité par la petite partie en lui qui est capable de raisonnement et de calcul. Le plaisir et la souffrance sont déjà spécifiques en l’homme. Ils s’accompagnent d’un « pourquoi ? » dans le double sens d’en vue de quoi et a‘ cause de quoi ? Par exemple, l’alimentation n’est pas chez l’homme un besoin seulement biologique. Elle s’accompagne de rites sociaux et de symboles. Le drame de la personne anorexique tient autant à sa difficulté à se tenir à table avec les autres qu’à sa difficulté à manger. S’il faut respecter la sensibilité animale, il est capital de voir qu’elle n’est pas la meˆme que celle de l’homme. En conséquence, tout être humain est une personne. Il n’est pas nécessaire de faire montre de capacités intellectuelles brillantes ou d’une vie morale dévelopées pour être une personne. Il est excellent que des méthodes toujours plus affinées permettent aux hommes de développer leur rationalité ou leur capacité de méditation, mais cela ne constitue pas des conditions pour être compte comme personne. Respectons tout être humain comme une personne, de sa conception jusqu’à sa mort naturelle. En particulier, respectons la vie de tout être humain car elle est dès l’origine porteuse de ces valeurs de la personne.
I.12 Seul l’être humain est une personne
Cre´e´ par Dieu dans l’amour et appele´ a‘ se
donner par amour, l’eˆtre humain est une personne,
tout eˆ tre humain est une personne et
dans la cre´ation visible seul l’eˆtre humain est
une personne. Tout en l’homme est humain,
l’homme est splendide y compris par son
corps. Il est ainsi capable de merveilles. La
cre´ ation de l’homme constitue ainsi le
sommet de la cre´ation, et en l’homme toute
la cre´ation trouve sa finalite´ ve´ ritable. Elle
aspire elle aussi a‘ eˆtre libe´re´e du mal qui la
frappe (Rm 8), en e´tant unie au salut de l’humanite
´ . Mais cela ne l’autorise pas a‘ nier ses
limites. l’animal n’est pas une personne et ne peut
eˆ tre e´ gale´ a‘ l’homme. Il ne partage ni sa
raison, ni sa liberte´ . L’animal ne porte pas
cette insatisfaction qui pousse a‘ rechercher
une transcendance. L’antispe´cisme, qui nie
la dignite´ supe´rieure de l’homme sur l’animal,
lance des cris d’alerte qu’il est bon d’entendre
pour prendre nos responsabilite´s face a‘ la
souffrance animale, mais se trompe dans ses
conclusions. L’homme est « la seule cre´ature
sur terre que Dieu a voulue pour elle-meˆme »
(Gaudium et Spes, 24).
L’arrive´e des robots dote´ s d’intelligence
artificielle va re´volutionner nos modes de
vie. Ce progre‘s ouvrira des possibilite´s fabuleuses.
Mais il pose aussi des proble‘mes e´ thiques
redoutables. En particulier, il n’est pas
acceptable de doter le robot d’une personnalite
´ juridique. Le robot reste toujours sous la
responsabilite´ de ses concepteurs et utilisateurs.
Il n’est pas dote´ d’un libre arbitre, il
ne s’inte´resse pas a‘ la ve´ rite´ pour elle-meˆme
mais seulement a‘ l’application de son programme.
Il est spe´cialement inquie´ tant de voir se de´velopper des robots sexuels qui pre´ –
tendent remplacer l’intimite´ d’amour avec
une autre personne humaine.
I.13 Sommet de la Création
Créé par Dieu dans l’amour et appelé à se donner par amour, l’être humain est une personne, tout être humain est une personne et dans la création visible seul l’être humain est une personne. Tout en l’homme est humain, l’homme est splendide y compris par son corps. Il est ainsi capable de merveilles. La création de l’homme constitue ainsi le sommet de la création , et en l’homme toute la création trouve sa finalité véritable. Elle aspire elle aussi à être libérée du mal qui la frappe (Rm 8), en étant unie au salut de l’humanité. Mais cela ne l’autorise pas à nier ses limites.
Partie II : Nous sommes une seule famille
II.1 Dieu a créé une seule famille
« Dieu, qui veille paternellement sur tous,
a voulu que tous les hommes constituent une
seule famille et se traitent mutuellement
comme des fre‘ res » (Gaudium et Spes, 24).
Dieu n’a pas cre´e´ l’homme seul, il a cre´e´ l’humanite
´ comme une seule famille appele´e a‘ se
construire dans la fraternite´ jusqu’a‘ ce qu’elle
soit pleinement rassemble´e dans le Christ ressuscite
´ comme un seul corps sous sa teˆ te. Ce
fait nous impose de reconnaıˆtre notre interde
´pendance et de vivre de‘ s aujourd’hui la
solidarite´ , spe´cialement envers les plus faibles
qui sont aussi nos fre‘ res. Mais ce principe est
nie´ aujourd’hui par l’invocation d’une autonomie absolue qui nous enferme dans une
solitude invivable. C’est au nom de cette
autonomie que sont sans cesse re´ clame´s de
nouveaux droits qui de´naturent de plus en
plus la transmission de la vie, comme la gestation
pour autrui[1]. L’homme n’est pas fait
pour cette solitude, nous avons besoin les uns
des autres et nous nous influenc¸ons les uns
les autres. « Tout est lie´ », re´pe‘ te le pape
Franc¸ ois (Laudato Si’). Nous faisons tous
l’expe´ rience de notre interde´pendance mais
l’individualisme actuel la de´nie et empeˆche
de la vivre sereinement. L’humanite´ doit
reconnaıˆtre qu’elle trouvera les solutions a‘
ces de´fis par la fraternite´ et la coope´ration.
[1] Nous renvoyons ici au document des e´veˆques de
France sur la bioe´thique : La Dignite´ de la procre´ation,
Paris, Bayard-Cerf-Mame, 2018.
II.2 Nous sommes interdépendants
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
(Gn 2, 18). Dieu a cre´e´ l’homme pour vivre uni a‘ toute l’humanite´ autant qu’a‘ Lui. Nous
ne sommes pas des atomes isole´ s qui choisiraient
avec qui avoir ou non des relations.
Nous sommes tous interde´pendants. Avant
de choisir de vivre la solidarite´ comme
valeur et pour la vivre selon sa ve´ rite´ ,
l’homme doit consentir a‘ ce fait de l’interde´ –
pendance. La question e´cologique, a‘ propos
de laquelle le pape a pose´ ce principe,
l’illustre : la de´ fense de l’environnement a‘
l’e´ chelle de la plane‘ te de´pend des actes de
chacun la‘ ou‘ il se trouve. Mener une vie
sobre, trier, recycler, e´ conomiser l’eau
de´pend de chacun et a des re´percussions sur
tous. C’est notre commune responsabilite´ .
Dans ce domaine tre‘ s particulie‘rement, nul
ne peut pre´tendre mener sa vie a‘ sa guise
sans se pre´occuper du prochain. Nous ne
pouvons pas comprendre le « remplissez la
terre et soumettez-la » (Gn 1, 28) de la Bible
comme l’autorisation de la saccager. Il s’agit
d’un devoir de bonne ge´ rance qui aura
des comptes a‘ rendre au vrai maıˆtre de la
cre´ation. L’interde´pendance des hommes peut aussi
se montrer par le cas de la maladie. Dans une
famille, si un membre est malade, toute la
famille est touche´ e. Toute la famille doit s’organiser
pour le soin du malade, pour mener
les taˆ ches domestiques sans lui, e´ventuellement
pour e´ viter la contagion (si le malade
est affaibli dans son syste‘me immunitaire).
S’il se trouvait dans une situation de´ja‘ pre´ –
caire, celle-ci s’aggrave. La vie sociale de la
famille est touche´ e. Mais le destin de cette
famille de´pend de la qualite´ et de la proximite´
des structures de soin. Il est des re´ gions,
meˆme en France, ou‘ l’on est mieux soigne´
que d’autres. Ces structures de soin a‘ leur
tour de´pendent de la politique de sante´ de
l’E´ tat, qui est influence´e par la crise mondiale.
Ainsi, la sante´ d’une seule personne
au sein d’une famille est relie´e par cercles
concentriques a‘ la situation de toute l’humanite
´ . De manie‘re ge´ne´rale, les situations de
pauvrete´ manifestent mieux l’interde´ pendance
des humains. L’individu qui s’est
enferre´ dans une logique de performance peut se faire croire qu’il est seul au monde. Le
pauvre, lui, manifeste combien nos destins
sont lie´ s. C’est une de ses graˆ ces. Un reˆve
d’autonomie absolue ou‘ l’individu ne rend
de comptes qu’a‘ lui-meˆme viole la ve´ rite´ de
la nature humaine et engendre une cruelle
solitude. Il fait peser sur les plus petits une
exigence inaccessible et douloureuse.
L’homme est un animal politique. Il a
besoin d’interagir avec ses semblables, de
construire avec eux une socie´ te´ juste ou‘
chacun peut s’e´panouir. Chacun de nous a
besoin d’eˆ tre reconnu par les autres comme
personne libre. Il a besoin d’aimer et d’eˆ tre
aime´ . Sa raison le pousse au dialogue indispensable
a‘ la de´couverte d’une ve´ rite´ universelle.
L’homme est aussi un eˆtre de langage.
Il a besoin de communiquer avec les autres,
de raconter son existence pour se forger une
identite´ . L’homme a besoin d’une culture
qui lui permet d’affirmer ses valeurs et de
chercher le vrai, le bon, le beau. Il est essentiel
que les projets d’aide au de´veloppement
comportent aussi des volets de de´fense de la culture des peuples conside´ re´ s. Chaque
culture, meˆme si elle a besoin de passer par
un discernement pour eˆ tre libe´re´e de ses e´ le´ –
ments de pe´che´ , est porteuse de tre´sors pour
l’humanite´ . L’e´change culturel, favorise´ par
la mondialisation, est une taˆ che essentielle
pourvu qu’il ne se transforme pas en he´ge´ –
monie d’une culture sur les autres.
Ce besoin d’interaction est spe´cialement
sensible chez les plus petits, chez ceux que
les drames de la vie privent de l’utilisation
normale des moyens de la vie sociale. C’est
toujours l’occasion d’une joie pour tous
chaque fois que nous associons les plus faibles
a‘ nos cercles.
L’homme est aussi un animal religieux.
Ouvert a‘ la transcendance, il a besoin pour
l’exprimer de symboles, de rites, de liturgie.
Or il n’existe pas de symbole ou de rite prive´ .
Le rite et le symbole supposent une communaute
´ qui se rassemble en eux. Une des e´ tymologies
propose´es de « religion » renvoie a‘
« relier ». La religion est la‘ pour rassembler
les hommes, leur donner conscience de leur interde´pendance et la vivre dans la fraternite´ .
Mais il faut pour cela que les religions s’ouvrent
encore davantage au dialogue. L’ambition
de la laı¨cite´ est de contribuer a‘ la paix
sociale en respectant chaque religion dans sa
croyance et dans son rite et en conduisant les
religions ou courants de pense´e a‘ cohabiter
sereinement au sein de la socie´te´ .
Ce besoin aussi est universel. La religion
suppose une re´flexion rationnelle, mais elle
ne peut eˆ tre l’affaire d’un cercle d’initie´ s.
Je´sus a aime´ parler aux exclus de la socie´te´
et de´montre´ que ces hommes et ces femmes
rejete´s e´taient aptes a‘ le suivre. Nos communaute
´s auront a‘ coeur de devenir des lieux ou‘
le petit se sent chez lui.
II.3 Appelés à la fraternité
L’interdépendance est d’abord une chance. Elle donne à chacun la possibilité de s’appuyer sur tous les autres. Mais comme toute réalité humaine, elle est marquée par le péché. Cette interdépendance de fait demande à être aménagée par la liberté de l’homme. Il dépend de nous d’en faire une situation d’aliénation ou au contraire l’occasion d’une fraternité. Notre époque nous donne d’extraordinaires outils pour construire cette fraternité. La mondialisation rend plus visibles et plus rapides les liens de développement entre les régions du monde. Les moyens de communication sociale permettent d’interagir rapidement avec des personnes situées à l’autre bout du monde. Cela permet d’immenses campagnes de mobilisation pour venir en aide à une région touchée par une catastrophe. Nous avons vu des chaînes mondiales de solidarité, par exemple pour notre pays après les attentats du 13 novembre 2015. La fraternité n’est pas un vain mot, elle se vit au quotidien de mille manières.
II.4 Menaces et Espérance
Mais parce que l’homme reste marque´ par
le scandale du mal, notre e´poque voit aussi de
formidables menaces contre la fraternite´. Le
progre‘s est aussi he´las le progre‘s du mal. La
mondialisation concerne aussi le crime. Il faut
citer d’abord la violence terroriste, qui est
devenue internationale et qui se pare a‘ nouveau
de l’excuse de la religion, comme si Dieu
pouvait eˆtre un Dieu de mort et non de vie.
L’attentat suicide est un sommet de de´viance
de la religion, puisqu’au meurtre il ajoute le
suicide honteusement regarde´ comme martyre.
Il faut se re´jouir de toutes les occasions
qui sont ve´cues de rejeter cette idolaˆ trie de la
violence. Il y a le fle´au du crime organise´ , qui
tue et exploite par la prostitution ou l’embrigadement
dans les re´seaux du crime, en particulier
dans certaines re´gions du monde. Il
s’accompagne du trafic mondial de drogue
avec son corte‘ge de mise‘ re et de violence.
Au Mexique et ailleurs, plusieurs preˆtres ont
paye´ de leur vie la de´nonciation de ce scandale. Il y a le de´veloppement industriel non
controˆ le´ qui pollue la plane‘te et rend malade
les populations, spe´cialement dans les pays
e´mergents. Les ine´ galite´s se sont terriblement
creuse´ es, entre individus et entre re´gions du
monde. « Nous continuons a‘ admettre en pratique
que les uns se sentent plus humains que
les autres, comme s’ils e´taient ne´s avec de plus
grands droits » (Laudato Si’, 90). Il y a les
attentats contre la vie, avortement et euthanasie,
pre´sente´s comme droits. Le sort re´serve´
aux femmes et aux enfants doit progresser
encore partout dans le monde. Nous nous
re´jouissons des re´centes prises de conscience
contre le harce‘lement sexuel. Les femmes qui
ont e´te´ pousse´es a‘ l’avortement doivent be´ne´ –
ficier d’un accompagnement mise´ricordieux
pour les aider a‘ surmonter la de´ tresse qui
accompagne souvent cet acte terrible.
L’E´ glise catholique s’est lance´ e, y compris en
France, dans un chantier de pe´nitence et de
re´formes pour combattre les abus sexuels.
Ces fle´aux, dont la liste n’est pas exhaustive,
nous appellent a‘ construire ensemble la fraternite´ . Mais la gravite´ de ces drames ne
doit pas conduire au de´sespoir. « Tout n’est
pas perdu, parce que les eˆ tres humains, capables
de se de´grader a‘ l’extreˆme, peuvent aussi
se surmonter, opter de nouveau pour le bien
et se re´ge´ne´rer » (Laudato Si, 205). Les chre´ –
tiens sauront eˆ tre exemplaires, la‘ ou‘ ils sont,
avec les moyens qui sont les leurs, dans leur
construction de cette fraternite´ . Elle commence
par des gestes simples. L’entraide en
famille, les activite´ s de paroisse comme les
maraudes ou les vestiaires solidaires, sont
un vrai fondement de la solidarite´. Meˆme
s’ils ne remplacent pas des politiques publiques
responsables, ce sont ces petits moyens,
multiplie´ s partout, qui font reculer la mise‘ re.
Ils ont aussi l’avantage de de´montrer que nul
n’est trop faible ou trop petit pour participer
a‘ l’effort de fraternite´ . Seul un esprit de pauvrete
´ permet de combattre la pauvrete´ .
Les re´seaux sociaux manifestent l’ambivalence
de la situation. Utilise´ s raisonnablement,
ils manifestent l’interde´pendance et
permettent des mobilisations rapides a‘ travers la plane‘ te. Mais laisse´s a‘ eux-meˆmes,
ve´cus dans une sorte d’addiction, ils enferment
dans des relations virtuelles qui sont
au fond la pire des solitudes et ils de´tournent
de ve´ritables activite´ s fraternelles. Ils risquent
aussi d’enfermer chacun dans des cercles
qui pensent comme lui, rendant le dialogue
difficile.
II.5 La sexualité, lieu du don de soi
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme
et femme » (Gn 1, 27). La différence sexuelle est la première altérité de l’humanité, celle qui fonde toutes les autres. La différence sexuelle n’est pas une convention sociale qu’on pourrait réérire à son gré, elle appartient à la nature humaine. Son respect est essentiel pour la construction d’un ordre social équilibré. Mais les deux sexes ont été créés pour vivre dans la communion, le respect et l’égalité. Il faut que partout dans le monde se poursuivent les efforts de libération de la femme, pour son accès aux droits civiques, à la liberté de mariage, à l’emploi avec un salaire égal. Toute forme de violence faite aux femmes est inacceptable, y compris l’excision et les autres formes de mutilation. L’augmentation du nombre de femmes participant a‘ la vie publique sera une chance pour tous.
La différence sexuelle ouvre à la sexualité. Chaque sexe est tourné vers l’autre. Vécue en vérité, la sexualité est un lieu spécial de don de soi, d’amour et de liberté. Par nature ouverte à l’accueil de la vie, elle est le lieu où l’homme et la femme vivent ensemble leur image de Dieu. « Puisque (Dieu) est en même temps le Créateur, la fécondité du couple humain est ‘‘l’image’’ vivante et efficace, un signe visible de l’acte créateur » (Amoris Laetitia, 10). La sexualité chante aussi particulièrement la beauté du corps humain. Mais le péché originel a déformé la sexualité en la transformant en lieu de désir effréné et de domination : « Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi » (Gn 3, 16). Cette déformation se manifeste aujourd’hui avec le règne de la pornographie présentée comme une norme et promesse de bonheur qui déstabilise les plus jeunes. En réalité, toute personne humaine porte le désir d’une relation stable avec un partenaire aime´ pour lui-meˆme. Il existe dans la famille humaine une diversité d’inclinations sexuelles. Il ne faut pas discriminer les personnes homosexuelles.Les violences physiques ou verbales contre elles sont intolérables. L’Église catholique invite à les accueillir et les accompagner dans leur chemin vers Dieu. Mais il n’est pas possible de mettre les relations homosexuelles sur le même plan que la relation de l’homme et de la femme.
II.6 Fécondité et famille
L’enfant est comme l’incarnation de l’amour de ses parents. Il ouvre celui-ci à une nouvelle dimension et leur donne la joie d’être éducateurs d’une liberté. Il leur fournit l’occasion de donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’ensemble des soins qu’ils lui prodiguent. Il offre à leur liberté un champ d’action particulièrement beau. L’enfant est don de Dieu. Toute naissance est une occasion d’action de grâces. Les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant ont besoin d’être accompagnés pour qu’ils puissent découvrir qu’il existe d’autres fécondités. Mais l’enfant ne saurait être un droit ouvrant à des technologies toujours plus sophistiquées qui s’accompagnent de destruction d’embryons. L’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle. Jésus est né dans une famille, c’est là d’abord qu’il a vécu son incarnation, offrant à toutes les familles une grâce spéciale. La fécondité du couple fonde la famille. Celle-ci est le premier cercle de l’interdépendance des hommes. Elle déploie une intimité très particulière. Pour les enfants, elle est le premier lieu où découvrir la valeur de la solidarité. En particulier, les enfants se découvrent en dette de la vie vis-à-vis de leurs parents et la fraternité de sang est la première de toutes les fraternités. Les parents ont une spéciale responsabilité dans l’éducation des enfants et doivent pour cela bénéficier d’une vraie liberté, en particulier dans le choix de la scolarité. La société doit aider les parents mais n’a pas à se substituer à eux dans la mission d’éducation. Pendant des millénaires, la pente de l’humanité a été d’avoir des enfants pour se survivre. La foi en la Résurrection nous a libérés de cette nécessité. Jésus vient transformer les familles pour les faire devenir une communion de personnes unies dans le respect et dans l’amour. La famille est le premier cercle de la société. Il est essentiel à la bonne santé des sociétés qu’elles favorisent la famille. Les communautés catholiques sont invitées à devenir des lieux où‘ les familles se sentent chez elles, accompagnées dans leurs joies, soutenues dans leurs difficultés. Il faut que les politiques publiques soutiennent les familles, que les infrastructures collectives les aident à vivre (avec des places en crèche suffisantes par exemple), que les mères au travail soient aidées. Notre époque voit un nombre grandissant de familles blessées. Les communautés catholiques auront à cœur d’accompagner ces situations, sans jugement, avec miséricorde, en voyant où en sont les personnes et en rendant grâce pour les trésors de charité qui se vivent souvent dans ces situations blessées.
II.7 L’unique famille humaine
Créée par Dieu pour être rassemblée dans la charité par le Christ, unie par des liens de sang autant que par des liens spirituels émanant des cultures, l’humanité est une seule famille appelée à vivre la fraternité et la solidarité. Elle en est capable malgré les défis qui la menacent. Chacun, à sa place et avec les moyens qui sont les siens, par Jésus-Christ, peut contribuer à cette tâche. Personne n’est en trop dans l’oeuvre de fraternité. Cela se vit d’abord dans les familles qui sont le premier lieu où apprendre la solidarité. La famille doit donc être défendue contre les attaques des idéologies. L’Église souhaite prendre sa part dans cette défense et cet accompagnement des familles pour leur donner de vivre cette fraternité. Mais la famille est destinée à s’ouvrir à plus grand qu’elle. La solidarité doit atteindre les limites de l’humanité. À l’heure de la mondialisation, il est plus mortifère que jamais de rêver que chaque nation se replie sur elle-même en cherchant l’autarcie. Aucune nation ne peut plus trouver en elle les moyens de faire face aux défis du temps. Les menaces contre l’humanité appellent une réponse commune. La voie du dialogue et de la coopération internationale est la seule possible. A fortiori, les diverses discriminations qui divisent l’humanité en désignant des sous-hommes sont intolérables. Chaque personne humaine a le droit de trouver sa place dans la famille humaine. Luttons pour que chaque homme soit reconnu comme un frère.
Conclusion
Dieu a créé l’homme à son image et ressemblance pour se l’unir dans l’amour. Il en a fait une personne relationnelle comme Lui, il l’a créé beau, libre, apte à la vérité, constituant une seule famille interdépendante appelée à la fraternité. Il l’a appelé à l’amour. Chacun d’entre nous, écoutant sa conscience et aidé par Dieu, se verra capable de déployer cette fraternité envers tous. En particulier en pensant préférentiellement aux plus petits. C’est le chemin du bonheur. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour bénir et fortifier cet effort et associer l’homme au salut.
Finalement, au dernier jour Jésus vaincra la mort et rassemblera en lui toute la création et tous ceux qui l’auront accepté en le confessant ou en suivant leur conscience. C’est notre vocation ultime, qui porte toutes les autres. « En aimant, [le chrétien] devient lui-même un membre, et il est inséré par l’amour dans l’unité du corps du Christ : et il y aura un seul Christ s’aimant lui-même » (Saint Augustin,
Commentaire de la première Épître de saint Jean, X, 3).
Postface de Mgr Batut : « Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? »
 « Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. » La célèbre réflexion de Pascal rejoint dans son début l’interrogation du psaume 8, mais elle la prolonge avec l’accent déjà contemporain d’une humanité qui n’ose plus croire que quelqu’un pense à elle. Mesurant plus que jamais, grâce aux progrès des sciences, l’immensité de l’univers qui l’entoure, ce « milieu entre rien et tout » s’appréhende lui-même sur fond d’angoisse existentielle plutôt comme un néant que comme un tout – une « poussière d’étoiles » selon le mot d’Hubert Reeves.
« Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. » La célèbre réflexion de Pascal rejoint dans son début l’interrogation du psaume 8, mais elle la prolonge avec l’accent déjà contemporain d’une humanité qui n’ose plus croire que quelqu’un pense à elle. Mesurant plus que jamais, grâce aux progrès des sciences, l’immensité de l’univers qui l’entoure, ce « milieu entre rien et tout » s’appréhende lui-même sur fond d’angoisse existentielle plutôt comme un néant que comme un tout – une « poussière d’étoiles » selon le mot d’Hubert Reeves.
Mais lorsque cette même humanité regarde le microcosme où elle vit, elle s’aperçoit que loin de grandir en humilité en réfléchissant sur elle-même, elle n’a cessé d’agir avec démesure au point d’épuiser les ressources de la « maison commune »[1] où elle a été placée : depuis la révolution industrielle, dans son désir insatiable de profit et de confort, l’homme est devenu un danger pour son environnement. Désorienté et perdu à l’échelle de l’univers, il doute de lui-même à l’échelle de son milieu vital, jusqu’à douter de l’opportunité de prolonger son existence. Qu’est-ce que l’homme ? Un prédateur et un meurtrier qui n’est pas digne de vivre, affirment certains aujourd’hui.
Par avance pourtant, la Parole de Dieu a mis l’homme en garde contre sa démesure, tout en le rassurant devant sa petitesse. Le choix de Dieu, dans sa toute-puissance et son éternité, a été de créer l’univers. Au sein de sa création, il a voulu entrer en alliance avec un être dans lequel est imprimée sa propre image. Et, pour parachever cette alliance, il a voulu connaître la vie de cet être de la naissance à la mort, afin de le racheter de la mort et de lui communiquer sa propre vie. La question du psaume « qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » retrouve dans le Christ toute sa pertinence et débouche sur un étonnement émerveillé : « Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ! Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds ! »
Le pouvoir de l’homme sur la nature, envers de l’humilité de sa condition, n’est pas un pouvoir discrétionnaire. C’est une gérance, une intendance – mieux : une mission, celle de parachever l’œuvre de Dieu. En comprenant cela, nous percevons la signification de l’univers. Dans le Christ, révélateur du Père, nous découvrons que le cosmos a été voulu paternellement et que son accomplissement ne peut être que filial. L’alliance nouée avec l’humanité nous apparaît comme la transposition dans le temps de l’échange éternel du Père et du Fils. La vie terrestre de Jésus devient le paradigme de cette vie filiale et fraternelle qui déploie jusqu’au bout en nous le goût de vivre, la joie d’habiter cette terre et de contribuer, en y vivant la charité, à la faire passer en Dieu. « Elle passe, certes, la figure de ce monde déformée par le péché ; mais, nous l’avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l’homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ… La charité et ses œuvres demeureront et toute cette création que Dieu a faite pour l’homme sera délivrée de l’esclavage[2]. »
La foi chrétienne n’en est qu’à ses débuts. Et pour dire l’amour de Dieu, l’éternité sera courte.
[1] Pape François, encyclique Laudato sì sur l’écologie : « Notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. »
[2] Vatican II, Constitution Gaudium et Spes sur l’Église dans le monde de ce temps, 39.