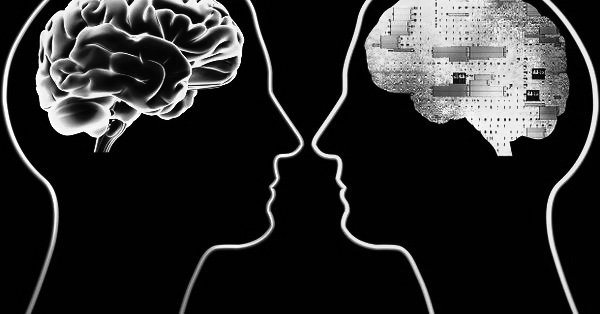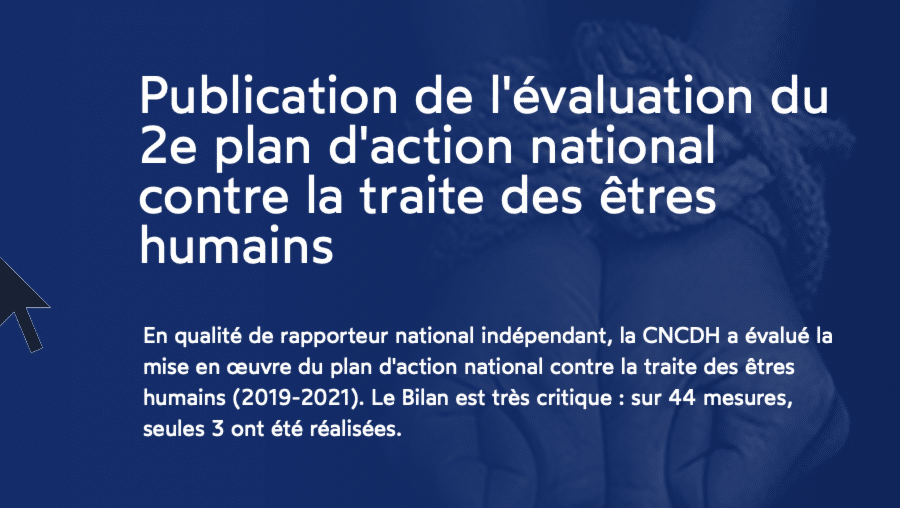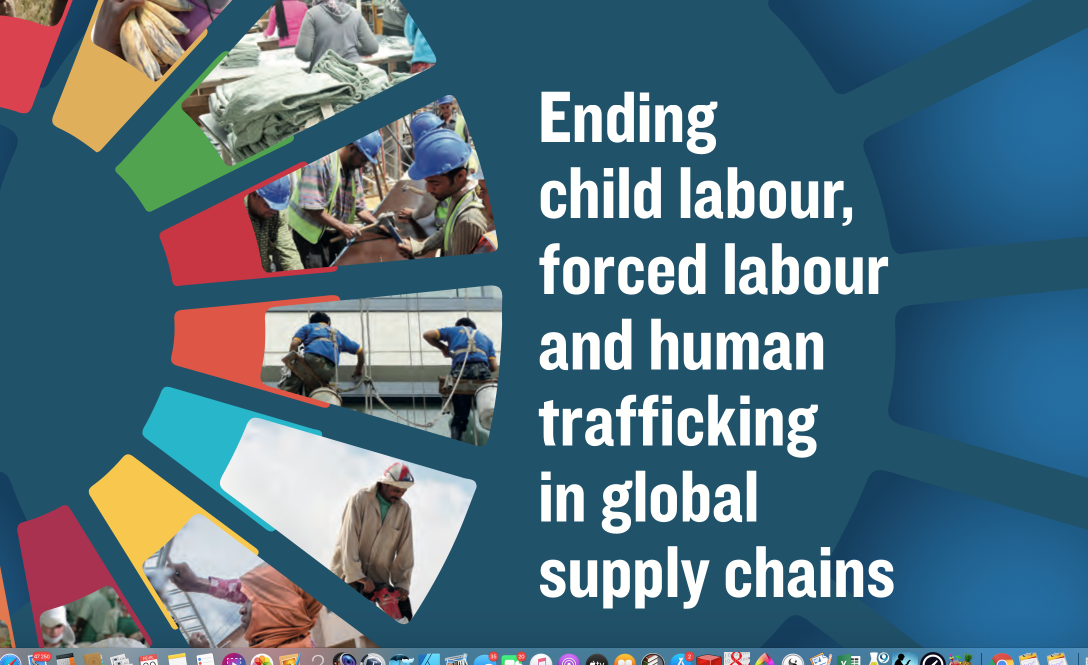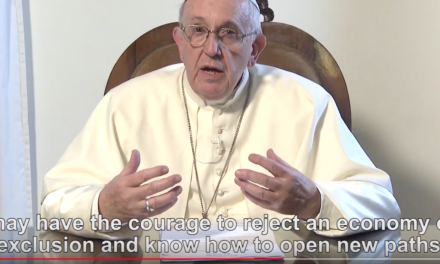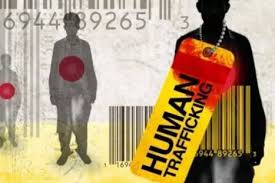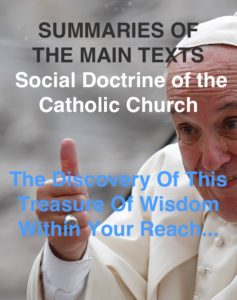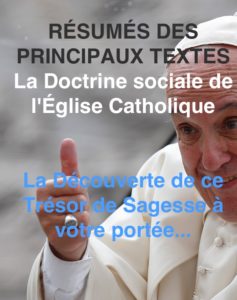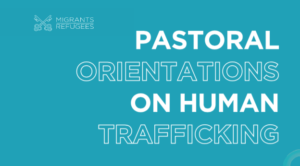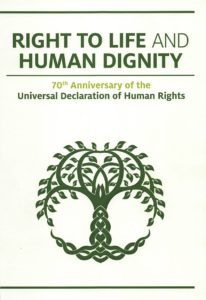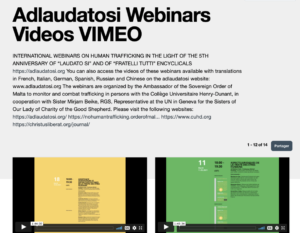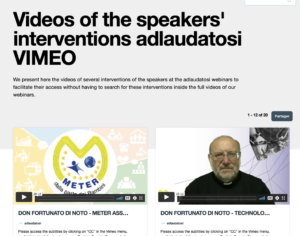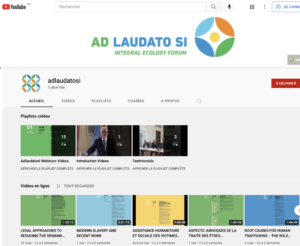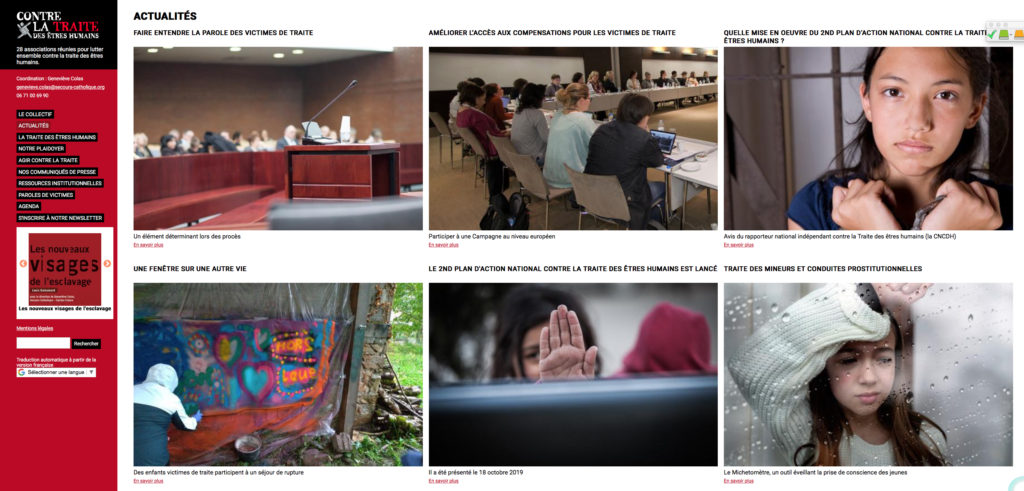Le professeur Philibert Secretan a été Professeur de philosophie dans les universités de Fribourg et de Genève en Suisse. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la réalité, la pensée et le sens de la philosophie.
Réflexions sur l’intelligence artificielle
Nature et artifice
Par le Professeur Philibert Secretan
II. Répliques au transhumanisme
VII. Intelligence artificielle et humaine
IX. Regards sur un auteur controversé : Yuval Noah Harari
1. Introduction
Je commencerai par faire miennes quelques remarques d’un ami espagnol :
« Aujourd’hui on ne dira plus qu’il n’y a pas de Dieu, mais que c’est une construction de notre cerveau, de notre réseau neuronal ; qu’en plus, nous savons quelle est la région du cerveau où s’élabore cette invention, car nous pouvons le détecter dans les stades de l’exaltation mystique. Et cela seules les neurosciences le savent, si ce n’est pas aujourd’hui ce sera demain.
» La raison a l’épaisseur de la chair. Car rien de ce que nous sommes n’est extérieur à notre être de chair, de notre chair humble et humide, y compris évidemment, le réseau neuronal et les synapses chimiques et électriques. Rien en nous, ni ce que nous pensons et disons, ni ce que nous faisons, n’est déconnecté des humeurs de notre corps. Seule la science de la logique serait une science sèche, car elle se construit en abstrayant tout ce qui n’est que lien de propositions ; liaisons évidemment essentielles dans la construction de la sphère des ordinateurs.
En résumé, nous pouvons dire que la raison n’est pas linéaire, purement analytique et logicienne, mais qu’elle a l’épaisseur d’un réseau de compossibilités en recherche d’une cohérence pour atteindre la vérité, et donc le bien, ce pourquoi ce qui est définitivement nôtre est la réalité qui se donne à nous. Réseau de compossibilités, c’est-à-dire : la conjonction rationnelle de lignes de pensée, d’action et de vie de notre chair, qui convergent dans des réalités et confluent vers une réalité fondatrice. Le pas à faire entre l’étant — siendo— et l’être — ser— relève de l’effort métaphysique du philosophe… La raison ne se résume pas à un savoir [de l’étant] ; elle a une ouverture essentielle sur la volonté, c’est-à-dire sur le désir [d’être][1].
II. Répliques au transhumanisme
Plusieurs thèmes porteurs vont se trouver associés dans un ensemble de réflexions suscitées par ce qu’il convient d’appeler le transhumanisme, c’est-à-dire la perspective d’un couplage entre l’homme et des artifices qui permettraient le passage de l’homme à une manière de surhomme. Une reconnaissance clairvoyante, même sommaire, des neurosciences, de la robotique et de l’intelligence artificielle devrait suffire à l’encrage critique d’une réflexion métaphysique.
Dépasser l’homme
Dépasser l’homme peut signifier deux choses : Faire évoluer l’homme dans sa condition actuelle vers une condition meilleure : faire vivre l’homme plus longtemps avec moins de maux, ou changer le statut de l’homme dans l’ensemble des vivants ; de l’humain traditionnellement placé entre l’ange et la bête (Pascal), dont il partage d’une part le corps et d’autre part l’esprit, mais en assumant le corps dans la sphère de l’esprit et en inscrivant l’esprit dans la réalité physique du corps.
Pascal a la sagesse d’écrire que l’homme n’est ni l’un ni l’autre, mais ne dit pas expressément qu’il est un vivant, ni que la vie se manifeste tant dans le corps que dans l’esprit. Mais lorsqu’il affirme : « Descartes faux et inutile », je vois cette fausseté non pas dans le cogito, effectivement porteur d’une vérité première, mais dans la séparation de l’homme en deux « natures » : le corps physique et l’esprit pensant, en deux régions hétérogènes de l’être ; plus tard en deux types de sciences. Un dualisme généralisé se répand alors, non sans continuellement rechercher les points de jonction, des interfaces, entre les deux hémisphères ; ou non sans tenter de les réduire l’une à l’autre dans un idéalisme ou un matérialisme à chaque fois totaux et unifiants.
Le vivant
La vie se cache-t-elle sous le terme de l’âme, sous les figures de l’animation du corps, de la sensibilité vive, de l’intelligence qui donne après avoir reçu, de l’esprit qui crée, se révolte ou se soumet. Je le pense et le crois. Or, cette vie profonde, lorsqu’elle est niée, laisse un corps à l’état de machine, une sensibilité à l’état de réponses à des stimuli, l’intelligence à l’état d’un formalisme algorithmique, l’esprit à l’état d’un en-soi virtuel.
Mais la vie ainsi manifestée est irréductible à l’une au l’autre de ses manifestations. Elle n’est ni purement biologique, ni essentiellement psychique. Elle est concrètement et par définition en chaque vivant. En ce sens, elle est à la fois universelle et concrétisée en tout vivant. Aristote appelle l’homme un zoon, un vivant animé, logon echon, doué de parole et d’entendement.
Il faudra longtemps pour que se dégage la première idée moderne : celle de l’individu, mais alors encore chargée du préjugé que cette logicité et cette raison qui font l’homme est individué par le corps.
La troisième étape fut de reconnaître tout le sens de l’individua persona, d’un être indivis et indivisible ; d’un être qu’il ne faut pas diviser et qui doit précisément vivre par lui-même une dualité de personnalité et de rationalité qu’aucun artifice ne saurait ni nier ni imiter.
III. Vie et singularité
La vie ne se laisse pas enfermer dans le couple matière/forme qui vaut autant pour le vivant que pour la machine, et dont l’usage peut conduire à de graves erreurs. La vie n’est ni un substrat matériel ni une forme abstractible ; elle n’est pas simplement un ensemble de faits biologiques qui sollicite primairement un travail d’abstraction, ni le côté dynamique des algorithmes à quoi tout est censé se réduire.
Dès lors donc qu’un artifice se présente exclusivement comme un substrat matériel mis en forme, voire qu’il s’immatérialise en énergie pour accéder à une formalité purement opératoire, on en a exclu la vie profonde qui justifie de l’assimiler à du vivant, et encore moins à de l’humain. Car c’est sur fond de vie qu’il faut parler d’un « indivis » unique, réel sous la double espèce du corps et de l’esprit, mais et dont on connaît toujours mieux l’organe où se compénètrent le corps et l’esprit, à savoir le cerveau humain.
On doit pourtant souscrire à ce qu’affirment deux spécialistes de la robotique et de l’intelligence artificielle : « La biologie n’a actuellement rien à dire sur l’individuation ou la singularité du cerveau qui soutient nos différences individuelles. Les neurosciences n’ont pas d’outil théorique et surtout expérimentaux pour capturer, identifier ces différences biologiques et fonctionnelles dans des cerveaux qui semblent (…) obéir à un patron d’organisation univoque. Le paradoxe est là : au sein d’une espèce comme la nôtre, le déterminisme biologique doit permettre la reproduction précise, entre les générations, d’une organisation très homogène, telle que le cerveau. Car nous accomplissons tous de manière homologue des gestes répétitifs et nous éprouvons et quasi identiques et éprouvons des sentiments ou avons des pensées qui peuvent se ressembler. Mais à l’intérieur de cette enveloppe commune, nous sommes tous singuliers et uniques, surtout sur le parcours d’une vie entière. »[2]
Or, cette singularité et cette unicité appellent à se demander : Ont-elles un principe qui le rende inimitable ?
IV. L’esprit
Contre toute une tradition qui fait de la matière le principe d’individuation, j’admets que c’est l’esprit qui est le plus fondamental principe d’individuation. L’ange, esprit pur, est aussi à chaque fois unique en son essence, dit la scolastique. Cette unicité de l’esprit se communique au vivant, d’autant plus singulier qu’il est spirituel. Le spirituel n’est pas universel, comme le pensait Hegel. On ne parlera de l’universel qu’en termes de concret ou d’abstrait. L’univers est d’abord l’universel concret de la nature matérielle, forme de la vie ; l’universel abstrait et ce que l’intelligence dégage du concret comme correspondant à des lois de configuration que Kant a eu raison d’attribuer à la raison appelée pure.
Entre intelligence et raison, il y a la différence d’une ordination au cosmos et la capacité de schématiser le réel au point de le rendre calculable. Or seule cette faculté rationnelle est imitable, et cela uniquement dans les limites du traitement combinatoire de données, mais pas comme l’intelligence logicienne ou intuitive qui la sous-tend.
Est enfin universel ce qui est commun à tous, mais sans que cette communauté englobante ne démente la concrétude matérielle des choses, ni la formalité de l’intelligible, ni la singularité de chacun.
Or ce statut de singularité est inimitable par un artifice. Celui-ci n’est pas un héritier de l’intelligence humaine, au sens où il serait « de même nature » que son auteur. Il n’y a pas d’homogénéité possible entre l’intelligence individuelle et l’intelligence artificielle, entre l’homme et le robot. Une relation à un robot serait moins riche de sens que l’affection personnelle d’une fillette pour sa poupée. La poupée prépare à l’enfant. Être adulte, c’est remplacer la poupée par l’enfant. Ne sont imitables que certaines fonctions remplies par l’intelligence ou qu’accom¬pagne l’intelligence. En retour, on peut dire : Il faut avoir projeté sur le vivant la fonctionnalité du mécanisme pour réduire ce vivant à ce qui est un « ensemble » de mieux en mieux à même de reproduire l’ensemble de ses fonctions, donc d’imiter une manière d’autonomie. Cette réduction est aujourd’hui soutenue par l’idée que la procréation assistée par la science fait de la science la grande génératrice — et non plus la vie.
V. Nature et fonctions
Peut-être faut-il réapprendre à distinguer entre la nature d’une chose et l’ensemble de ses fonctions. Les fonctions s’observent dans leurs régularités et s’expliquent par des enchaînements de causalité. Or, la nature relève de quelque chose qu’on pourrait appeler une métaphysique négative. La nature d’une chose se déclare lorsqu’on sait ce qu’elle n’est pas. La connaître, c’est l’expliquer. C’est à cette limite que se séparent la nature et la fonction. La science a dû se défaire de l’idée de nature, qui n’est pas de son ressort. Mais son impérialisme l’a conduite à se considérer comme seul agent légitime de la vérité, ce qui l’a dangereusement distancée de la sagesse.
La sagesse est l’intelligence de l’esprit, la science est l’intelligence de la raison, dont la qualité première est effectivement la critique. Si j’évoque ici la sagesse, c’est uniquement pour signaler qu’il n’a pas qu’une seule forme de l’intelligence, mais que cette diversité est celle de l’intelligence humaine qui ne saurait inclure l’intelligence artificielle. Cette nouvelle modalité de la prétendue « intelligence n’a pas droit au titre d’intelligence ». Les « capacités » de NA ne sont pas de l’ordre de l’intelligence. Et comparerait-on les capacités d’un robot et celles d’un enfant, cela ne justifierait pas d’en déduire l’intelligence du robot. Peut-être faudra-t-il attendre qu’un robot devienne « fou » pour le comparer à une folie humaine.
« L’intelligence artificielle n’est pas de l’intelligence. Aujourd’hui personne ne sait encore comment reproduire une intelligence humaine ; ce n’est pas en agrégeant des programmes spécialisés dans les jeux ou le classement d’images que nous y parviendrons. L’intelligence artificielle n’est ni plus ni moins qu’une capacité d’analyse et de traitement extrêmement rapide de grandes masses de données dans des délais très courts Une capacité dépendante d’un contenu dispensé de près ou de loin par l’homme. »[3]
VI. Intelligence et raison
C’est ici qu’il convient de réfléchir sur ce qui distingue l’intelligence de la raison. Il ne suffit pas de distinguer entendement et raison, Verstand et Vernunft, mais de voir si l’entendement comprend un moment qui dépasse la perception et la réception qui situent le sujet dans une position de passivité ; s’il y a un moment d’activité, de pénétration, que l’allemand traduit par ein — (Einsicht, Eingebung) et que le latin conserve dans l’in notamment de l’intelligence et de l’intuition. La phénoménologie est en ce sens une revanche de l’intelligence sur la raison.
La raison est essentiellement un traitement du perçu, une organisation du donné, qui valorise considérablement la règle d’organisation, la législation du discours, la police de l’esprit, comme disait Alain. En latin ratio dit effectivement la ration, ce qui revient à chacun, ce qui est proportionné à son besoin, mais c’est la proportion qui a pris le dessus, car cela relève de la mesure et est facilement la proie des nombres.
L’intelligence est vivante, la raison est abstraite, indifférente à la vie et à la mort, Ce pourquoi elle peut être artificialisée. « Intelligence artificielle » est une contradiction dans les termes. Parlons, s’il le faut, de raison artificielle, à commencer par l’invention toute pratique de Pascal, qui fut effectivement un artifice en vue d’opérations purement rationnelles. Mais ne confondons pas l’intelligence de l’inventeur, aujourd’hui le génie des ingénieurs et ce que reproduisent les robots.
Or, c’est bien là que se cache la difficulté : les robots ne sont pas capables que d’opérations rationnelles, mais ils peuvent effectivement recevoir quelque chose que l’homme, lui aussi, peut recevoir lorsqu’il entend. Le robot semble donc rejoindre l’entendement dans sa passivité réceptrice et dans les traces neuronales que laissent ces réceptions, ce qui est loin de l’intelligence donatrice. Je ne pense pas qu’un artifice puisse un jour avoir une Eingebung, une intuition donatrice de sens.
Travailler sur l’idée de raison c’est aussi s’intéresser à ce qui en fait la nécessaire valeur. En effet l’intuition est menacée d’un compagnonnage à la fois noble et dangereux : celui de l’imagination, dont Pascal dit avec une admirable précision que lui manque le sens du vrai et du faux. Est-ce à dire que l’intuition a besoin d’un autre compagnonnage : celui de la raison critique, donc de la raison qui ne fait pas que tisser des abstractions, mais qui discerne, sépare, juge et qui en ce sens soutient l’intelligence au-delà du pur acte d’intuition qui la caractérise superbement. La raison, juge du vrai et du faux ?
C’est en ce sens que nous disons de quelqu’un qu’il avait ou a raison. Cela ne signifie pas qu’il est doué d’entendement, mais qu’il voit, qu’il juge juste. La raison est alors bien ce rempart nécessaire contre les envahissements possibles d’une imagination sans règles.
Il faut raison garder signifie alors : il faut garder une distance critique jusque dans les avancées les plus audacieuses de l’intuition, ce qui est un précepte « pratique » relatif à la vie de l’esprit. Sapere aude. Ais le courage de penser. Mais qu’est-ce que le courage sans la prudence ?
VII. Intelligence artificielle et humaine
Ces multiples distinctions sont essentielles dès que des illusions sont entretenues par des contre-vérités. La prétendue intelligence artificielle ne pourra jamais rejoindre et encore moins dépasser l’intelligence humaine ; au plus va-t-on rabaisser l’homme à ce que peut la machine.
Ce qui néanmoins est vrai, c’est que les robots et les engins capables de prodiges techniques inconnus jusqu’ici vont considérablement changer non pas l’homme, mais les conditions dans lesquelles l’homme va évoluer. Mais ce n’est pas l’homme selon sa nature, mais l’homme selon sa condition qui va évoluer. Mais comment évoquer la nature en dehors de la condition ?
Le concept grec de phsisque les latins ont traduit par natura, retient l’idée de l’émergence, de la naissance et par là d’une origine, mais d’une origine qui différencie. Avoir une nature, c’est être différent de.… On s’y identifie par une nature commune. Le glissement vers l’essence est alors inévitable, et vers une nécessité d’être ceci et pas cela. Je ne crains de dire que tous ces glissements métaphysiques ont contribué à séparer la nature de sa force d’émergence, des dynamiques et de sa plasticité, qui par ailleurs ne saurait être coupée de sa durée et de sa consistance constante. Mais si l’on déplace la constance et l’invariance du côté de la nature essentielle on fixe nécessairement les variations du côté des conditions, et des conditions d’existence”, en oubliant que non seulement la nature ne se réduit pas à l’invariance essentielle et que la condition ne se réduit au circonstancie, mais conduit à sa façon vers l’idée d’établissement et de construction. L’homme est selon sa nature ni un végétal ni une machine, mais établi dans le monde, il vit dans des conditionsvariables et peut largement modifier ses conditions d’existence[4]. Un reste de réalisme fera dire aux plus honnêtes que ce sera en bien et en mal, que des règles de prudence seront à respecter, que des législations seront nécessaires qui, elles, ne seront pas du ressort de la Science.
VIII. Vérité et réalité
Ces considérations ne vont évidemment pas convaincre le scientifique qui a fait de la Science une doctrine, c’est-à-dire qui admet, en tant scientifique, qu’il n’y a de vérité et finalement de réalité qu’établies par la Science. Là est un saut ontologique majeur : non plus seulement la vérité, mais la réalité. Un saut et un renversement complet de la relation au monde, car il ne s’agit plus de tirer de la réalité du monde ce qui est proprement intelligible, mais de créer scientifiquement une autre réalité pour transformer le monde. La réalité ne s’appelle plus réalité, mais factualité, La resest remplacée par les data, les données à traiter selon des exigences scientifiques qui valent par elles-mêmes, c’est-à-dire sont déconnectées de l’intelligence qui les produites.
On comprend alors que cette science déconnectée de l’intelligence, totalement autosuffisante dans son aséité, l’est aussi de toute sagesse. De cette sagesse, qui, au moins, dans l’intelligence humaine, est une manière de « bonne police de l’esprit », d’agent qui dénonce ce que Jaspers appelle la Unvernunftder Vernunft, la déraison de la raison. Mais ici il ne suffit plus d’une vigilance critique sur l’usage de la raison, mais de la sauvegarde de l’intelligence dont la raison n’est que la part la plus apte à entrer en jugement avec elle-même. La critique est alors le moment où la sagesse spirituelle se manifeste comme sagesse intellectuelle.[5]
Qu’est-ce qu’un artifice ?
Il ne suffit pas de répondre que c’est quelque chose de fabriqué, qui donc ne pousse pas dans la nature. Mais on peut d’emblée dire que l’artifice se distingue de l’œuvre d’art qui, elle, est inséparable de la vie et de la personne d’un homme ou d’une femme doués d’un savoir-faire spécifique, et dire qu’elle le ou la « présente » avant de représenter quelque chose. Cette « femme » est un Renoir avant d’être un personnage féminin ; ce « cheval » un Marc avant d’être un animal à monter.
L’art dit abstrait veut que tel ensemble de figures géométriques soit un Mondrian, mais que ce géométrisme participe de l’abstraction qui, elle, est une opération extrêmement significative de la raison. D’une raison qui n’est plus le logos grec, ni la ratio scolastique, ni l’entendement de Leibniz.
C’est l’abstraction que fait du nombre un chiffre, qui réduit un mot à un signe, qui finalement fait surgir un univers séparé dont la mathématique est le premier gestionnaire. La déréalisation de l’abstrait débuta sa carrière avec l’admission du zéro, du 0, comme indicateur d’une opération intellectuelle, à savoir une multiplication par un nombre sélectionné arbitrairement : 1/0, lui-même multipliable indéfiniment par lui-même.
Or, arrive le moment où cette multiplication, qui est encore tributaire du multiple, du peu ou beaucoup, est à son tour abstraite dans l’équivalent non métaphysique, purement factuel, du : quelque chose et rien — en chiffres : 1/0. Mais c’est au moment où l’énergie de détente physique, pensez à un muscle ou un ressort, est remplacée par celle de la pulsion électrique que le « passe/ne passe pas » prend une valeur universelle précisément exprimée par le 1/0.
Ce que nous appelons « artificiel » est la combinaison de deux abstrac-tions : celle des opérations avec des nombres combinables et contrinables à l’infini parce qu’ils ne signifient plus qu’eux-mêmes, et celle de de la pulsion réductible à « oui ou non ».
Mais l’artifice ne prend visage de réalité qu’au moment où, malgré tout, l’énergie électronique est appliquée à des matériaux susceptibles d’être assemblés dans des reproductions qui ne sont elles-mêmes qu’à l’image des œuvres d’art. Il existe de magnifiques robots.
Lorsque l’artifice prétend imiter ou reproduire la nature ou l’œuvre d’art, il oublie complètement que l’œuvre d’art n’est justement pas une imitation, mais l’expression d’une âme, imaginative et sensible en contact de la réalité ; d’une âme que n’a pas la machine et qu’aucun robot n’aura jamais.
L’exosquelette n’est pas une autre jambe. C’est un artifice qui mobilise un membre réel qui a perdu sa mobilité naturelle. On est dans l’ordre du comme si. Tout artifice est de l’ordre du « comme si ». Comme pour l’imitation ; si pour le possible porté toujours plus loin…
S’il y a lieu d’admirer le savoir-faire des techniciens, il faut raison garder devant le monde qu’imaginent des savants que saoulent une science triomphante, fermée sur elle-même et qu’a quitté toute sagesse critique ; qui se soustrait à ce regard de l’intelligence sur la raison qu’est et reste la philosophie.
IX. Regards sur un auteur controversé : Yuval Noah Harari
Spectateur sceptique de la société et de la science américaines, Y. N. Harari s’est fait connaître par deux gros ouvrages : Sapiens et Homo deus. L’un et l’autre parlent de l’homme et de l’humanisme, pour finalement déplorer que l’homme ait trahi la nature et quitté l’ordre naturel pour imposer sa loi à la Nature. Et s’il accompagne de réflexions savantes l’évolution des sciences de la vie, c’est à la foi pour saluer une victoire sur l’humanisme et pour redouter que, encore, cet anti-humanisme ne développe de nouvelles formes de destructions de la nature. Il faut donc lire avec beaucoup d’attention, et parfois de bienveillance un peu forcée, des arguments qui risquent de perdre leur pertinence sous ‑l’abondance de quelque 900 pages d’une écriture généreuse.
Après avoir distingué trois formes d’humanisme, curieusement conformées à des idéologies englobantes appelées « religions », l’auteur avance un propos à retenir : « Entre les dogmes (individualistes) de l’humanisme libéral et les toutes dernières découvertes des sciences de la vie, s’ouvre un gouffre que nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer. Nos systèmes politiques et judiciaires libéraux reposent sur l’idée que chaque individu possède une nature intérieure sacrée, indivisible et immuable, qui donne du sens au monde et qui est la source de toute autorité éthique et politique. C’est là réincarnation [la reformulation ! (Ph.S.)] de la croyance chrétienne traditionnelle en une âme libre et éternelle qui réside en chaque individu. Depuis plus deux cents ans pourtant, les sciences de la vie ont profondément miné cette croyance. Les hommes de science étudiant les rouages intérieurs de l’organisme humain n’ont pas trouvé l’âme. Ils sont de plus en plus enclins à soutenir que le comportement humain est déterminé par les hormones, les gênes et les synapses, plutôt que par le libre arbitre — par les mêmes forces qui déterminent le comportement des chimpanzés, des loups et des fourmis. »
A la fin du volume suivant, Homo deus, les choses se précisent. Il est en train de se créer une nouvelle religion, tout aussi trompeuse et aliénante que toutes les autres : le dataïsme. Elle est issue de ce qui s’impose au scientifique comme un fait fondamental. Tout est un datum, une donnée. Non pas un donné, le fait d’un don comme le veut Jean-Luc Marion, mais une donnéede fait dénuée de toute réalité propre, sans en-soi, pur objet de traitement scientifique où l’ordinateur remplace l’homme trop imparfait pour traiter une information finalement illimitée.
Dans cette « religion » l’Esprit est remplacé par l’algorithme. « L’algorithme de départ peut être initialement élaboré par des êtres humains, mais en se développant il suit sa propre voie et va où aucun homme n’est encore allé.., et où aucun homme ne peut le suivre. » (HD 423). L’esprit souffle où il veut.
Et puis, comme toute religion, le dataïsme est naturellement dominateur et mystificateur, et par là même fondamentalement contestable :
« Il est douteux que la vie soit réellement réductible aux flux de données » (ibid). « … peut-être découvrirons-nous que, tout compte fait, les organismes ne sont pas des algorithmes. »
Ce qui, telle une arche de Noé, émerge du déluge dataïste sont des doutes relatifs à la vie et aux organismes vivants ; puis, curieusement, aux décisions, notamment économiques et politiques. Celles-ci sont-elles irréductibles, en tant que faits volontaires, à des calculs décisionnaires en oui/non ? Ou s’agit-il de sauvegarder dans les organismes sociaux quelque chose qui échappe à la nécessité algorithmique ?
Le dataïsme comprend de mieux en mieux les processus de décision, mais il se pourrait bien qu’il adopte une vision de la vie de plus en plus biaisée (ibid). « Peut-être y at-il dans l’univers quelque chose qui ne saurait être réduit aux datas. »
Ce sont des hypothèses (sceptiques ?) de ce type qui signalent que Y. N Harari, à la fois dénonce toute religion — et surtout le christianisme et le communisme — pour avoir gagné un pouvoir considérable « malgré leur inexac¬titude factuelle », et cherche à sauvegarder quelque chose. Mais ce quelque chose n’est pas l’homme sous sa modalité de homo sapiens. Ce qu’il s’agit de sauver est une relation humble de l’homme, dégradé de sa sapience, à une grande inconnue qui nous impose de nous préoccuper de l’immédiat, de nous concentrer sur la conscience de notre fragile petitesse et de regretter le mal fait aux créatures « inférieures ».
Mais faut-il simplement admettre que l’intelligence humaine est si totalement remplaçable par l’intelligence artificielle que nous nous reste que ce peu de fierté défensive ?
N’y a t‑il pas lieu de s’interroger : Si toutes les « religions » monothéistes ou monolithiques sont écrasantes par leur puissance à imposer de trompeuses convictions, n’est-ce pas le christianisme qui, en prêchant un Dieu unique, mais trinitaire et incarné donne à l’homme l’humble fierté d’avoir été rejoint et anoblie par un Dieu Père — et pas seulement Maître et Tyran remplaçable d’âge en âge ? A un homme, on l’a dit, de nature donnée et de condition variable, y compris la rencontre et l’accès à des capacités surprenantes, mais porteuses d’espoirs, et de dangers évidents, induits par des développements d’une ampleur encore insoup¬çonnée. Un homme à qui le bien et mal ne seront jamais étrangers.
Concluons avec le professeur Harari qui demande : « Qu’adviendra-t-il de la société, de la politique et de la vie quotidienne quand des algorithmes non conscients, mais hautement intelligents nous connaîtront mieux que nous — ? » (11D, 427) Quand se sera éteint le dernier astre, la dernière trace de l’esprit…
Philibert Secretan
Genève, le 22 août 2018
[1]« A. Pérez de Laborda, Una mirada al ser. Ed. Encuentros, Madrid 2013. p, 491–503
[2]Daniel Tritsch et Jean Mariani, Ça va la tête ? Belin, Paris 2018, p.138–139.
[3]Tomasso Poggio et Frédéric de Combert, in « L’homme continue d’avoir le dernier mot », Le Monde (Hors série) mars-mai 2018, Dans la tête des robots, p.33.
[4]Dans l’unité singulière de la personne, c’est l’esprit qui lie l’essence et l’existence selon des modalités qu’il n’y a pas lieu de fixer ici.
[5]L’erreur d’Auguste Comte fut de ne voir dans la critique que le côté négateur, qu’il dût remplacer par la positivité de la science, mais alors totalement tournée vers l’Être sous tous ses aspects : religieux, social, scientifique.
REFLECTIONS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
NATURE AND ARTIFICE
By Professor Philibert Secretan
Introduction
Replies to transhumanism
Overtaking the man
The living
Life and singularity
Mind & Spirit
Nature and functions
Intelligence and Reason
Artificial and human intelligence
Truth and Reality
What is a device?
Perspectives on a controversial author: Yuval Noah Harari
INTRODUCTION
I will start by making some remarks of my own from a Spanish friend:
“Today we will no longer say that there is no God, but that it is a construction of our brain, of our neural network; that moreover, we know what is the region of the brain where this invention is developed, because we can detect it in the stages of mystical exaltation. And that only neuroscience knows, if not today it will be tomorrow.
“The reason has the thickness of the flesh. For nothing that we are is external to our flesh being, our humble and wet flesh, including of course, the neural network and chemical and electrical synapses. Nothing in us, neither what we think and say, nor what we do, is disconnected from the moods of our body. Only the science of logic would be a dry science, because it is constructed by abstracting all that is only a link of proposals; obviously essential links in the construction of the sphere of computers.
In summary, we can say that the reason is not linear, purely analytical and logical, but that it has the thickness of a network of compossibilities in search of a coherence to reach the truth, and therefore the good, why what is definitely ours is the reality that is given to us. Network of compossibilities, that is, the rational conjunction of lines of thought, action and life of our flesh, which converge in realities and converge towards a foundational reality. The step to make between the being — siendo- and the being — ser- is a metaphysical effort of the philosopher… Reason is not limited to[being] knowledge; it has an essential openness to the will, that is, to the desire[to be][1].
REPLICAS TO TRANSHUMANISM
Several key themes will find themselves associated in a set of reflections generated by what should be called transhumanism, i.e. the prospect of a coupling between man and devices that would allow the passage of man to a way of superman. A clear-sighted recognition, even a summary one, of neurosciences, robotics and artificial intelligence should suffice for the critical inking of a metaphysical reflection.
OVERTAKING MAN
To go beyond man can mean two things: to make man evolve in his present condition towards a better condition: to make man live longer with fewer evils, or to change the status of man in the whole of the living; of man traditionally placed between the angel and the beast (Pascal), whose body he shares on the one hand and the spirit on the other hand, but by assuming the body in the sphere of the spirit and by inscribing the spirit in the physical reality of the body.
Pascal has the wisdom to write that man is neither one nor the other, but does not expressly say that he is a living, nor that life manifests itself as much in the body as in the spirit. But when he affirms: “Descartes false and useless”, I see this falseness not in the cogito, effectively carrying a first truth, but in the separation of man into two “natures”: the physical body and the thinking mind, into two heterogeneous regions of being; later into two types of sciences. A generalized dualism then spreads, not without continuously seeking the points of junction, the interfaces, between the two hemispheres; or not without trying to reduce them one to the other in an idealism or a materialism each time total and unifying.
THE LIVING
Does life hide itself under the term of the soul, under the figures of the animation of the body, of the living sensitivity, of the intelligence which gives after having received, of the spirit which creates, revolts or submits itself. I think it and believe it. Now, this profound life, when denied, leaves a body in the state of a machine, a sensitivity to the state of responses to stimuli, intelligence in the state of an algorithmic formalism, the mind in the state of a virtual self.
But the life thus manifested is irreducible to one or the other of its manifestations. It is neither purely biological nor essentially psychic. It is concretely and by definition in every living. In this sense, it is both universal and concretized in all living things. Aristotle calls man a zoon, a living animate, logon echon, endowed with speech and understanding.
It will take a long time for the first modern idea to emerge: that of the individual, but then still charged with the prejudice that this logic and this reason which make man is individualized by the body.
The third step was to recognize the whole meaning of the individua persona, of an indivisible and indivisible being of a being that must not be divided and that must precisely live by itself a duality of personality and rationality that no artifice can deny or imitate.
LIFE AND SINGULARITY
Life does not allow itself to be locked into the material/form couple that is as valid for the living as for the machine, and whose use can lead to serious errors. Life is neither a material substrate nor an abstractible form it is not simply a set of biological facts that primarily solicits a work of abstraction, nor the dynamic side of algorithms to which everything is supposed to be reduced.
As soon as a device is presented exclusively as a material substrate shaped, or even immaterializes itself into energy to access a purely operational formality, we have excluded the profound life that justifies assimilating it to the living, and even less to the human. For it is against the backdrop of life that we must speak of a single “undivided whole”, real under the double species of body and mind, but whose organ in which the body and mind interpenetrate, namely the human brain, is always better known.
Yet we must agree with what two specialists in robotics and artificial intelligence say: “Biology currently has nothing to say about the individuation or singularity of the brain that supports our individual differences. Neuroscience has no theoretical and especially experimental tool to capture and identify these biological and functional differences in brains that seem (…) to obey an univocal organizational pattern. The paradox is there: within a species like ours, biological determinism must allow the precise reproduction, between generations, of a very homogeneous organization, such as the brain. For we all perform repetitive gestures in a homologous manner, and we all feel and almost feel the same and have feelings or thoughts that may be similar. But within this common envelope, we are all singular and unique, especially on the journey of a lifetime. “»[2]
However, this singularity and uniqueness call us to ask ourselves: Do they have a principle that makes it inimitable?
MIND & SPIRIT
Against a whole tradition which makes matter the principle of individuation, I admit that it is the spirit which is the most fundamental principle of individuation. The angel, pure spirit, is also each time unique in its essence, says the scholastic. This uniqueness of the spirit is communicated to the living, all the more singular because it is spiritual. The spiritual is not universal, as Hegel thought. We will only speak of the universal in concrete or abstract terms. The universe is first of all the concrete universal of the material nature, form of life; the abstract universal and what the intelligence emanates from the concrete as corresponding to laws of configuration that Kant was right to attribute to reason called pure.
Between intelligence and reason, there is the difference of an ordination to the cosmos and the capacity to schematize the real to the point of making it calculable. Only this rational faculty is imitable, and this only within the limits of combinatorial data processing, but not as the logic or intuitive intelligence that underlies it.
Finally, what is common to all is universal, but without this encompassing community dismantling the material concreteness of things, neither the formality of the intelligible, nor the singularity of each one.
But this status of singularity is inimitable through artifice. He is not an heir of human intelligence, in the sense that he is “of the same nature” as his author. There is no possible homogeneity between individual intelligence and artificial intelligence, between man and robot. A relationship with a robot would be less meaningful than a little girl’s personal affection for her doll. The doll prepares the child. Being an adult means replacing the doll with the child. Only certain functions performed by intelligence or accompanied by intelligence are imitable. In return, we can say: We must have projected the functionality of the mechanism onto the living to reduce this living to what is a “whole” increasingly capable of reproducing all of its functions, thus imitating a way of autonomy. This reduction is now supported by the idea that science-assisted reproduction makes science the great generator — not life.
NATURE AND FUNCTIONS
Perhaps we need to learn again to distinguish between the nature of a thing and all its functions. The functions are observed in their regularities and are explained by causal sequences. However, nature is something that could be called a negative metaphysics. The nature of a thing declares itself when you know what it is not. To know her is to explain her. It is at this limit that nature and function separate. Science has had to get rid of the idea of nature, which is not its responsibility. But her imperialism led her to see herself as the only legitimate agent of truth, which dangerously distanced her from wisdom.
Wisdom is the intelligence of the mind, science is the intelligence of reason, whose primary quality is indeed criticism. If I mention wisdom here, it is only to point out that it does not have only one form of intelligence, but that this diversity is that of human intelligence which cannot include artificial intelligence. This new modality of the so-called “intelligence is not entitled to the title of intelligence”. NA’s “abilities” are not of the order of intelligence. And would one compare the abilities of a robot and those of a child, that would not justify deducing the intelligence of the robot. It may be necessary to wait until a robot goes “crazy” before comparing it to a human madness.
“Artificial intelligence is not intelligence. Today nobody knows yet how to reproduce a human intelligence; it is not by aggregating specialized programs in the games or the classification of images that we will succeed there. Artificial intelligence is nothing more and nothing less than a capacity for analysis and extremely fast processing of large amounts of data in a very short period of time. A capacity dependent on content delivered directly or indirectly by man. “»[3]
INTELLIGENCE AND REASON
It is here that we need to reflect on what distinguishes intelligence from reason. It is not enough to distinguish between understanding and reason, Verstand and Vernunft, but to see if understanding includes a moment that goes beyond perception and reception that places the subject in a position of passivity; if there is a moment of activity, of penetration, that German translated as ein — (Einsicht, Eingebung) and that Latin retains in particular intelligence and intuition. In this sense, phenomenology is a revenge of intelligence over reason.
The reason is essentially a treatment of the perceived, an organization of the given, which greatly values the rule of organization, the legislation of discourse, the police of the mind, as Alain said. In Latin the ratio actually says the ration, which belongs to each one, which is proportionate to his need, but it is the proportion that has taken over, because it is a measure and is easily prey to numbers.
Intelligence is alive, reason is abstract, indifferent to life and death, which is why it can be artificialized. “Artificial intelligence” is a contradiction in terms. Let us talk, if necessary, of artificial reason, starting with Pascal’s practical invention, which was indeed an artifice with a view to purely rational operations. But let us not confuse the inventor’s intelligence, today the genius of engineers and what robots reproduce.
But that is where the difficulty lies: robots are not only capable of rational operations, but they can actually receive something that man, too, can receive when he hears. The robot thus seems to join the understanding in its receptive passivity and in the neuronal traces that these receptions leave, which is far from the donor intelligence. I don’t think that a device can ever have an Eingebung, an intuition that gives meaning.
To work on the idea of reason is also to be interested in what makes it worthwhile. Indeed intuition is threatened by a companionship both noble and dangerous: that of imagination, of which Pascal says with admirable precision that he lacks the sense of the true and the false. Does this mean that intuition needs another companion: that of critical reason, therefore of reason that does not only weave abstractions, but that discerns, separates, judges and in this sense supports intelligence beyond the pure act of intuition that superbly characterizes it. The reason, judge the true and the false?
It is in this sense that we say of someone that he was or is right. This does not mean that he is gifted with understanding, but that he sees, that he judges just. The reason is then this necessary rampart against the possible invasions of an imagination without rules.
We must keep reason then means: we must keep a critical distance even in the most audacious advances of intuition, which is a “practical” precept relating to the life of the mind. Sapere aude. Have the courage to think. But what is courage without prudence?
ARTIFICIAL AND HUMAN INTELLIGENCE
These multiple distinctions are essential as soon as illusions are maintained by untruths. The so-called artificial intelligence can never reach and even less surpass human intelligence; at most man will be belittled to what the machine can.
What is nevertheless true is that robots and machines capable of technical wonders hitherto unknown will considerably change not man, but the conditions in which man will evolve. But it is not man according to his nature, but man according to his condition that will evolve. But how to evoke nature outside the condition?
The Greek concept of phsisque the Latin translated by natura, retains the idea of emergence, birth and thus of an origin, but of an origin that differentiates. To have a nature is to be different from.… It is identified by a common nature. The slide towards the essence is then inevitable, and towards a necessity to be this and not that. I am not afraid to say that all these metaphysical shifts have contributed to separating the nature of its force of emergence, its dynamics and its plasticity, which moreover cannot be cut off from its duration and its constant consistency. But if one moves constancy and invariance on the side of essential nature one necessarily fixes the variations on the side of conditions, and conditions of existence”, forgetting that not only nature is not reduced to essential invariance and that the condition is not reduced to circumstantial, but leads in its way towards the idea of establishment and construction. Man is by nature neither a plant nor a machine, but established in the world, he lives in variable conditions and can largely modify his conditions of existence[4]. A realism will make the most honest people say that it will be for good and for evil, that rules of prudence will have to be respected, that legislation will be necessary which, they, will not be the responsibility of Science.
TRUTH AND REALITY
These considerations will obviously not convince the scientist who has made Science a doctrine, that is, who admits, as a scientist, that there is truth and ultimately reality only established by Science. There is a major ontological leap: not only truth, but reality. A leap and a complete reversal of the relationship to the world, because it is no longer a question of drawing from the reality of the world what is truly intelligible, but of creating scientifically another reality to transform the world. Reality is no longer called reality, but factuality, The resest replaced by data, data to be processed according to scientific requirements that are worth by themselves, i.e. are disconnected from the intelligence that produces them.
One then understands that this science disconnected from intelligence, totally self-sufficient in its dryness, is also disconnected from all wisdom. From this wisdom, which, at least in human intelligence, is a way of “good police of the mind”, an agent who denounces what Jaspers calls the Unvernunftder Vernunft, the folly of reason. But here it is no longer enough to be critically vigilant about the use of reason, but to safeguard intelligence, the reason for which is only the part most apt to enter into judgment with itself. Criticism is then the moment when spiritual wisdom manifests itself as intellectual wisdom[5].
WHAT IS A DEVICE?
It is not enough to say that it is something that is made and therefore does not grow in nature. But one can immediately say that artifice is distinct from the work of art, which is inseparable from the life and person of a man or woman endowed with a specific know-how, and that he or she “presents” it before representing something. This “woman” is a Renoir before being a female character; this “horse” a Marc before being an animal to ride.
The so-called abstract art wants that such and such a set of geometrical figures is a Mondrian, but that this geometrism participates in abstraction which, it, is an extremely significant operation of reason. For a reason that is no longer the Greek logos, neither the scholastic ratio, nor Leibniz’s understanding.
It is the abstraction of number as a number, which reduces a word to a sign, which finally makes emerge a separate universe of which mathematics is the first manager. The derealization of the abstract began his career with the admission of the zero, the 0, as an indicator of an intellectual operation, namely a multiplication by an arbitrarily selected number: 1/0, itself multipliable indefinitely by itself.
Now comes the moment when this multiplication, which is still dependent on the multiple, the few or many, is in turn abstract in the non-metaphysical, purely factual equivalent of the: something and nothing — in figures: 1/0. But it is at the moment when the energy of physical relaxation, think of a muscle or a spring, is replaced by that of the electrical impulse that the “pass / does not pass” takes a universal value precisely expressed by the 1/0.
What we call “artificial” is the combination of two abstractions: that of operations with numbers that can be combined and controlled infinitely because they only mean themselves, and that of the drive that can be reduced to “yes or no”.
But artifice only takes on a face of reality when, despite everything, electronic energy is applied to materials that can be assembled into reproductions that are themselves only like works of art. There are beautiful robots out there.
When the artifice claims to imitate or reproduce nature or the work of art, it completely forgets that the work of art is precisely not an imitation, but the expression of a soul, imaginative and sensitive in contact with reality; of a soul that the machine does not have and that no robot will ever have.
The exoskeleton is not another leg. It is a device that mobilizes a real limb that has lost its natural mobility. We’re in the order of the as if. All artifice is of the “as if” order. As for the imitation; if for the possible carried always further…
If it is necessary to admire the know-how of the technicians, it is necessary to keep in front of the world that scientists imagine that a triumphant science, closed on itself and that has left any critical wisdom who evades this look of intelligence on the reason that is and remains philosophy.
PERSPECTIVES ON A CONTROVERSIAL AUTHOR: YUVAL NOAH HARARI
Sceptical spectator of American society and science, Y. N. Harari became known through two major works: Sapiens and Homo deus. Both speak of man and humanism, and finally deplore the fact that man has betrayed nature and left the natural order to impose his law on Nature. And if it accompanies with scholarly reflections the evolution of life sciences, it is to faith to salute a victory over humanism and to fear that, again, this anti-humanism will develop new forms of destruction of nature. We must therefore read with great attention, and sometimes with a little forced benevolence, arguments that risk losing their relevance under the abundance of some 900 pages of generous writing.
After distinguishing three forms of humanism, curiously conformed to encompassing ideologies called “religions”, the author advances a point to remember: “Between the (individualistic) dogmas of liberal humanism and the very latest discoveries in the life sciences, a chasm opens up that we can no longer afford to ignore. Our liberal political and judicial systems are based on the idea that each individual possesses an inner nature that is sacred, indivisible and unchanging, that gives meaning to the world and that is the source of all ethical and political authority. This is the reincarnation[Ph.S.] of traditional Christian belief in a free and eternal soul that resides in every individual. Yet for over two hundred years, the life sciences have deeply undermined this belief. Men of science studying the inner workings of the human organism have not found the soul. They are increasingly inclined to argue that human behaviour is determined by hormones, genes and synapses, rather than by free will — by the same forces that determine the behaviour of chimpanzees, wolves and ants. »
At the end of the next volume, Homo deus, things become clearer. He is creating a new religion for himself, just as misleading and alienating as all the others: dataism. It stems from what is imposed on the scientist as a fundamental fact. Everything is a datum, a data. Not a given, the fact of a gift as Jean-Luc Marion wants it, but a given of fact devoid of any reality of its own, without itself, pure object of scientific treatment where the computer replaces the man too imperfect to process finally unlimited information.
In this “religion” the Spirit is replaced by the algorithm. “The starting algorithm may initially be developed by human beings, but in developing it follows its own path and goes where no man has yet gone…, and where no man can follow it. “(HD 423). The spirit blows wherever it wants.
And then, like any religion, dataism is naturally dominant and mystifying, and therefore fundamentally questionable:
“It is doubtful whether life is really reducible to data flows” (ibid). “… perhaps we will discover that, all things considered, organisms are not algorithms. »
What, like Noah’s ark, emerges from the Dadaist flood are doubts about life and living organisms; then, curiously, about decisions, especially economic and political decisions. Are these irreducible, as voluntary facts, to yes/no decision calculations? Or is it a question of safeguarding something in social organisms that escapes the algorithmic necessity?
Dataism understands decision-making processes better and better, but it may well adopt an increasingly biased view of life (ibid). “Perhaps there is something in the universe that cannot be reduced to data. »
It is such (sceptical?) hypotheses that signal that Y. N Harari, both denounces all religion — and especially Christianity and Communism — for having gained considerable power “despite their factual inaccuracy”, and seeks to safeguard something. But this something is not man under his homo sapiens modality. What we need to save is a humble relationship between man, degraded from his sapience, and a great unknown person who forces us to concern ourselves with the immediate, to concentrate on the awareness of our fragile lowliness and to regret the harm done to “inferior” creatures.
But should we simply admit that human intelligence is so totally replaceable by artificial intelligence that we have only this little defensive pride left?
Shouldn’t we ask ourselves: If all monotheistic or monolithic “religions” are overwhelming by their power to impose deceptive convictions, isn’t it Christianity which, by preaching a single God, but Trinitarian and incarnate, gives man the humble pride of having been joined and ennobled by a Father God — and not only Master and replaceable Tyrian from age to age? To one man, it was said, of a given nature and variable condition, including the encounter and access to surprising capacities, but carrying hopes, and obvious dangers, induced by developments of an as yet unsuspected magnitude. A man to whom good and evil will never be strangers.
Let us conclude with Professor Harari who asks: “What will happen to society, politics and daily life when unconscious but highly intelligent algorithms know us better than we do? “(11D, 427) When the last star is extinguished, the last trace of the spirit…
Philibert Secretan
Geneva, 22 August 2018
[1]« A. Pérez de Laborda, Una mirada al ser. Encuentros, Madrid 2013. p, 491–503
2]Daniel Tritsch and Jean Mariani, Ça va la tête? Belin, Paris 2018, p.138–139.
3] Tomasso Poggio and Frédéric de Combert, in “L’homme continue d’avoir le dernier mot”, Le Monde (Hors série) March-May 2018, Dans la tête des robots, p.33.
4] In the singular unity of the person, it is the spirit that binds essence and existence in ways that do not need to be fixed here.
5] Auguste Comte’s mistake was to see in criticism only the negative side, which he had to replace by the positivity of science, but then totally turned towards Being in all its aspects: religious, social, scientific.