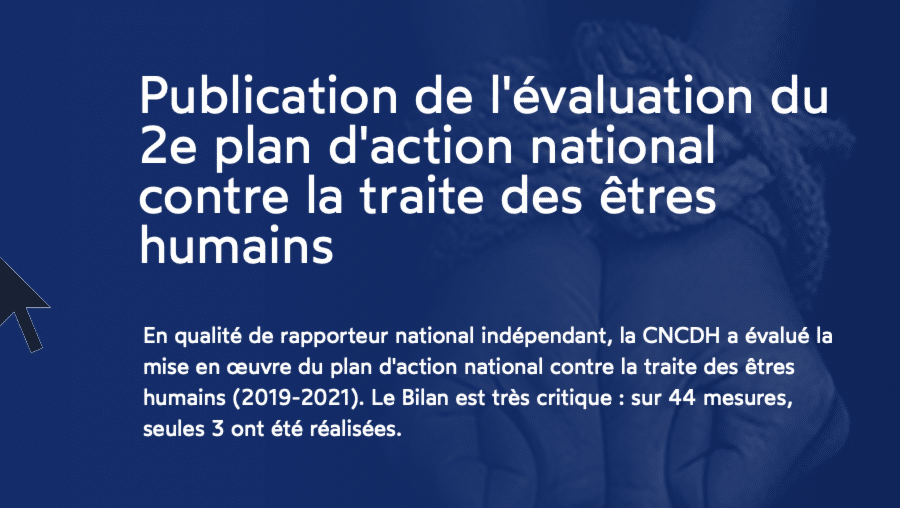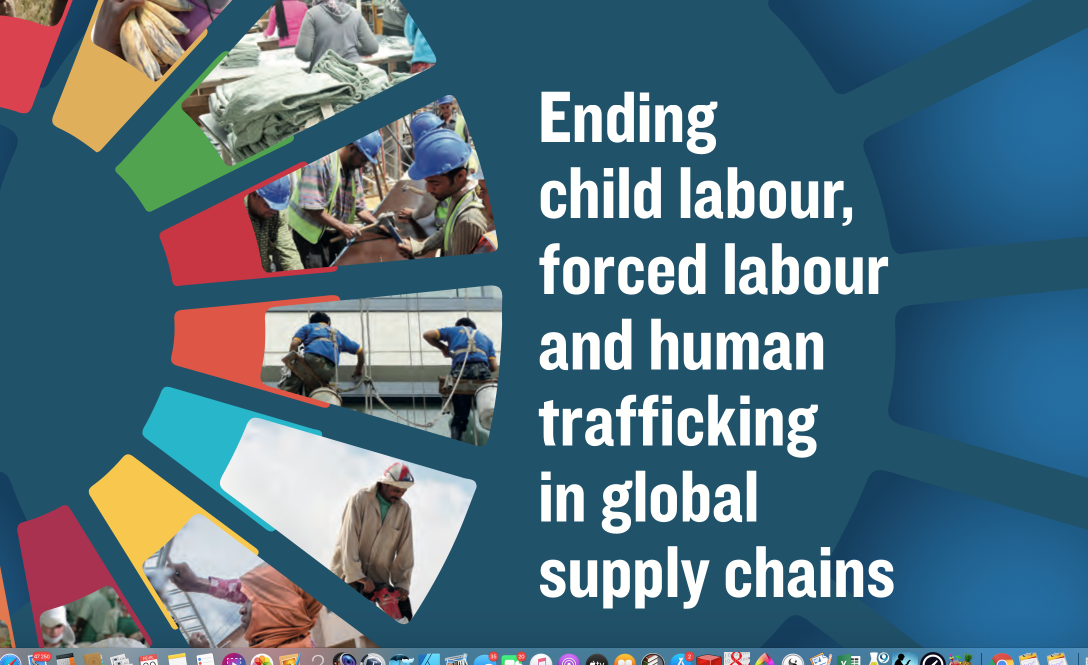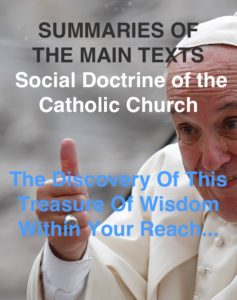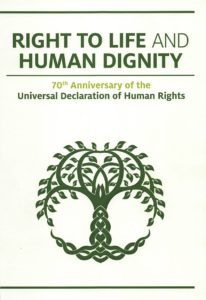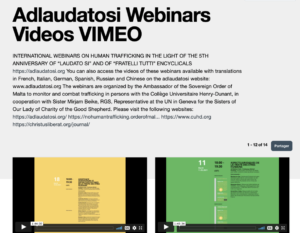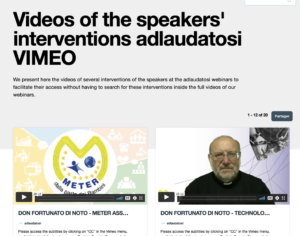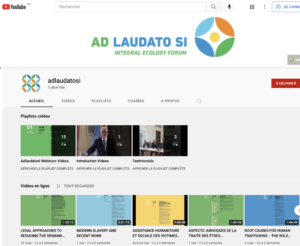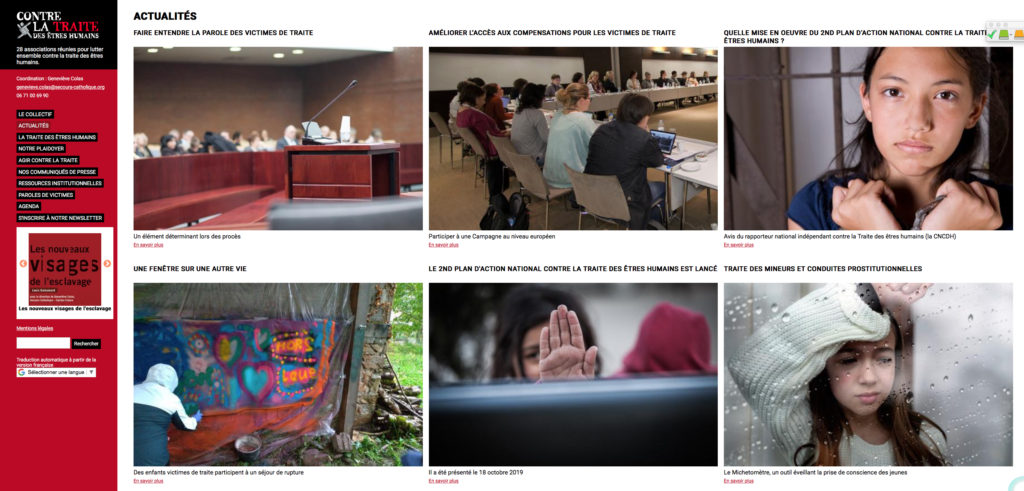La fin des temps modernes par Romano Guardini (1949)
CONCLUSION
(P. 100 à 121)
Avoir une puissance signifie être maître du donné. Grâce à elle, les effets directs de l’existant qui est en jeu et qu’il tourne contre notre vie sont désarmés et, le cas échéant, adaptés aux exigences de cette vie. C’est ce qui s’est produit à un degré éminent. Dans une large mesure, l’homme a en main les effets directs de la nature. Mais non pas l’effet indirect : cet « avoir en main » lui-même. Il a pouvoir sur les choses, mais il n’a pas — disons-le avec plus de confiance — il n’a pas encore son pouvoir en son pouvoir.
L’homme est libre et peut utiliser sa puissance à son gré. Mais c’est précisément là que réside la possibilité d’en faire mauvais usage : mauvais au sens de méchant comme au sens de destructeur. Qu’est-ce qui garantit que l’usage est licite ? Rien ! Rien ne garantit que la liberté prendra une décision juste. Ce qui peut se produire n’est que vraisemblable et ce serait que la bonne volonté devînt un état d’esprit, une attitude, un caractère. Mais l’examen sans préjugés doit — nous l’avons déjà remarqué — constater qu’une formation du caractère qui rendrait vraisemblable le bon usage de la puissance n’existe pas. L’homme des temps modernes n’est pas préparé à cette montée démesurée de sa puissance. Sur l’usage de celle-ci, il n’existe pas encore d’éthique — rigoureusement pensée et frappée au coin de l’efficacité, moins encore une éducation dans ce sens, soit d’une élite, soit de la collectivité.
Pour toutes ces raisons, le danger fondamental qui a la liberté pour origine a pris une forme pressante. La science et la technique ont rendu disponibles à un tel degré les énergies de la nature, comme celles de l’homme lui-même, que des destructions d’une étendue absolument imprévisible, aiguës ou chroniques, peuvent avoir lieu. Il est absolument exact de dire que, désormais, une nouvelle ère de l’histoire commence. Désormais et pour toujours, l’homme vivra en marge d’un danger qui menace toute son existence et qui grandira sans cesse.
Si l’on ajoute encore la considération évoquée ci-dessus et propre à nous endormir, d’une culture assurée en soi et qui crée la sécurité, on voit à quel point l’humanité d’aujourd’hui est peu préparée à administrer l’héritage que représente la puissance acquise jusqu’ici. À tout moment, la situation peut la renverser. Et non seulement les éléments sans force en elle, mais aussi et surtout, précisément, les éléments actifs, les conquérants, les organisateurs, les chefs. Dans les deux précédentes décades, le premier exemple monstrueux nous en a fait faire l’expérience, mais il semble que trop peu de personnes l’aient réellement compris. Sans cesse, l’impression s’impose que le moyen par lequel on vient à bout des problèmes qui montent comme un flot, c’est, en dernière analyse, la violence. Mais cela signifierait que le mauvais usage de la puissance devient la règle.
Le problème essentiel, autour duquel tournera la future tâche de la culture et dont la solution commandera tout, non seulement le bien-être ou la misère, mais la vie et la mort, c’est la puissance. Non pas pour l’intensifier, cela ira de soi, mais pour la dompter et en faire bon usage.
Les forces chaotiques primitives sont vaincues : sous sa forme immédiatement donnée, la nature obéit. Mais elles réapparaissent au sein de la culture elle-même et leur élément est, précisément, ce qui a vaincu les forces primitives : la puissance elle-même.
Dans ce second déchaînement chaotique, tous les abîmes des origines se sont rouverts. Voici, de nouveau, l’envahissement désordonné des forêts meurtrières. Tous les monstres des solitudes, tous les effrois des ténèbres sont revenus. L’homme se trouve de nouveau en présence du chaos, et c’est d’autant plus terrible que la plupart des hommes ne le voient absolument pas, parce que l’on entend partout discourir des gens qui ont une formation scientifique, que des machines sont en action et que des administrations fonctionnent.
Peut-être ce qui précède a‑t-il montré plus clairement pourquoi nous nous sommes demandé si nous ne devions pas employer le terme de « culture non-culturelle ». Si ce que l’homme des siècles passés a produit, en quoi il s’était établi, était une culture, ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui est effectivement quelque chose de différent, dont la sphère existentielle est autre ; autre est son caractère et autre ce qui en dépend.
La vertu dominante sera avant tout le sérieux qui veut la vérité. Peut-être nous est-il permis d’en trouver les symptômes dans l’objectivité dont on voit maints indices. Il veut savoir ce qui est réellement en jeu à travers tous ces bavardages sur le progrès et la connaissance totale de la nature, et il prend la responsabilité que lui impose la nouvelle situation.
La deuxième vertu sera la force. Une force sans pathétique, spirituelle, engageant la personne, et opposée au chaos menaçant. Elle devra être plus pure et plus intense que celle qui est exigée devant les bombes atomiques et les engins semeurs de bactéries, car il lui faudra se mesurer a l’ennemi universel : le chaos qui monte — dans — l’œuvre humaine elle-même et, comme toute force réellement grande, elle aura contre elle le nombre, l’opinion publique, les contre-vérités condensées dans les slogans et les organisations.
Et en troisième lieu : la liberté devra s’y ajouter. La
liberté intérieure à l’égard de la violence qui exerce son emprise sous toutes les formes ; à l’égard des puissances de suggestion par la propagande, là presse, la radio et le cinéma, à l’égard du désir de puissance, de son ivresse et de son caractère démoniaque qui agissent jusque dans les domaines spirituels. Cette liberté ne peut être acquise que par une véritable éducation, extérieure et intérieure. Et par l’ascèse. Devant l’ascèse, le sentiment des temps modernes était tout d’aversion, elle était comme la synthèse de ce dont ils voulaient se libérer. Mais précisément par là, ils se sont intérieurement abandonnés, au sommeil, livrés à eux-mêmes. Par la lutte contre soi et le renoncement, l’homme doit apprendre à se maîtriser et, par là aussi, à maîtriser sa propre puissance. La liberté, ainsi acquise s’appliquera alors sérieusement aux options réelles, tandis qu’aujourd’hui nous voyons traiter, des billevesées avec une gravité quasi métaphysique. Elle transformera le simple courage en force véritable et démasquera les héroïsmes illusoires au : Imnn desquels l’homme d’aujourd’hui, envoûté par des absolus illusoires, se laisse sacrifier de tout cela, il faut que naisse finalement un art spirituel de gouvernement dans lequel la puissance régnera sur la puissance. Il distinguera le juste du faux, le but et les moyens. Il trouvera la mesure et créera dans l’effort du travail et du combat une sphère où l’homme pourra vivre avec dignité et joie. C’est cela seulement qui sera la véritable puissance.
J’espère avoir montré qu’il ne s’agit pas ici de pessimisme. Ou, pour mieux dire, d’un faux pessimisme, car il en existe aussi un juste sans lequel rien de grand ne se fait. Il est la force amère qui rend le cœur fort et l’esprit créateur capables de faire œuvre durable.
Ce pessimisme devrait certes être représenté. Il faudrait montrer la seule et véritable option qui est à l’arrière-plan des nombreuses options « particulières telles qu’elles s’imposent partout. Ces possibilités sont ou bien la fin par la destruction intérieure comme extérieure — ou bien une nouvelle forme du monde où vivrait une humanité consciente de ce qu’elle signifie et ayant des possibilités d’avenir.
On ne s’interrogera pas ici sur la nature et le caractère de cette forme du monde. Si l’on rapprochait les divers indices qui se montrent un peu partout, si l’on étudiait les particularités des formes et des structures en devenir et si l’on essayait de comprendre les motifs et les attitudes
en action, il y aurait certes beaucoup de choses à dire. Mais elles dépasseraient le cadre de cet opuscule et nous les remettrons à une autre occasion.
Les temps qui viennent…
En partant de ce qui a été exposé, il nous est possible aussi de nous exprimer quelque peu sur la religiosité des temps qui viennent, avec toutes les réserves que la situation impose à de tels propos.
Jetons encore un coup d’œil en arrière.
Au moyen âge, la vie était pénétrée de religion dans toutes ses couches et toutes ses ramifications. La foi chrétienne constituait la vérité universellement admise. La législation, l’ordre social, la morale privée comme la morale publique, la pensée philosophique, le travail artistique, les idées qui soutenaient l’histoire — tout était en quelque sorte caractérisé par le christianisme et l’Église. On n’entend pas par là porter un jugement sur la valeur humaine ou culturelle de telle ou telle personnalité, de telle ou telle réalisation, mais même la façon dont une injustice était commise était encore soumise à une norme chrétienne. L’Église était unie à l’État de la façon la plus étroite, et même où l’empereur et le pape, le prince et l’évêque vivaient en mauvaise intelligence, s’accusaient l’un l’autre et se maudissaient réciproquement, l’Église en tant qu’Église n’était pas mise en question.
Il faut y ajouter un second élément. La foi chrétienne représente un lien de la personne avec le Dieu révélé. Elle trouve son accomplissement selon la pureté et la fidélité de cet attachement. Mais c’est une question différente de savoir jusqu’à quel point l’homme est capable de faire l’expérience d’une réalité religieuse, en général, dans quelle mesure il sent vivante sa relation avec le divin et si cette relation agit directement dans sa vie. Au moyen âge, ces rapports étaient très directs, l’expérience religieuse très intensément développée, d’une grande profondeur et d’une grande délicatesse. Toutes les choses et tous les rapports de la vie étaient saturés de valeur religieuse. La poésie et l’art, les formes de l’Etat, de la société et de l’économie, les usages, les légendes et la vie des saints prouvent que, même indépendamment de leurs contenus respectifs, l’existence entière avait un caractère religieux. À ce point de vue, le moyen âge se rattachait étroitement à l’antiquité qu’il prolongeait et même aux temps primitifs de l’histoire : l’afflux de vie qu’avaient apporté les peuples jeunes du nord au moment des : grandes migrations et manifestait en lui. Cette aptitude religieuse représente d’abord un élément différent de la piété chrétienne, de même que ce qu’elle permet de saisir dans les choses et les événements est différent du contenu de la Révélation. Mais entre ces deux domaines d’expérience, un rapport existe. La religiosité naturelle est purifiée par la Révélation I et accueillie dans l’ensemble de ses significations. De son côté, elle apporte à la foi chrétienne des forces primitives, des éléments du monde et de la vie grâce auxquels les contenus de la Révélation sont rapportés à la réalité terrestre.
Au cours des temps modernes, toute cette situation subit une profonde transformation.
La vérité de la Révélation chrétienne est de plus en plus mise en question ; sa valeur pour la formation et la conduite de la vie se discute de façon toujours plus péremptoire : vis-à-vis de l’Église surtout, l’état d’esprit de l’homme cultivé manifeste une opposition sans cesse plus vive. La prétention nouvelle : développer les différentes manifestations de la vie et de l’activité, politique, économie, ordre social, science, art, philosophie, éducation, etc., uniquement à partir de leurs normes internes, parait toujours davantage aller de soi. Ainsi se constitue une forme de vie non chrétienne et, sous de multiples rapports, anti-chrétienne. Elle s’affirme de façon si logique qu’elle semble absolument normale et l’exigence de l’Église qui veut que la vie soit déterminée par la Revelation, apparaît comme un empiétement. Même le croyant adopte dans une large mesure cette façon de voir lorsqu’il pense que les choses religieuses sont un domaine en soi et les choses du monde également, que chaque domaine doit adopter la structure qui convient à sa nature propre et qu’il faut laisser l’individu libre de vivre jusqu’à tel ou tel point dans ces deux domaines, selon son désir.
La conséquence, c’est que, d’un côté, une existence profane se fait jour, autonome, détachée des influences chrétiennes directes, et, de l’autre côté, un christianisme qui, d’étrange façon, imite cette « autonomie ». De même que se développe une science purement scientifique, une économie purement économique, une politique purement politique, il en va de même pour une religiosité purement religieuse. Celle-ci perd de plus en plus ses rapports directs avec la vie concrète, s’appauvrit de plus en plus de son contenu profane, se limite toujours plus exclusivement à la doctrine et à la pratique « purement religieuse » et n’a plus, pour beaucoup d’individus, d’autre signification que celle de donner une consécration religieuse à certains points culminants de l’existence : la naissance, le mariage, la mort.
En règle générale, c’est à cet état de choses que l’on pense lorsqu’on parle de la situation religieuse des temps modernes. Mais on peut ajouter autre chose encore : le déclin de cette réceptivité religieuse directe dont nous avons parlé.
On étudie la nature de façon toujours plus expérimentale et rationnelle, on conçoit de plus en plus la politique comme un simple jeu de puissances et d’intérêts ; on déduit logiquement l’économie de l’utilité et du bien-être ; on traite là technique comme un grand système servant à toutes les fins ; on considère l’art comme une création de formes selon les critères esthétiques et la pédagogie comme l’éducation d’un individu capable de s’insérer. dans cet État et cette culture. Dans la même mesure, la réceptivité religieuse décroît. Nous entendons par là, nous le répétons, non pas la foi à la Révélation chrétienne et la conduite d’une vie que celte Révélation détermine, mais une relation directe avec le contenu, religieux des choses, l’emprise sur l’âme du mystère répandu dans.le monde, telle qu’elle se rencontre chez tous les peuples et dans tous les temps.
Cela signifie que, dans une large mesure, l’homme des temps modernes non seulement — perd la foi en la Révélation chrétienne, mais subit aussi un affaiblissement de ses dispositions « religieuses naturelles, de sorte qu’il considère de plus en plus le monde comme une réalité profane. Les conséquences en sont immenses.
Ainsi, par exemple, l’ensemble des événements dont est faite la vie apparait non plus comme la Providence dont Jésus a parlé, non pas même comme ce mystère de la destinée dont l’antiquité à fait l’expérience, mais comme une simple suite de causes et d’effets empiriques qui peuvent être compris et dirigés. On peut en voir de nombreuses manifestations. Nous n’en donnerons qu’un exemple : le système d’assurances tel qu’il existe aujourd’hui.
Si on le considère dans les développements extrêmes qu’il a déjà pris dans beaucoup de-pays, il apparaît absolument comme « la mie à l’écart de tout arrière-plan religieux. Toutes les éventualités de la vie sont « prévues », calculées,
selon leur fréquence et leur importance, et rendues inoffensives.
Les événements capitaux de la vie humaine : la conception, la naissance, la maladie et la mort perdent leur caractère de mystère. Ils se transforment en processus sociaux et biologiques dont s’occupent une science et une « technique médicales toujours plus sûres d’elles-mêmes. Mais dans la mesure où ils représentent des faits dont on ne peut se rendre maître, on les « anesthésie », c’est-à-dire qu’on les rend sans importance — et déjà apparaît en. [lurge, et non seulement en marge du champ de culture, Iâ technique complémentaire qui vise à triompher rationnellernem de la vie et de la mort, c’est-à-dire à supprimer la vie lorsqu’elle n’apparaît plus digne d’être vécue au vivant lui-même ou à l’État quand elle ne lui semble plus correspondre aux fins qu’il se propose.
On voit disparaître l’accent religieux qui était mis autrefois sur l’Etat, le caractère de grandeur qui avait pour origine une consécration considérée comme divine à quelque point de vue. L’État moderne fait dériver du peuple tout pouvoir. On essaye pendant un certain temps de donner au peuple lui-même un caractère de grandeur (voir les conceptions du romantisme, du nationalisme et de la première démocratie). Mais bientôt l’idée se vide de son contenu et ne signifie plus rien, sinon que « le peuple », c’est-à-dire les nombreux individus qui appartiennent à l’État, en exprimant d’une façon quelconque leur volonté, constituent la suprême instance dans la série de mesures que prend l’État. Quand ce n’est pas, en réalité, une faction particulièrement agissante qui dirige les affaires.
Il y aurait encore beaucoup d’autres choses à dire sur ce point. Partout se constituent des modes d’existence qui ne dépendent plus que de facteurs empiriques.
Mais alors une question se pose une vie ainsi construite est-elle possible à la longue ? Possède-t-elle le sens dont elle a besoin pour pouvoir rester la vie d’êtres humains ? Bien plus : est-elle seulement capable d’atteindre les buts qui, dans chaque situation, doivent être atteints ?
Les structures ne perdent-elles pas leur force lorsqu’elles ne sont envisagées que dans leur contenu empirique ? L’État, par exemple, a besoin du serment. C’est la forme qui engage le plus l’homme quand il se prononce sur un fait ou s’oblige à un acte. Celui qui prête serment rapporte expressément et solennellement sa déclaration à Dieu. Mais si et telle est la tendance des temps modernes — le serment n’inclut plus ce rapport à Dieu ? Il n’a plus alors qu’une signification : celui qui prête serment déclare être informé qu’il sera puni des travaux forcés s’il ne dit pas la vérité formulée qui n’a plus guère de sens et certainement plus aucun effet.
Tout existant est plus que lui-même tout événement signifie plus que son strict accomplissement : ils se rapportent à quelque chose qui se situe au-dessus d’eux ou au-delà d’eux. C’est seulement à partir de là qu’ils reçoivent leur plénitude. Si cela disparaît, les choses comme les institutions se vident de leur contenu. Elles perdent leur force et leur signification, elles ne convainquent plus. La loi de l’État est plus qu’un simple appareil réglant un comportement publiquement approuvé ; au-delà d’elle se trouve un intangible qui, lorsque la loi est violée, s’impose à la conscience. L’ordre social est plus qu’une simple garantie pour une vie en commun sans frictions ; au-delà de lui se situe quelque chose qui, de telle ou telle manière, transforme en crime la transgression. Cet élément religieux fait que les différentes attitudes nécessaires à l’existence humaine sont réalisées même sans pression extérieure, « d’elles-mêmes », que ses différents éléments restent en rapports les uns avec les autres et forment une unité. Il n’existe pas de monde simplement profane, mais dans la mesure où un vouloir opiniâtre réussit à en créer la similitude, celle-ci ne fonctionne pas. C’est un simple artifice sans force intérieure, il ne convainc pas la raison qui guide la vie, sous-jacente à la raison rationaliste. Le cœur n’a plus le sentiment qu’un tel monde « vaut la peine » de vivre.
Sans élément religieux, la vie devient comme un moteur, qui n’a plus d’huile. Il chauffe. À tout instant telle ou telle pièce brûle. Partout des rouages se démontent qui devraient exactement s’emboîter. Le centre et les attaches se rompent. L’existence se désorganise et alors se produit ce court-circuit qui s’accomplit depuis trente ans dans une mesure toujours croissante. On use de la violence et est par là que la détresse, impuissante, cherche une issue quand les hommes ne se sentent plus unis de l’intérieur, on les organise extérieurement, et pour que l’organisation travaille l’Etat met par-derrière sa contrainte. Mais peut-on, à la longue, vivre par contrainte ?
Nous avons vu que, depuis le début des temps modernes, une culture non chrétienne s’élabore. Pendant longtemps, cette négation ne s’adresse qu’au contenu de la Révélation lui-même, non pas aux valeurs éthiques, soit individuelles, soit sociales, qui se sont développées sous son influence. Au contraire, la culture des temps modernes prétend précisément reposer sur ces valeurs. Selon ce point de vue, largement adopté par l’étude de l’histoire, des valeurs comme par exemple la personne, la liberté, la responsabilité et la dignité individuelles, l’estime réciproque, I’entraide, sont des possibilités innées chez l’homme que les temps modernes ont découvertes et développées. Sans doute, dit-on, la culture humaine, aux premiers temps du christianisme, a favorisé leur germination, de même elles ont été développées par la culture religieuse de la vie intérieure et de la charité active au cours du moyen âge. Mais, ajoute-t-on, cette autonomie de la personne a pris conscience d’elle-même et est devenue une conquête naturelle indépendante du christianisme. Ce point de vue s’exprime de multiples façons et d’une manière particulièrement représentative dans les droits de l’homme, au temps de la Révolution française.
Mais en vérité, ces valeurs et ces attitudes sont liées à la Révélation. Celle-ci se trouve en effet dans un rapport particulier avec l’humain immédiat. Elle a pour origine la liberté de la grâce divine, mais elle attire l’humain dans son harmonie ; de là naît la structure chrétienne de la vie. Par là sont libérées dans l’homme des forces qui, en soi, sont « naturelles », mais qui ne se développeraient pas en dehors de cette relation. L’homme prend conscience de valeurs qui, en soi, sont évidentes, mais qui ne deviennent visibles que sous cette lumière. L’idée que ces valeurs et ces attitudes appartiennent simplement à la nature humaine qui évolue méconnaît par conséquent le véritable état de choses ; bien plus, elle conduit — il faut avoir le courage de le dire franchement à une déloyauté ni, pour l’observateur plus attentif, fait donc partie aussi de l’image des temps modernes.
L’homme est essentiellement personne, mais celle-ci devient visible au regard et la volonté morale peut l’affirmer seulement quand la Révélation rend accessible, par l’adoption comme enfant de Dieu et par la Providence, le rapport au Dieu personnel et vivant, S’il n’en est pas ainsi, on a certes conscience de l’individu aux heureuses dispositions, distingué et créateur, mais non pas de la personne proprement dite, détermination absolue de chaque être humain, au-delà de toutes les qualités psychologiques ou culturelles. Ainsi, la connaissance de la personne est liée à la foi chrétienne. On pourra pendant un certain temps encore l’affirmer et la cultiver après que cette foi se sera éteinte, mais ensuite ces notions se perdront peu à peu. Il en est de même pour les valeurs correspondantes où s’épanouît la conscience de la personne. Ainsi, par exemple, pour ce respect qui ne va pas à un don particulier ou à une situation sociale, mais à là réalité de la personne en tant que personne, à sa qualité d’être unique, irremplable, inaliénable en chaque individu, qu’il soit pour le reste disposé et mesuré comme on voudra… Ou pour cette liberté qui ne représente pas la possibilité de se développer et de vivre en donnant sa mesure, donc réservée à l’homme privilégié en soi ou socialement, mais à la capacité pour chaque individu de prendre une décision, d’être ainsi maitre de son acte et, par là, maitre de lui-même. Ou bien pour cet amour du prochain qui ne signifie pas sympathie, entraide, obligation, sociale ou que chose d’analogue, mais la faculté d’affirmer le « toi » dans l’autre et d’être ainsi le « moi ». Tout cela ne reste en éveil qu’autant que l’on sait encore de façon vivante ce qu’est la personne. Mais dès que cette connaissance s’efface, en même temps que la foi aux rapports chrétiens avec Dieu, ces valeurs et ces attitudes disparaissent, elles aussi.
Que ces rapports n’aient pas été reconnus, que les temps modernes aient revendiqué pour eux la personne et les valeurs de la personne en supprimant leur garant, la Révélation chrétienne, c’est là ce qui a engendré cette déloyauté intérieure dont nous avons parlé. Tout ce complexe s’est d’ailleurs dévoilé peu à peu. Le classicisme allemand comporte des valeurs et des attitudes déjà flottantes. Sa noble humanité est belle, mais sans la suprême racine de vérité, car elle refuse la Révélation et se nourrit cependant partout de ses effets. Par là aussi, elle perd peu à peu son attitude humaine dès la génération suivante. Et non pas parce que celle-ci se trouverait à un niveau inférieur, mais parce que la culture de la personne, coupée de ses racines, se révèle impuissante en face de la poussée positiviste.
Ce processus s’est poursuivi et quand alors a fait soudainement irruption le système de valeurs des deux dernières décades, en contradiction si flagrante avec toute la tradition culturelle des temps modernes, cette soudaineté et cette contradiction n’étaient qu’apparentes : en réalité, un vide est apparu qui existait déjà depuis longtemps. La véritable personne, en même temps que son monde de valeurs et de comportements, avait disparu de la conscience avec le refus de la Révélation.
Les temps qui viennent créeront ici une clarté terrible, mais salutaire. Aucun chrétien ne peut se réjouir lorsqu’une absence radicale de christianisme se manifeste. Car la Révélation n’est pas une expérience subjective, mais la vérité pure, manifestée par Celui qui a aussi créé le monde, et chaque heure de l’histoire qui rend impossible à cette vérité d’exercer son influence est menacée au plus intime d’elle-même. Mais il est bon que cette déloyauté soit mise à nu. Alors on verra comment apparaît la réalité lorsque l’homme s’est détaché de la Révélation et que cesse l’usufruit qu’il en tirait.
Mais il faut encore répondre à cette question : de quelle nature sera la religiosité des temps qui viennent ? Non pas son contenu révélé, car il est éternel, mais la forme historique de sa réalisation, sa structure humaine ? Il Y aurait ici beaucoup à dire et à supposer, mais il nous faut nous limiter.
Ce que nous avons indiqué en dernier lieu sera plus important que tout : la manifestation violente de l’existence non chrétienne. Plus le non-croyant affirme catégoriquement son refus de la Révélation, plus il la réalise logiquement dans la pratique, mieux on verra ce qu’est le christianisme. Il faut que le non-croyant sorte du brouillard des sécularisations. Il faut qu’il renonce à l’usufruit qui nie la Révélation, mais qui s’est approprié les valeurs et les forces élaborées par celle-ci. Il faut qu’il accomplisse honnêtement son existence sans le Christ et sans le Dieu révélé par le Christ, et qu’il apprenne ce que cela signifie. Déjà Nietzsche a mis en garde en disant que le non-chrétien des temps modernes n’a pas encore reconnu du tout ce que cela signifie en réalité que d’être ce non-chrétien. Les décades précédentes nous en ont donné une idée, mais ce n’était là que le commencement.
Un nouveau paganisme se développera, Mais d’autres natures que le premier. Ici aussi, on se trouve en présence d’une équivoque qui se manifeste, entre autres, dans les rapports avec l’antiquité. Le non-chrétien d’aujourd’hui pense souvent qu’il peut rayer le christianisine, et chercher une autre voie religieuse en partant de l’antiquité. Mais il se trompe. On ne peut pas remonter le cours de l’histoire. Comme forme d’existence, l’antiquité est définitivement dépassée. Si l’homme d’aujourd’hui devient païen, il le sera dans un tout autre sens que l’homme d’avant le Christ. En dépit de toute la grandeur de sa vie et de son œuvre, l’attitude religieuse de celui-ci avait une naïveté juvénile. Il se trouvait encore avant cette option qui se réalise par le Christ. Par celle-ci, quelle qu’elle soit, l’homme se place à un autre niveau existentiel, Sören Kierkegaard l’a expliqué une fois pour toutes. Son existence acquiert un sérieux que l’antiquité n’a pas connu, parce qu’elle ne pouvait pas le connaître, qui n’est pas dû, à une maturité autonome, mais à l’appel que Dieu adresse à la personne par le Christ : elle ouvre les yeux, elle est désormais éveillée, qu’elle le veuille au non. Ce sérieux à pour origine la participation séculaire à l’existence du Christ, l’expérience faite avec lui de cette terrible clarté avec laquelle il a su ce qui est dans l’homme et de ce courage surhumain avec lequel il a subi l’existence humaine. D’où l’étrange impression d’êtres n’ayant pas atteint leur croissance que nous font si souvent les anti-chrétiens qui croient en l’antiquité.
Il en est de même pour la rénovation du mythe nordique. Dans la mesure où elle ne sert pas uniquement, comme dans le national-socialisme, a dissimuler le dessein d’accéder au pouvoir, elle est aussi dénuée de substance que celle du mythe antique. Le paganisme nordique se trouvait encore, lui aussi, devant cette option qui le contraignit à ne plus vivre à l’abri — et en même temps prisonnier d’une existence spontanée, avec ses rythmes et ses images — pour accéder au sérieux de la personne, quelle qu’ait pu être cette option.
On peut en dire autant de tous les essais qui ont été faits pour créer un nouveau mythe par la sécularisation de pensées et d’attitudes chrétiennes, comme c’est, par exemple, le cas dans la poésie du Rilke de la dernière période. Mais ce qu’elle renferme de spontané, c’est-à-dire la volonté d’effacer de la Révélation son caractère d’au-delà et de donner à l’existence une base uniquement terrestre, montre déjà son impuissance par l’incapacité de se situer dans ce qui commence. Les tentatives que, par exemple, les Sonnets à Orphée font dans ce sens traduisent une détresse émouvante et, à côté de la prétention des Élégies, causent une pénible impression.
Enfin, en ce qui concerne des vues comme celles d’un certain existentialisme français, leur négation du sens de l’existence est d’une telle violence que l’on se demande s’il ne représente pas une manifestation particulièrement désespérée du romantisme, rendue possible par les bouleversements des dernières décades.
Une tentative pour mettre l’existence non seulement en contradiction avec la Révélation chrétienne, mais pour lui donner une base vraiment indépendante d’elle et immanente serait d’un réalisme tout différent. Il faut attendre pour savoir dans quelle mesure l’Est le produira et ce qui alors adviendra de l’homme.
Mais il faudra que la foi chrétienne elle-même acquière un caractère de résolution tout nouveau. Elle aussi doit se dégager des sécularisations, des similitudes, des demi-mesures et des compromissions. Et ici, il me semble qu’une grande confiance est permise.
Il a toujours été particulièrement difficile au chrétien de s’accommoder des temps modernes. Le souvenir de leur révolte contre Dieu était trop vivant, la manière dont ils ont mis tous les domaines de la création culturelle en contradiction avec la foi et poussé cette foi elle-même dans une situation d’infériorité, était trop ambiguë. Il y avait, en outre, ce que nous avons nommé la déloyauté des temps modernes : ce double jeu qui, d’une part, refusait la doctrine et l’ordre chrétiens de la vie, mais d’autre part prétendait annexer leurs effets sur la culture humaine. Il en est résulté pour le chrétien une attitude hésitante dans ses rapports avec les temps modernes. Partout, il trouvait en eux des idées et des valeurs dont l’origine chrétienne était évidente, mais que l’on déclarait être bien commun. Partout, il rencontrait des valeurs essentiellement chrétiennes, mais que l’on retournait contre lui. Comment aurait-il pu avoir confiance ? Ces obscurités cesseront. Là où les temps qui viennent s’opposeront au christianisme, ils le feront avec sérieux. Ils déclareront que les valeurs chrétiennes sécularisées sont pure sentimentalité et l’atmosphère sera purifiée. Pleine d’hostilité et de danger, mais nette et claire.
Le relâchement qu’ont subi les forces religieuses directes, ainsi que la capacité d’expérience et de formation religieuses dont nous avons déjà parlé, agiront aussi dans le même sens. Quand la religion est partout présente, c’est une aide pour la foi, mais le contenu de cette foi peut aussi s’en trouver voilé et laïcisé. Quand la religion se manifeste moins, la foi est plus rare, mais aussi plus pure et plus forte. Elle a un regard plus ouvert sur le réel et son centre de gravité pénètre plus profondément dans la personne, dans l’option, la fidélité et la capacité de vaincre.
Ce qui a été dit ci-dessus sur la situation et son danger vaut aussi pour l’attitude chrétienne. Elle devra porter de façon particulière le caractère de la confiance et de la force.
On a souvent reproché au christianisme d’offrir à l’homme un abri contre le péril auquel l’expose la situation actuelle. Il y avait bien du vrai — et non seulement parce que le dogme, dans son objectivité, crée un ordre sûr pour la pensée et la vie, mais aussi parce que subsiste encore dans l’Eglise une foule de traditions culturelles qui ont disparu ailleurs. Ce reproche aura de moins en moins de raison d’être dans les temps qui viennent.
Le bien culturel de l’Église ne pourra échapper à la décadence générale de la tradition et là où il subsistera encore, beaucoup de problèmes lui porteront de rudes coups. Mais en ce qui concerne le dogme, il est certes dans sa nature de survivre à tous les tournants des temps puisqu’il est fondé dans le supra-temporel, on peut supposer, cependant, qu’il fera comprendre de façon particulièrement sensible le mode de vie. Plus le christianisme s’affirmera comme n’allant pas de soi, plus il lui faudra se séparer nettement d’une conception non chrétienne de la vie qui régnera partout ; et plus le facteur, existentiel se manifestera pratiquement dans le dogme à côté du facteur théorique. Je n’ai pas besoin, je crois, d’affirmer que je n’entends par là nulle « modernisation » », nul affaiblissement de son contenu ou de sa valeur. Au contraire, son caractère d’absolu, d’inconditionné dans son expression comme dans son exigence s’accentuera plus fortement. Mais dans cet absolu, la définition de l’existence et l’orientation du comportement seront, me semble-t-il, particulièrement sensibles.
Ainsi, la foi sera capable de rester ferme dans le péril. Dans les rapports avec Dieu, l’élément d’obéissance se manifestera fortement : une obéissance loyale qui sait qu’il y a de ces choses suprêmes qu’elle seule peut permettre de réaliser. Non pas parce que l’homme serait « hétéronome., mais parce que Dieu est la sainteté absolue. Ainsi donc, une attitude résolument non libérale, dirigée absolument vers l’absolu, mais, et c’est ici qu’elle se distingue de toutes les violences, dans la liberté. Ce caractère absolu n’est pas un abandon au pouvoir physique et psychique du commandement, mais, grâce à lui, l’homme accueille dans son acte la qualité de l’exigence divine. Or ceci suppose la majorité du jugement la liberté de l’option.
Et une confiance qui n’est possible qu’ici. Non pas en un ordre rationnel de l’univers ou en un principe optimiste de bienveillance, mais en Dieu, réel et réalisateur, bien plus : qui est à l’œuvre et qui agit. Si je ne me trompe, l’Ancien Testament prend une importance particulière : il montre le Dieu vivant qui fait une percée à travers l’envoûtement universel du mythe comme à travers les puissances séculières de la politique païenne ; il montre aussi le croyant qui, acceptant l’Alliance, se rapporte à cet acte de Dieu. On en comprendra l’importance. Plus grandissent les forces anonymes, d’autant plus résolument s’affirmera la “domination du monde” par la foi dans la réalisation de la liberté, dans l’accord de la liberté donnée à l’homme avec la liberté créatrice de Dieu. Et dans la confiance en ce que Dieu fait, non seulement réalise, mais fait. Il est étrange, ce pressentiment de sainte possibilité qui monte au sein de la contrainte sans cesse grandissante du monde !
Ce rapport de l’absolu et de la personne, de la nécessité et de la liberté, rendra le croyant capable de subsister sans lieu ni refuge et de connaître sa direction. Elle le rendra capable d’entrer avec Dieu en un rapport direct, à travers toutes les situations de la contrainte et du danger et dans la solitude croissante du monde qui vient — la solitude, précisément, parmi les masses et dans les organisations — de demeurer une personne vivante.
Si nous comprenons exactement les textes eschatologiques de la Sainte Écriture, la confiance et la force constitueront le caractère propre de la fin des temps. Le milieu chrétien, la culture chrétienne, l’assurance donnée par la tradition perdront de leur force. Ce sera là un des éléments de ce danger de scandale dont il est dit que “si c’était possible, les élus eux-mêmes succomberaient” (Matth. xxiv 24)
La solitude de la foi sera terrible. L’amour, la “Charité disparaîtra du comportement général du monde (Matth XXIV, 12). Elle ne sera plus comprise, elle ne pourra plus être. Elle deviendra d’autant plus précieuse lorsqu’elle ira d’un isolé à un antre isolé — force du cœur émanant directement de l’amour de Dieu, telle qu’elle s’est — manifestée dans le Christ. Peut-être ferait-on une expérience toute nouvelle de cette charité souveraine dans son caractère spontané, indépendante du Monde, mystérieuse en son pourquoi suprême. Peut-être la charité acquerra-t-elle une profondeur d’entente qui n’a pas encore existé. Quelque chose de ce qui s’exprime dans ces paroles qui sont là clef du message de Jésus sur la Providence : pour l’homme qui fait de la volonté et du règne de Dieu son premier souci, les choses se transforment. (Matth., VI, 33)
Ce caractère eschatologique se révélera, me semble-t-il, dans l’attitude religieuse qui s’amorce. On n’entend pas par là annoncer une apocalypse à bon marché. Personne n’a le droit de dire que la fin approche, alors que le Christ lui-même a déclaré que le Père seul connaît les Choses de la fin. (Matth. xxiv 36). Si donc il est question ici d’une approche de la fin, elle est entendue non comme temporelle, mais comme essentielle, c’est-à-dire que notre existence approche de l’option absolue et de ses conséquences : des possibilités les plus hautes comme des périls les plus extrêmes.